« Tous les scénarios esquissés dans ce livre doivent être compris comme des possibilités et non comme des prophéties. »
Yuval Noah Harari « Homo Deus » Page 425
Le Point a fait sa Une de son numéro du 20 septembre 2018 avec ce titre :
« Yuval Noah Harari : Le penseur le plus important du monde. »
Titre assez stupide, mais dans l’air du temps. Il y a bien sûr la tentative d’avoir une couverture accrocheuse susceptible de faire vendre, Mais c’est aussi parce que, pour beaucoup, nous sommes dans le temps de la compétition dans lequel on cherche à toujours déterminer quel est le N°1.
Quel est le meilleur footballeur, le meilleur tennisman ?
Encore que dans ces domaines, il s’agisse d’activités humaines qui vivent en grande partie de la compétition.
Mais se poser la question, quel est le meilleur écrivain, le plus grand penseur, le plus grand scientifique est, selon moi, un exercice vain et dénué de pertinence.
Notez qu’il y en a qui ne sont pas d’accord.
Luc Ferry par exemple : <Harari ou l’avenir pour les nuls>, article publié dans le journal Le Figaro dans lequel, après avoir accusé Harari d’avoir plagié Auguste Comte, de ne pas savoir distinguer le communisme et le socialisme, il finit par cette condamnation sans appel :
« La vérité c’est qu’après avoir adapté Auguste Comte au goût du jour, c’est Orwell qu’Harari repeint aux couleurs de la Silicon Valley pour donner à son livre le ton apocalyptique sans lequel il n’est plus aujourd’hui de succès. Il veut vulgariser, pourquoi pas, mais au prix de simplismes si extrêmes que tout l’ensemble en devient franchement fallacieux. »
Mais si vous écoutez une interview de Yuval Noah Harari et que vous la comparez avec une interview de Luc Ferry, ou d’ailleurs de Michel Onfray ou de BHL vous êtes dans deux mondes différents, le monde de l’humilité d’un côté, le monde de l’arrogance de l’autre.
Ce n’est pas que Luc Ferry, Michel Onfray, c’est plus compliqué avec BHL ne disent pas des choses parfois très intéressantes, mais leur ton est toujours celui du sachant, de l’autorité intellectuelle et morale du haut de leur piédestal. Bref, ils sont incapables de la moindre modestie.
Rien de tel chez Yuval Noah Harari qui dans son expression, ses formulations propose, émet des hypothèses, bref nous donne à réfléchir.
Gaspard Koenig dans l’émission du Grain à moudre du 27/09/2018 a dit son admiration pour l’écrivain israélien avec ces mots :
« Harari est un historien qui regarde vers l’avenir »
Ce qui est une manière de le définir qui me convient.
Si le Point a fait sa couverture sur Harari, c’est parce qu’il vient de faire publier en France un troisième livre : «21 Leçons pour le XXIème siècle ».
Il va un peu vite pour que je parvienne à le suivre.
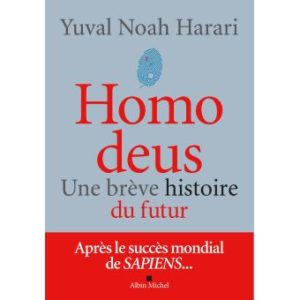 Pour ma part je n’en suis qu’à son deuxième « Homo Deus » que j’ai lu pendant les vacances d’été et que je vais essayer de présenter au cours d’une série de mots du jour.
Pour ma part je n’en suis qu’à son deuxième « Homo Deus » que j’ai lu pendant les vacances d’été et que je vais essayer de présenter au cours d’une série de mots du jour.
Vous savez que si pour un roman il peut apparaître pertinent de commencer par le début et d’arriver à la dernière page en ayant lu toutes celles intermédiaires, ce n’est pas du tout la bonne méthode pour un essai comme « Homo Deus » : On commence par la table des matières puis on lit la conclusion et le début dans l’ordre qu’on souhaite et on picore un peu au milieu.
Si cet examen est concluant et vous permet dès l’entame d’avoir une vision d’ensemble du propos, vous pouvez commencer à lire l’ouvrage de manière plus méthodique, en abordant les chapitres dans leur entier et si cela vous semble pertinent dans l’ordre dans lequel l’auteur les a publiés ou dans un autre ordre si votre compréhension du sujet vous dicte cette méthode.
Pour ce premier mot sur « Homo deus » je vous propose de commencer par la conclusion ou au moins le début de la conclusion qui valide cette vision d’humilité que je décrivais précédemment.
D’abord Yuval Noah Harari explique qu’il ne sait pas de quoi l’avenir sera fait.
« Nous ne saurions prédire l’avenir parce que la technologie n’est pas déterministe. La même technologie pourrait créer des sociétés de nature très différente Par exemple, la technologie de la révolution industrielle – Train, électricité, radio et téléphone – a pu servir à mettre en place des dictatures communistes, des régimes fascistes et des démocraties libérales. »
Et j’ajouterai, même des social- démocraties qui sont des démocraties libérales avec un supplément d’âme parce qu’ils ajoutent à la liberté et aux droits individuels, la solidarité.
Et il ajoute :
« L’essor de l’intelligence artificielle et des biotechnologies transformera certainement le monde, mais il n’impose pas un seul résultat déterministe. Tous les scénarios esquissés dans ce livre doivent être compris comme des possibilités et non comme des prophéties. »
Harari refuse à juste titre le rôle de prophète mais en accumulant les connaissances sur les progrès des technologies, les pistes de recherche dans les laboratoires et les lieux des plus remarquables ingénieurs et scientifiques, il tente de comprendre ce que l’alchimie de l’ensemble de ses technologies peut produire sur l’homme, la société, la terre et où elle peut nous mener.
Je vais partager un petit exemple qui n’est pas dans son livre mais est issue d’une chronique de Pierre Haski « Géopolitique 30/08/2018 »
1° Vous connaissez tous la technologie des drones. Ces petits engins volants qui permettent de faire de magnifique vidéo de lieux splendides ou d’une ville comme Lyon. Ils permettent aussi d’espionner des centrales nucléaires ou d’autres lieux qui pour divers raisons ont vocation à rester secret. Mais vous savez aussi qu’Amazon a le projet de faire transporter des colis par drone.
2° Vous avez entendu parler de la technologie de la reconnaissance faciale. Les chinois expérimentent cela à très grande échelle. Le taux de réussite s’améliore d’année en année, je veux dire le fait que le système de reconnaissance sait associer une image que capte une caméra et l’identité de la personne qui a été filmée.
3° Toutes les armées du monde et particulièrement celles des Etats-Unis, de la Chine et de la Russie travaillent à miniaturiser des armes létales. (arme létale est peut-être un pléonasme)
Que se passe-t-il si vous combinez ces trois technologies ?
Je donne la parole à Pierre Haski :
« Imaginez un minidrone qui tiendrait dans la paume de votre main, équipé d’un système de reconnaissance faciale et d’une charge explosive suffisante pour faire exploser un crâne. Vous le lâchez dans la nature avec un visage programmé comme cible, il le cherchera dans une foule et l’éliminera, sans intervention humaine.
Imaginez maintenant des centaines ou des milliers de tels minidrones lancés sur une ville, sur un rassemblement, ou sur une base militaire, coordonnant tout seuls leur approche et se partageant les cibles à éliminer.
Nous ne sommes pas dans la science-fiction, dans un remake de Terminator version 2018, mais dans la réalité de la guerre de demain. De tels engins, et bien d’autres encore tout aussi terrifiants, baptisés « Robots tueurs », sont à l’étude dans les labos de recherche d’une poignée de pays dotés des moyens scientifiques et financiers, et de la volonté politique de les développer.
Bienvenue au nouveau siècle de la guerre, celui de l’intelligence artificielle, une technologie dont Vladimir Poutine disait l’an dernier que le pays qui la maîtriserait contrôlerait le monde. »
C’est un sujet très sérieux puisque l’ONU a réuni fin août une conférence à Genève en vue d’interdire ou au moins de réglementer de tels robots tueurs.
Les esprits résolument optimistes diront : « Chic on va pouvoir éliminer de manière simple et avec quasi aucun dommage collatéral Bachar el-Assad, le boucher de Syrie.
Vous croyez ?
Ne pensez-vous pas que c’est plutôt Bachar el-Assad qui s’en servirait pour tuer, sans coup férir, les principaux responsables de son opposition ?
Ou le président chinois qui va éliminer les dissidents les plus virulents.
Ou encore Donald Trump qui utilisera ce moyen pour se débarrasser du lanceur d’alerte, Edward Snowden ?
Harari dans sa conclusion nous invite à comprendre et à combattre les évolutions que nous n’aimons pas :
« Certaines de ces possibilités ne vous plaisent pas ? Libre à vous de penser et de vous conduire de façon à ce qu’elles ne se matérialisent pas.
Il nous met en garde cependant de notre difficulté à penser à ce monde nouveau et les perspectives qu’il ouvre tant il est vrai que nous sommes limités par nos modes pensées anciens :
« Toutefois, il n’est pas facile de trouver de nouvelles façons de penser et de se conduire, parce que nos pensées et actes sont habituellement contraints par les idéologies et systèmes sociaux de notre époque. Ce livre retrace les origines de notre conditionnement actuel afin d’en desserrer l’emprise, de nous permettre d’agir autrement et d’envisager notre avenir de manière bien plus imaginative. Loin de de rétrécir nos horizons en prévoyant un seul et unique scénario définitif, il vise à les élargir et à nous faire prendre conscience que nous avons un spectre d’options bien plus large. »
C’est aussi la force de la réflexion de Harari de nous révéler nos conditionnements et ainsi d’élargir nos capacités de réflexion et de compréhension.
Et il finit par ce nouvel assaut d’humilité en phase avec toute sa démarche :
« Comme je l’ai maintes fois souligné, personne ne sait vraiment à quoi ressemblera le marché du travail, la famille ou l’écologie en 2050, ni quels religions, systèmes économiques et structures politiques domineront le monde »
Dire qu’ « Homo deus » est un ouvrage aussi fabuleux qu’« Sapiens » est probablement excessif.
C’est aussi plus compliqué de parler de l’avenir que de ce qui a été. Il approfondit d’ailleurs certaines des réflexions qu’il avait développées dans son premier livre et il en rappelle d’autres. Mais « Sapiens » présentait une telle quantité d’informations, de remise en question de mythes fondateurs que nous acceptons comme des vérités, de mise en perspective du comportement et de l’évolution de notre espèce, qu’il était probablement très difficile de rester à ce niveau.
Dans un entretien à l’OBS publié le 29 septembre 2018, Harari révèle ses craintes et sa démarche, bien loin des ambitions de magistère chères à Luc Ferry et consorts :
« Ma crainte, c’est que l’on commence à me voir comme une sorte de gourou. Il est bon d’apprécier le savoir et de respecter l’opinion des intellectuels, mais il est dangereux d’en faire des idoles. Celui qui est placé sur un piédestal court le risque de se croire tout-puissant, de développer un ego surdimensionné et de devenir fou.
Quant aux fans qui croient avoir trouvé un individu qui a réponse à tout, ils renoncent à leur liberté et arrêtent de réfléchir par eux-mêmes. Ils attendent que le gourou leur fournisse toutes les réponses, toutes les solutions, aussi mauvaises soient-elles. Je souhaite que mes lecteurs trouvent dans mes livres des questions plutôt que des réponses, qu’ils voient en moi un compagnon de voyage sur le chemin de la vérité plutôt qu’un devin omniscient. »
Je souhaite que mes lecteurs trouvent dans mes livres des questions plutôt que des réponses.
J’avais achevé la série sur « Sapiens » par cette injonction kantienne concernant la philosophie des lumières :
« Sapere aude ! Habe Mut dich deines eigenen Verstandes zu bedienen !»
« Ose savoir ! Aie le courage de te servir de ton propre entendement !»
Mais pour reprendre le jugement excessif et stupide du Point, Yuval Noah Harari est un penseur essentiel qu’il faut lire pour apprendre beaucoup de connaissances et plus encore pour se poser les questions que sa démarche, ses hypothèses et son cheminement intellectuel suscitent en nous.
Et c’est donc à ce cheminement, à ce questionnement que je vais vous inviter dans les prochains jours.
<1120>
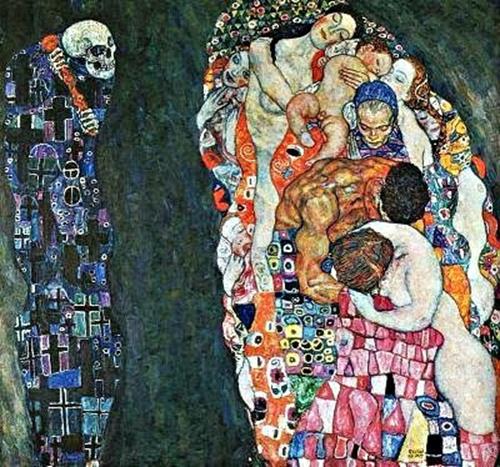


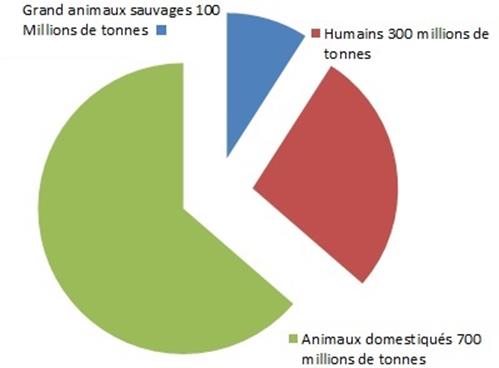

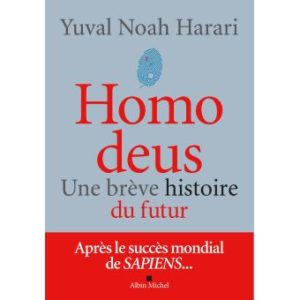 Pour ma part je n’en suis qu’à son deuxième « Homo Deus » que j’ai lu pendant les vacances d’été et que je vais essayer de présenter au cours d’une série de mots du jour.
Pour ma part je n’en suis qu’à son deuxième « Homo Deus » que j’ai lu pendant les vacances d’été et que je vais essayer de présenter au cours d’une série de mots du jour.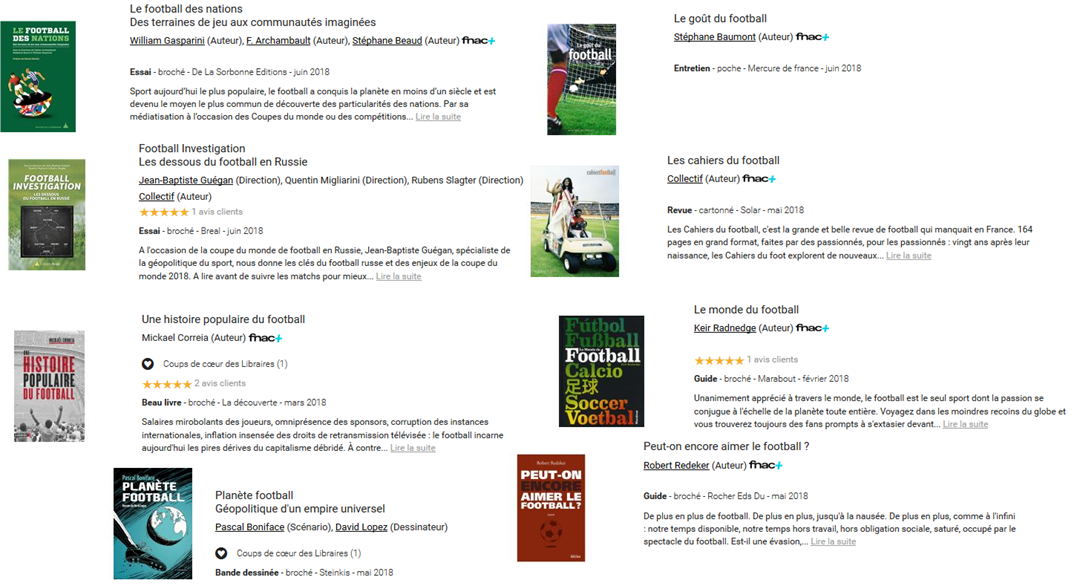
 Le Racing Universitaire Algérois, voilà la grande affaire de Camus. « Je ne savais pas que vingt ans après, dans les rues de Paris ou de Buenos Aires (oui ça m’est arrivé) le mot RUA prononcé par un ami de rencontre me ferait battre le cœur le plus bêtement du monde », s’épanche-t-il un rien grandiloquent, contrairement à son habitude. S’il supporte le RC Paris, il n’y a d’ailleurs pas de hasard: « Je puis bien avouer que je vais voir les matchs du Racing Club de Paris, dont j’ai fait mon favori, uniquement parce qu’il porte le même maillot que le RUA, cerclé de bleu et de blanc. Il faut dire d’ailleurs que le Racing a un peu les mêmes manies que le RUA. Il joue ‘scientifique’, comme on dit, et scientifiquement, il perd les matchs qu’il devrait gagner », confie-t-il au journal du RUA, repris par France Football, à l’époque. Le mauvais sort de la ville lumière ne semble apparemment pas dater du PSG.
Le Racing Universitaire Algérois, voilà la grande affaire de Camus. « Je ne savais pas que vingt ans après, dans les rues de Paris ou de Buenos Aires (oui ça m’est arrivé) le mot RUA prononcé par un ami de rencontre me ferait battre le cœur le plus bêtement du monde », s’épanche-t-il un rien grandiloquent, contrairement à son habitude. S’il supporte le RC Paris, il n’y a d’ailleurs pas de hasard: « Je puis bien avouer que je vais voir les matchs du Racing Club de Paris, dont j’ai fait mon favori, uniquement parce qu’il porte le même maillot que le RUA, cerclé de bleu et de blanc. Il faut dire d’ailleurs que le Racing a un peu les mêmes manies que le RUA. Il joue ‘scientifique’, comme on dit, et scientifiquement, il perd les matchs qu’il devrait gagner », confie-t-il au journal du RUA, repris par France Football, à l’époque. Le mauvais sort de la ville lumière ne semble apparemment pas dater du PSG.
