Je n’achète pas souvent le Figaro, mais quand j’ai appris que le journal du 19 septembre 2018 faisait dialoguer Pierre Manent, grand intellectuel libéral né en 1949 et Jean-Claude Michéa penseur de gauche né en 1950 pour parler de l’idéologie des droits de l’homme, je l’ai fait en toute simplicité.
L’idéologie des droits de l’homme est une pensée très positive dans notre système des valeurs.
C’est un champ illimité de progression des droits individuels contre les corporations, les religions, les Etats et toutes ces organisations qui ont toujours contraints les individus.
Ce fut depuis la philosophie des Lumières une évolution bénéfique. Certains pensent que nous sommes allés trop loin.
Pierre Manent a écrit : « La loi naturelle et les droits de l’homme » paru en mars 2018. <France Culture a consacré une page> et plusieurs émissions à ce livre et ce thème.
Jean-Claude Michéa a écrit : « Le loup dans la Bergerie » paru le 19 septembre 2018 <France Culture a consacré une page> et des émissions à ce livre.et ce thème.
J’en ai écouté une plus précisément <La Grande Table du 18 septembre> où Jean-Claude Michéa a développé son questionnement sur l’idéologie des droits de l’homme.
Il dit par exemple :
« Seule la liberté peut limiter la liberté. Sur le papier, c’est magnifique. (…) Mais arrive un moment où tout peut être considéré comme une nuisance. »
Et il a raconté une histoire vraie et je pense pertinent de commencer la réflexion par ce conflit de deux « droits de l’homme ».
J’ai trouvé un article sur le site France 3 Rhône Alpes Auvergne qui donnait plus de précision et confirmait les dires de Jean-Claude Michéa.
Voici l’histoire :
Un couple de citadins originaire de la Loire s’est installé dans le paisible village de Lacapelle-Viescamp, dans le Cantal. Il est incommodé par l’odeur des vaches et du fumier. Les citadins portent l’affaire devant le juge. Après un premier jugement dont l’article ne dit rien, la Cour d’appel de Riom donne raison aux citadins et condamne le paysan à éloigner les vaches et les ouvrages de stockage du fumier à 50 mètres du voisin. Autrement dit, cette ferme, construite en 1802 et située à 35 mètres des plaignants, doit déménager.
Les citadins invoquent le droit individuel de ne pas être incommodé sur leur lieu de vie privée.
Ils entrent en conflit avec un agriculteur issu d’une lignée d’agriculteurs qui exploitent cette ferme depuis 1802.
Nous avons déjà entendu parler de ces conflits de citadins qui se plaignent du bruit des cloches de l’église du village ou aussi des cloches des vaches.
<Il y avait aussi ce couple de parisiens qui voulait porter plainte contre le chant des cigales > ou encore ceux-là qui ont <interpellé le maire parce qu’il ne luttait pas contre les cigales par des insecticides>. Dans aucun de ces cas la justice n’a donné raison aux plaignants.
Que la décision de justice conduise à faire déménager une ferme constitue une étape supplémentaire.
Vous savez, même si cela en irrite certains, que les hommes moyens parlent des faits. Pour ma part, il me semble qu’il faut dépasser les faits et réfléchir à ce qu’ils signifient, quels sens leur donner, quelles conséquences pour notre vie en société, les uns avec les autres. Car il y a l’odeur de la ferme, le bruit des cigales mais surtout il y a toutes ces prétentions qui commencent par cette affirmation : «j’ai droit à… »
Jean-Claude Michéa explique :
« Le slogan du libéralisme et notamment de gauche, c’est mon corps, c’est mon choix et ça ne vous regarde pas. Mon temps, c’est mon choix, ça ne vous regarde pas. Mon argent, c’est mon choix, ça ne vous regarde pas. C’est vrai dans certaines limites parce que sinon on est dans un système totalitaire.
Mais à partir de quel moment, l’usage que je vais faire de mon temps, de mon corps, de mon argent, va détruire la vie commune ?
Prenons l’exemple du dimanche : le libéral dit : ‘je ne vous empêche pas de travailler le dimanche, si vous voulez vous reposer le dimanche, c’est votre problème, moi j’ai envie de travailler. En quoi ça vous regarde, je ne gêne personne. Je ne nuis à personne.
Mais au fur et à mesure que dimanche devient un jour comme les autres, tous les rythmes collectifs se désynchronisent.
La vie sportive, familiale et associative deviennent de plus en plus complexes à mettre en œuvre, et on s’aperçoit au bout de quelque temps que toutes ces décisions présentées comme privées finissent par modifier la vie commune, la re-sculpter. Si vous n’avez pas fait ces choix, vous allez être confrontés à des difficultés et des problèmes presque insurmontables. »
Dans l’article du <Figaro> Pierre Manent expose son opposition entre la Loi naturelle et les droits de l’homme :
« La philosophie des droits humains postule que nous disposons d’un pouvoir légitime et illimité sur tous les aspects de la condition et de la nature humaine. Je pense le contraire. Aussi vastes que soient les capacités humaines, elles restent liées à la condition et à la nature de l’homme. Celui-ci est l’être « intermédiaire » qui se cherche entre la bête et le dieu – entre les êtres qui sont en deçà de la loi et ceux qui sont au-delà de la loi. Il est donc voué à une vie politique, c’est-à-dire à une vie de liberté sous la loi. Ici intervient décisivement la notion ou plutôt le fait de la nature humaine. […] Nous tendons par nature à une vie commune réglée par la raison pratique. La loi naturelle, c’est l’ensemble des principes et critères qui guident cette raison commune. […] Notre liberté habite une nature qui nous donne à la fois l’impulsion, le but et la limite. Nous rejetons aujourd’hui avec impatience et dédain ces déterminations naturelles et prétendons à une liberté sans règle ni raison. »
Aucun de ces deux penseurs ne rejette les droits de l’homme, mais en revanche ils considèrent qu’en appeler exclusivement aux droits individuels constitue une impasse. Pierre Manent dit, une société dont la Loi serait exclusivement la somme des désirs individuels de ses membres est une société assez peu désirable. Car il me semble comme lui que ce qui importe c’est de faire société, de vivre ensemble.
Jean-Claude Michea préfère à la Loi naturelle, la « common decency » concept inventé par Orwell :
« La disposition morale, c’est-à-dire le sentiment, disait Orwell, qu’il y a des choses qui ne se font pas est effectivement présente dans toutes les sociétés humaines. Marcel Mauss l’avait déjà établi dans « l‘Essai sur le don », en montrant que le lien social primaire repose partout et toujours sur la triple obligation de « donner, recevoir et rendre ». […] Simon Leys considérait par exemple la tradition confucéenne comme une forme spécifiquement chinoise de la « common decency » »
Pour Michéa le grand responsable de cette évolution délétère est l’idéologie libérale et la marchandisation du monde :
« L’ennui c’est qu’il est devenu presque impossible, aujourd’hui de s’opposer aux dérives les plus folles de cette idéologie libérale (à partir du moment, en effet où tout comportement – faute de critères éthiques partagés- peut devenir objet de plainte, elle invite inévitablement à voir le mal partout et donc à remplacer tout débat par un appel aux tribunaux) sans remettre simultanément en question la dynamique du capitalisme lui-même. Un système économique dans lequel un bien n’est pas produit en raison de son utilité réelle ou de ses qualités propres mais, avant tout parce qu’il permet au capital déjà accumulé de s’accumuler encore plus ne peut, en effet, connaître écrivait Marx – ni frontière géographique ni aucune limite morale ou naturelle. […] Il est clair qu’une forme de société qui tend ainsi à noyer toutes les valeurs morales dans les « eaux glacées du calcul égoïste » est forcément incapable de fixer d’elle-même la moindre limite à ses propres débordements. Sous ce rapport, l’idée d’un libéralisme « conservateur » n’est donc qu’un oxymore. »
Pierre Manent est en accord avec le diagnostic, mais il continue à ne pas faire porter le poids de la faute sur le libéralisme dont il raconte l’histoire et tout ce qu’il a apporté en terme de liberté, de développement et de progrès pour les sociétés d’aujourd’hui. Il explique :
« L’imaginaire de la croissance illimitée où Jean-Claude Michéa voit à juste titre un des ressorts du charme maléfique qui emporte maintenant, avec l’Occident, l’humanité tout entière, n’est pas propre au libéralisme […] Après la Révolution française, une fois la révolution industrielle et la révolution démocratique entrées en phase, le libéralisme n’est plus qu’un facteur parmi d’autres et rarement le plus fort. L’Industrie, le Socialisme, l’Etat administratif, la Science, d’autres instances encore, furent tour à tour convoqués pour servir d’instrument à cette démesure de la raison organisatrice qui marqua tellement les deux derniers siècles. »
Et j’aime beaucoup la conclusion de Pierre Manent :
« Nous sommes en train de faire sur nous-mêmes une expérience morale ou métaphysique particulièrement cruelle. Au lieu de chercher les voies d’une éducation commune et de construire des institutions qui protègent, nourrissent et raffinent des expériences partagées, nous nous imposons une désintitutionnalisation toujours plus complète des contenus de notre vie. Qu’espérons nous donc de l’émancipation finale quand il ne restera plus sur la place publique que l’individu avec ses droits, pauvre homme séparé des hommes et des biens qui donnent son sens à la vie humaine ? »
<1119>

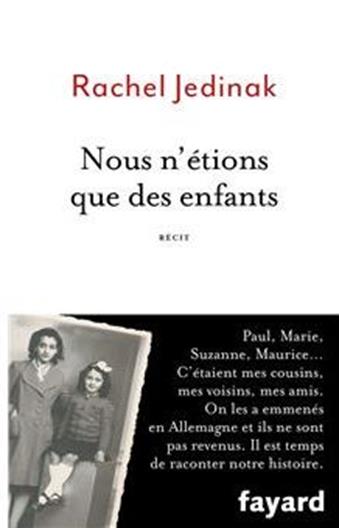

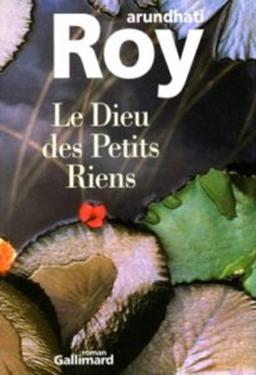 soleil.
soleil. politique et religieux, « on la traite de sympathisante terroriste, de communiste et de sécessionniste », souligne India Today.
politique et religieux, « on la traite de sympathisante terroriste, de communiste et de sécessionniste », souligne India Today.





