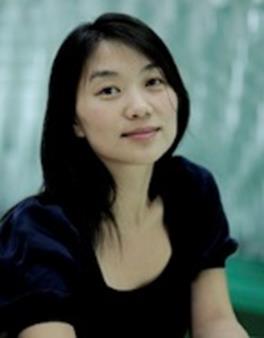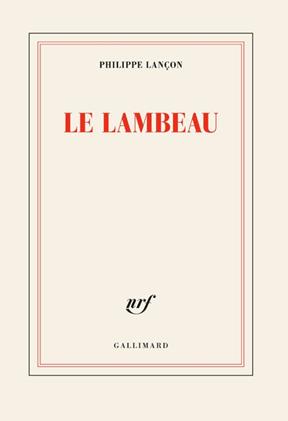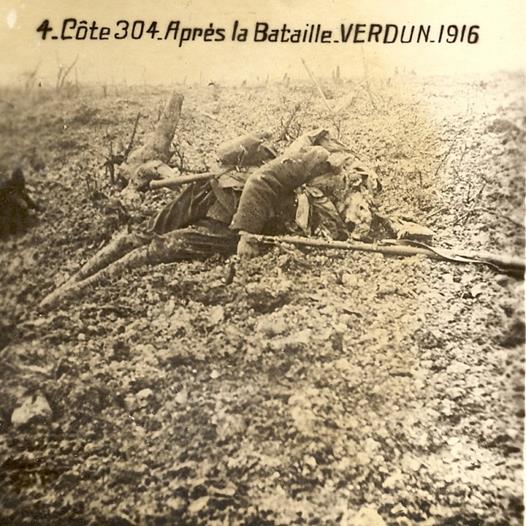Ecrire en ce moment est difficile. Ce qui se passe dans le monde est en quelque sorte révolutionnaire, c’est à dire en rupture avec ce qui existait avant. La prédation, le rapport de force existaient bien sûr, mais jamais le droit n’a été à ce point nié dans les relations internationales au profit de la seule puissance. Celui qui est puissant peut exiger ce qui lui plait et regarder avec dédain le juge du droit en lui posant la question « De quelle armée, de quelle police disposes-tu pour m’obliger à faire ce que tu prétends m’imposer ? ». Staline, en son temps avait posé les jalons en demandant : « Le pape ? Combien de divisions ? ».
L’élection de Donald Trump joue un rôle d’accélérateur dans ce dérèglement du monde. La lettre numérique « Zeitgeist » de Philippe Corbé continue à nous donner des informations incroyables : « Que la Force soit avec Lui »
Trump était invité dans l’émission Meet the Press, sur NBC, la plus ancienne émission de la télévision américaine, chaque dimanche depuis 1947. Premier échange rapporté par Corbé :
« NBC : En tant que président, n’êtes-vous pas censé défendre la Constitution des États-Unis ? Trump : Je ne sais pas…»
 Il est président et il ne sait pas s’il doit défendre la Constitution des Etats-Unis ! Cet individu a par deux fois en janvier 2017 et janvier 2025, prêté serment, en posant la main sur la bible (c’est ainsi que cela se passe dans ce pays) et il a prononcé alors ces paroles « Je jure solennellement que je soutiendrai et défendrai la Constitution des États-Unis contre tous ennemis, externes ou intérieurs, que je montrerai loyauté et allégeance à celle-ci, que je prends cette obligation librement, sans aucune réserve intellectuelle ni intention de m’y soustraire et je m’acquitterai bien et loyalement des devoirs de la charge que je m’apprête à prendre. Que Dieu me vienne en aide. ». A t’il des trous de mémoire ou simplement ne se sent-il engagé par rien ?
Il est président et il ne sait pas s’il doit défendre la Constitution des Etats-Unis ! Cet individu a par deux fois en janvier 2017 et janvier 2025, prêté serment, en posant la main sur la bible (c’est ainsi que cela se passe dans ce pays) et il a prononcé alors ces paroles « Je jure solennellement que je soutiendrai et défendrai la Constitution des États-Unis contre tous ennemis, externes ou intérieurs, que je montrerai loyauté et allégeance à celle-ci, que je prends cette obligation librement, sans aucune réserve intellectuelle ni intention de m’y soustraire et je m’acquitterai bien et loyalement des devoirs de la charge que je m’apprête à prendre. Que Dieu me vienne en aide. ». A t’il des trous de mémoire ou simplement ne se sent-il engagé par rien ?
A la question de savoir, s’il veut concourir à un troisième mandat, ce qu’il n’a pas le droit de faire, il répond :
« C’est quelque chose que, à ma connaissance, vous n’avez pas le droit de faire. Je ne sais pas si c’est constitutionnel qu’on vous empêche de le faire ou autre chose. »
A plusieurs reprises Trump a évoqué un troisième mandat. Ses conseillers lui ont certainement dit qu’il ne pouvait pas le faire, d’où sa réponse. Mais soit il ne leur pas demandé pourquoi, ce qui parait tout de même surprenant ou plus vraisemblablement il l’a oublié.
La réponse juridique est que le président des États-Unis est limité à deux mandats en vertu du 22e amendement de la Constitution américaine, adopté en 1951. Cette limitation a été mise en place après les 4 mandats du président Franklin D. Roosevelt qui est mort lors de son dernier mandat en pleine guerre mondiale.
Au milieu du chaos créé par cet homme sans qualité, ses attaques répétées contre la science sont aussi inquiétantes que son désir impérialiste. Pourquoi la science peut elle être ainsi attaquée sans qu’il n’y ait de réactions du plus grand nombre. La médecine, l’augmentation de l’espérance de vie, la conquête spatiale, la technologie qui nous rend la vie plus confortable et plus facile doivent tout à la science et rien au dieu qu’invoque tant de croyants dans le monde et nombre de supporters de Trump..
J’ai trouvé particulièrement intéressant un entretien diffusé sur ARTE : « Un livre pour ma vie : Yuval Noah Harari » dans lequel l’historien israélien et auteur de « Sapiens » était invité à citer les livres qui ont compté dans sa vie.
Et il a parlé de la difficulté de notre espèce avec la science.
Les humains se nourrissent de récits, récit religieux, récit nationaux, récit mythologique. C’est ainsi qu’ils expliquent le monde :
« Les humains sont ces animaux conteurs d’histoires. On pense en histoires. C’est plus facile, pour nous. Quand on lit des livres récents sur la mécanique quantique qui tentent d’expliquer le fonctionnement physique du monde, ou des livres de biologie cellulaire ou de génétique, c’est tellement compliqué.
Nos cerveaux ne sont pas vraiment évolués ou adaptés pour penser en ces termes. C’est pour cela qu’il faut passer des années à l’Université et s’appuyer sur des équations mathématiques complexes. Et même comme ça, ça reste à distance. En fait, il est très difficile d’intégrer ce que ça signifie parce que nos cerveaux ne fonctionnent pas comme ça.»
Les humains sous estiment certainement la complexité de la pensée scientifique. Harari trouve cependant que la Science exprime beaucoup plus de créativité et quand il la compare à la mythologie il souligne le côté trivial et simpliste de cette dernière :
« Quand je pense à la science et à la mythologie, ce qui me frappe c’est que la science est bien plus imaginative, tumultueuse et surprenante que n’importe quel mythe créé par les humains.
La majeure partie de la mythologie humaine ne fait que reprendre les scénarios élémentaires de nos vies personnelles en les amplifiant.
Donc les dieux de la mythologie grecque sont en fait une famille qui se querelle. Et le genre de dispute qu’on entend petit entre son père et sa mère, on les lit dans la mythologie avec Zeus et Héra lorsqu’ils se disputent ou punissent les enfants. Cela va même jusqu’au fondement le plus profond de la mythologie judéo-chrétienne plus récente. Presque toute l’identité juive repose sur le fait de dire qu’on est les enfants préférés de Dieu. C’est tout. Dans toutes les familles les enfants se disputent pour ça. […] Des nations entières construisent leur identité à partir de cette histoire. »
 Il explique de manière aussi simple la mythologie chrétienne. Son art de d’éclairer ce récit me fascine :
Il explique de manière aussi simple la mythologie chrétienne. Son art de d’éclairer ce récit me fascine :
« On peut penser aussi aux théologiens chrétiens. Ils expliquent ce qu’est l’enfer. D’un côté, ils disent que les démons vous font rôtir dans le souffre et le feu pour des millions d’années.
Mais à un niveau plus profond, ils disent que l’enfer, c’est être exclu, déconnecté de Dieu. C’est ce que les enfants craignent le plus, comme tout jeune mammifère, de perdre le contact avec leurs parents. Parce que si la progéniture d’un mammifère, d’un être humain, d’un chimpanzé ou d’un dauphin, perd le contact avec sa mère ou avec ses parents, il meurt. Personne ne les nourrit, personne ne prend soin d’eux. On peut donc rapprocher toute cette mythologie chrétienne de la simple idée d’un enfant perdu qui réclame ses parents. »
Et il poursuit en montrant que ces ressorts de la mythologie chrétienne tente d’expliquer le monde, l’univers, mais que dans ce domaine, ils atteignent vite des limites. J’aime beaucoup l’ironie de Harari qui explique que les récits des humains sont motivés par le fait qu’ils sont des mammifères et que s’ils appartenaient à d’autres espèces, les mythologies devraient certainement être revues :
« En ce sens, la mythologie est très profonde émotionnellement. Mais en termes de compréhension de l’univers, elle a quelque chose de très superficiel. En effet, elle ne fait que prendre nos scénarios biologiques déterminés par l’évolution, ces histoires d’enfants et de familles, d’amitiés et les amplifie jusqu’à penser : l’univers entier fonctionne comme ma famille. L’univers entier fonctionne comme notre village.
 Mais les choses comme la mécanique quantique contredisent cela. Il y a certains morceaux de l’univers, comme la vie biologique des mammifères, qui fonctionnent comme cela, mais ce n’est pas le cas de la majorité de l’univers.
Mais les choses comme la mécanique quantique contredisent cela. Il y a certains morceaux de l’univers, comme la vie biologique des mammifères, qui fonctionnent comme cela, mais ce n’est pas le cas de la majorité de l’univers.
Dès qu’on s’éloigne des mammifères, si on passe aux reptiles l’histoire est déjà totalement différente. Prenons la tortue. Vous avez cette image de la maman tortue qui sort de l’océan. Elle creuse un trou dans le sable, elle y pond ses 40 ou 50 œufs. Elle rebouche le trou, puis retourne dans l’eau, et voilà ! Voilà ce que Freud aurait à gérer s’il soignait des tortues. Parce qu’il n’y a plus aucun lien ensuite entre la mère et ses petits. Ce n’est pas un mammifère. Elle n’allaite pas ses petits, ne les protège pas, rien. […] Donc quelle serait la mythologie des tortues ?
Toute cette peur de la mythologie chrétienne celle d’être exclu par son père, n’a aucun sens pour les tortues. Et cette obsession juive du père qui nous aime plus que tous les autres, n’a aucun sens pour les tortues. »
Il rappelle aussi que ces mythologies sont très présentes dans les conflits d’aujourd’hui et nous savons que lorsque les religions entrent dans les guerres, c’est rarement signe de paix….
« Certaines guerres actuelles, comme celle dans mon pays… La guerre entre les Israéliens et les Palestiniens est toujours alimentée par ce scénario biologique et mythologique qui veut qu’on soit les enfants préférés de Dieu. Pour les deux camps.»
La science nous laisse froid dit-il, il n’y a pas d’intrigue mais des formules mathématiques. Cela ne fait pas de belles histoires.
« Ce qui diffère chez nous des lapins et aussi des éléphants et des chimpanzés, c’est qu’avec la langue on peut créer des histoires.Nous avons une imagination incroyable,mais les scénarios de base sont toujours les mêmes. [Ils] sont toujours limités par notre biologie de mammifères.
On a donc des mythologies complexes, des poèmes, des films et des séries télé, mais quand on examine l’intrigue, elle découle en fait de la biologie. […]
et on raconte des histoires et des histoires, avec des variations, mais ce sont les mêmes intrigues basiques.
La science fonctionne en dehors de ces intrigues. La mécanique quantique n’est pas un scénario biologique. C’est tellement différent de tout ce qu’on connaît.[…]
Mais grâce aux mathématiques et aux ordinateurs, on arrive à s’en approcher d’une certaine manière. Une immense partie du monde est construite à partir de ces théories et modèles scientifiques.
Mais psychologiquement et politiquement, ils nous laissent complètement froids.
Il est très difficile d’inciter des gens à faire quoi que ce soit en leur disant que E = MC2, ou en leur montrant des équations de mécanique quantique.»
Nos histoires, nos récits peuvent être dévoyées et source d’aveuglement et de conflits. Il cite Poutine et aussi le conflit en terre d’Israël et de Palestine.
« Si on vous nourrit des mauvaises histoires, des mauvais mythes, 50 ans plus tard vous êtes Poutine. Cela peut mener à la mort et à la souffrance de millions de gens. Tout commence dans la tête. […]
On croit que les hommes se battent pour les mêmes raisons que les lapins et les chimpanzés, c’est à dire la nourriture ou le territoire. Mais ce n’est presque jamais le cas. […]
Dans le cas de mon pays, le conflit israélo-palestinien n’est pas lié au territoire. Il y a assez de terre entre la Méditerranée et la Jordanie pour construire des maisons et des écoles pour tous. Ce n’est pas lié à la nourriture. Il y en a assez. Il y a assez d’eau, d’énergie…
Mais les gens croient à des fantasmes, à des mythes, à des histoires qui sont incompatibles. Les deux camps le disent : Dieu nous a donné cette terre. On ne peut pas faire de compromis avec l’amour de Dieu. Pas de compromis avec les dons de Dieu.»
La science a du mal à être contée. Harari tente de le faire, certains s’en offusquent et lui reproche de prendre quelques fantaisies avec la rigueur scientifique. Lui explique qu’il tente pourtant de le faire parce qu’il sait combien le récit est important pour arriver à toucher le cœur et l’imagination des humains. Parler d’immigration est beaucoup plus simple, l’immigration mobilise tout de suite des récits archaïques qui font bouger les gens.
«Le grand problème de la science c’est que ce n’est pas une bonne conteuse. Ce sont les histoires qui motivent les gens à agir, pas les faits.
Quels sont les problèmes qui préoccupent les électeurs, aux États-Unis, en Europe et ailleurs dans le monde ? L’immigration est l’un des sujets qui arrivent en tête partout alors que beaucoup de gens nient le changement climatique. L’attrait pour l’immigration résulte d’un scénario biologique.
Un scénario selon lequel nous vivons dans une tribu et nous voyons quelqu’un d’une autre tribu arriver sur notre territoire. C’est quelque chose que les chimpanzés connaissent, tout comme les loups, les lapins …
Regardez ces lapins bizarres qui viennent manger notre herbe !.
Ils comprennent ça. C’est très profond. »
Je redonne le lien vers cet entretien qui est beaucoup plus riche que les quelques éléments que j’en ai tirés pour ce mot du jour : « Un livre pour ma vie : Yuval Noah Harari »

 Julien Blanc-Gras rappelle le contexte d’évolution ou d’explosion de ce métier qu’on trouve de l’autre côté de la rue :
Julien Blanc-Gras rappelle le contexte d’évolution ou d’explosion de ce métier qu’on trouve de l’autre côté de la rue : Et finalement, le livreur, dans ces temps particuliers de pandémie, se trouvent souvent très seul dans les rues de la ville et parfois dans des conditions climatiques compliquées.
Et finalement, le livreur, dans ces temps particuliers de pandémie, se trouvent souvent très seul dans les rues de la ville et parfois dans des conditions climatiques compliquées. Le monde numérique contrôle, cible, le livreur est cerné :
Le monde numérique contrôle, cible, le livreur est cerné :