[…] il y a fort à parier qu’une telle modernisation mettra [en France] un certain temps.»
Jeudi 30 avril 2015
[…] il y a fort à parier qu’une telle modernisation mettra [en France] un certain temps.»
L’expression complète de Mauroy est
« Pour la droite, la première liberté, c’est la sécurité. Nous inversons la proposition : pour nous, la première sécurité est la liberté. »
Sous le titre <« La sécurité est la première des libertés. » Ou l’inverse ?> Rue 89 a publié, le 23/04/2015, un article dont je cite ci-après quelques extraits :
« En 1981, quand Alain Peyrefitte faisait de la sécurité la première des libertés, Pierre Mauroy inversait la proposition. Depuis, la gauche, à commencer par Manuel Valls, a adopté cette posture hier affichée par le FN.
De la bouche d’un gaulliste à celle d’un Premier ministre socialiste. En passant par une affiche de Jean-Marie Le Pen, Marion Maréchal-Le Pen dans les bras, pour les régionales en Paca, en 1992. « La sécurité, première des libertés » est une formule qui a fait du chemin, avant d’être reprise par Manuel Valls le 13 avril, dans l’hémicycle, pour défendre le controversé projet de loi sur le renseignement. […]
Associée à la droite et l’extrême droite jusqu’aux années 90, l’expression n’est aujourd’hui plus du tout discriminante et constitue, comme le notait Libération en 2013 après une sortie d’Estrosi sur le sujet, « un poncif du débat public » depuis vingt ans. […] ainsi, au gaulliste Alain Peyrefitte, qui répète que « la sécurité est la première des libertés » lors de l’examen de sa loi « Sécurité et Liberté », le socialiste Pierre Mauroy rétorque, en mars 1981 : « Pour la droite, la première liberté, c’est la sécurité. Nous inversons la proposition : pour nous, la première sécurité est la liberté. »
La loi portée par Peyrefitte, alors garde des Sceaux, comprenait, selon ses détracteurs, 95 fois le mot « sécurité » et 5 fois le mot « liberté ». Ce débat – passionné – est généralement utilisé pour dater le début du débat « sécuritaire ». Ce mot entre d’ailleurs dans le vocabulaire au début des années 80. A l’époque, la gauche, vent debout contre la droite « liberticide », demande son abrogation lorsqu’elle arrive au pouvoir. C’était un engagement de campagne de Mitterrand (n° 52).
Là, comme dans tant d’autres domaines, la frontière entre la droite et les socialistes va tendre à s’estomper.
[…] la déclaration de politique générale de Jospin, le 19 juin 1997, affirmait : « La sécurité, garante de la liberté, est un droit fondamental de la personne humaine. » […]
Pour justifier cette pirouette sémantique, la gauche fait appel à la fameuse Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, texte révolutionnaire s’il en est, qui fait figurer la « sûreté » parmi les droits naturels et imprescriptibles de l’homme dans son article 2 : « Art. 2. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l’oppression. »
Mais sécurité n’est pas sûreté. L’ancien ministre de la Justice socialiste Robert Badinter le rappelle dans un entretien au Monde, en janvier 2004 : « Ce qui est consacré dans la Déclaration des droits de l’homme, c’est la sûreté, c’est-à-dire l’assurance, pour le citoyen, que le pouvoir de l’Etat ne s’exercera pas sur lui de façon arbitraire et excessive. Le droit à la sûreté, c’est la garantie des libertés individuelles du citoyen. »
[…] Bref, pas très malin pour les socialistes. D’ailleurs, les meilleures critiques de la formule, ce sont eux-mêmes, les socialistes. Ainsi, Jean-Jacques Urvoas, président PS de la commission des Lois, a un jour (lointain) écrit sur son blog : « C’est l’occasion pour moi de dire que je ne comprends pas le slogan répété à satiété selon lequel « la sécurité serait la première des libertés ». […] Si je suis de gauche, c’est d’abord parce que je veux vivre dans un pays libre ! […] Et s’il faut conjuguer la sécurité avec notre devise républicaine, alors affirmons que » la sécurité est la garantie de l’égalité « . Voilà le combat historique de la gauche ! »
[…] Manuel Valls lui-même, dans son livre « Sécurité : la gauche peut tout changer » (éditions du Moment), sorti en avril 2011, écrivait que « l’opposition affichée systématiquement entre sécurité et liberté [lui paraissait] toujours un peu creuse. » Tout en moquant : « Ceux qui tentent d’échapper à ce piège idéologique en affirmant, rapidement, que la sécurité est la première des libertés. »
Je trouve cet article particulièrement rafraichissant dans ses rappels historiques et aussi dans sa capacité à mettre nos gouvernants face à leurs incohérences et contradictions.
<486>
|
|
Et Jean-Paul Sartre a déclaré :
« Personnellement, j’ai pris parti pour des hommes qui n’étaient sans doute pas de ceux qui étaient mes amis au temps où le Vietnam se battait pour la liberté. Mais ça n’a pas d’importance, parce que ce qui compte ici, c’est que ce sont des hommes, des hommes en danger de mort. Et je pense que les Droits de l’Homme impliquent que tout homme doit entrer au secours de ceux qui risquent un danger de mort ou un danger de grand malaise. »
|
Les Turcs appelaient «restes de l’épée» (kiliç artigi) ces Arméniens, surtout des femmes et des enfants, qui ont échappé au génocide de 1915, enlevés ou protégés par des familles musulmanes. Le journaliste arménien de Turquie Hrant Dink parlait, lui, «d’âmes errantes» et a tenté, jusqu’à son assassinat à Istanbul en 2007, de retrouver cette mémoire engloutie, reconnaissant qu’en Turquie, «il est encore plus difficile de parler des vivants que des morts». Nul ne sait combien sont les descendants des rescapés restés en Anatolie orientale se cachant ou le plus souvent se convertissant à l’islam, tout en se fondant parmi les populations turque et kurde.
J’ai découvert cette terrible expression : « les restes de l’épée », c’est à dire ce qui reste quand on a passé « la plus grande partie au fil de l’épée » dans un documentaire de France 24 : Génocide arménien, le spectre de 1915.
Ce documentaire se focalise sur 3 destins :
Un absent, Hrant Dink qui fut assassiné, le 19 janvier 2007 à Istanbul, par un nationaliste turc. Il était turc arménien et l’a toujours su. Il a consacré sa vie à ce que le débat sur les massacres de 1915 s’ouvre en Turquie et que la Turquie et l’Arménie puissent se rapprocher. Le nationaliste turc qui voulait faire taire cette voix a échoué : 100 000 personnes, arméniens mais aussi turcs et kurdes ont assisté à ses funérailles en scandant « Nous sommes tous des Hrant Dink, nous sommes tous arméniens ». Cet assassinat a déclenché, dans la société civile turque, une vraie prise de conscience.
Le second destin est une femme : Fethiye Çetin, avocate. Elle fut l’avocate de Hrant Dink dans les procès que l’Etat turc a engagés contre lui. Elle ne se savait pas arménienne, elle a appris tard qu’elle faisait partie des « restes de l’épée », petite-fille d’une rescapée du génocide arménien.
Le troisième destin est celui d’un turc de haut lignage, journaliste et écrivain. Il devint l’ami de Hrant Dink. Il s’appelle Hasan Cemal.
Le mouvement jeunes turcs qui gouvernait l’empire ottoman en 1915 et a décidé du génocide, était dirigé par un triumvirat appelé les « Trois pachas ». : Talaat Pacha, Enver Pacha et Cemal Pacha.
Hasan Cemal est le petit fils du dernier. Dans le documentaire il raconte son long cheminement qui l’a amené à aller s’incliner devant le monument au génocide arménien d’Erevan et à reconnaître la réalité. Il dit que peu importe le nom qu’on donne à ces évènements mais ils étaient ignobles.
Il est bien sûr attaqué par les nationalistes turcs désormais, mais il poursuit sa route et dit
« Après avoir compris tout cela comment pourrais-je dire que mon grand-père était un homme bien, le pourriez-vous ? »
La fin du documentaire montre Fethiye Çetin arrivant à fédérer des turcs des kurdes et des arméniens pour restaurer un lieu historique : les fontaines du village où vivait sa grand-mère avant le génocide.
<Vous trouverez ici ce très beau documentaire de France 24>
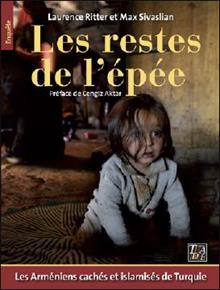
Le chemin de la reconnaissance des évènements par les turcs sera encore long, mais il est largement entamé notamment par la société civile.
<484>
Les arméniens du Monde commémorent le génocide de leur peuple ce 24 avril, car le 24 avril 1915 le ministre de l’intérieur Talaat Pacha du gouvernement Jeunes-Turcs donne l’ordre de l’arrestation des intellectuels arméniens. L’opération débute à 20 heures à Constantinople. Dans la nuit du 24 au 25 avril 1915, 235 à 270 intellectuels arméniens sont alors arrêtés, en particulier des ecclésiastiques, des médecins, des éditeurs, des journalistes, des avocats, des enseignants, des artistes et des hommes politiques dont des députés au parlement ottoman.
Le mot du jour est un propos qu’a tenu le Sénateur Barack Obama en 2007, le Sénateur pas le Président. Car bien qu’il s’y soit engagé lors de sa campagne présidentielle, Barack Obama n’a pas fait reconnaître le génocide par les Etats Unis. Il est allé en visite officielle en Turquie, sans dire un mot de ce sujet.
Lors d’un rendez-vous hebdomadaire du « Breakfast briefing » organisé par les Sénateurs de l’Illinois, l’Armenian National Committee of America (Comité de Défense de la Cause Arménienne aux Etats-Unis) est intervenu pour interroger le Sénateur Barack Obama, sur la question du Génocide Arménien. Une intervenante a demandé s’il allait s’engager à défendre la résolution reconnaissant le Génocide Arménien (S. Res. 106). A cette question le Sénateur Obama a répondu :
« Pour ceux qui ne sont pas au courant, il y a eu un Génocide qui s’est déroulé contre le peuple arménien. C’est l’une de ces situations où l’on a vu un déni constant d’une part du gouvernement turc ainsi que d’autres, c’est ce qui a eu lieu. C’est devenu un sujet diplomatique douloureux… ».
 La vidéo est là : <Obama parle du génocide arménien>
La vidéo est là : <Obama parle du génocide arménien>
Mais les Etats-Unis ne veulent pas fâcher la Turquie et restent donc très prudent.
Nous restons dans le déni, le négationnisme du génocide par la Turquie.
Mais pourquoi ?
Ces massacres ont été perpétrés par le gouvernement jeune-turc qui a été renversé par Mustapha Kemal. La Turquie Kémaliste pourrait donc reconnaître ce crime commis par d’autres. Les allemands parlent du crime des nazis et non du crime des allemands. Les turcs pourraient tenter cette même dissociation entre les jeunes turcs et la Turquie d’aujourd’hui.
Remarquons qu’en ce moment ce n’est plus le parti créé par Atatürk qui est au pouvoir mais le parti religieux d’Erdogan qui a pris le pouvoir contre le parti des Kemalistes.
Mais rien n’y fait, sur ce plan il y a continuité, la Turquie continue à nier, parlant de massacre, d’initiatives individuelles. L’objectif dans cette thèse n’était pas l’élimination du peuple arménien, mais simplement son éloignement des zones de combat qui se trouvaient en territoire arménien, parce que des arméniens auraient trahi l’empire Ottoman et se seraient alliés aux Russes. La déportation était donc un acte de sécurité nationale.
Cette thèse est balayée par des ordres qui ont été écrits par des membres du gouvernement, démentie par des témoignages notamment d’allemands alliés des ottomans rapportant des propos de leurs interlocuteurs. En outre, la trahison des arméniens en 1915 est aussi un mensonge
Les jeunes turcs comme plus tard les kémalistes étaient des nationalistes turcs. Ils voulaient d’abord à l’intérieur de l’empire ottoman puis, après son effondrement dans l’Etat turc, créer une nation turque pure et nettoyée des peuples chrétiens de l’empire qui ne rentraient pas dans ce projet. Car si on parle du génocide arménien, il y eut d’autres massacres de chrétiens à cette période à l’intérieur de l’empire ottoman, notamment les chrétiens syriaques. L’empire ottoman comptait 20% de chrétiens, aujourd’hui selon wikipedia il y a 0,4 % de chrétiens dans l’Etat turc.
Les kurdes n’étaient pas non plus turcs, mais ils étaient musulmans et ont beaucoup participé aux massacres des arméniens. Par la suite Atatürk a voulu en faire des turcs cela n’a pas fonctionné. Aujourd’hui encore les kurdes de Turquie sont en lutte contre l’Etat.
Un Etat nation turc, voilà ce qu’Atatürk et les jeunes turcs partageaient.
Le traité de Sèvres du 10 août 1920 qui met fin à l’empire Ottoman, évoque les massacres arméniens et des réparations.
Mais si l’empire Ottoman a perdu la guerre, la Turquie de Mustapha Kemal va la gagner contre les grecs et les alliés fatigués laisseront faire. Atatürk ne reconnaîtra jamais le traité de Sèvres et obtiendra le Traité de Lausanne en 1923, beaucoup plus avantageux. Dans ce traité il n’est plus question des arméniens et de leur massacre.
Quand des arméniens survivants voudront revenir en Anatolie où ils vivaient depuis des siècles, la Turquie Kémaliste refusera de leur délivrer un passeport turc : ils ne font pas partie de la nation turque et l’Etat nation choisit qui sont ses ressortissants.
Si Atatürk n’a pas été à l’origine du génocide, celui-ci a bien aidé ses objectifs nationalistes. Reconnaître le génocide serait aussi mettre en cause la structure même de l’Etat nation turc, sans parler des réparations que cela pourrait entrainer et l’abandon d’une fiction car il y avait d’autres peuples en Anatolie que le peuple turc.
Je suis beaucoup plus savant sur ce sujet depuis que j’ai écouté les 4 émissions de la Fabrique de l’Histoire de France Culture consacré à ce fait historique
Il y a aussi ce site remarquable consacré entièrement à ce sujet : http://www.imprescriptible.fr/
Devant cette horreur, cette fracture de notre humanité, il reste une bonne nouvelle : le génocide a échoué : le peuple arménien, la culture arménienne ont survécu et ont essaimé dans le monde.
<483>
Avouons que nous avons tous, d’abord un peu honteux, regarder des séries américaines. Et même nous y avons pris goût.
Nous n’osions le dire mais cela nous plaisait.
Maintenant nous pouvons nous rassurer.
De grands esprits, des philosophes, des universitaires et même des critiques de cinéma du Cahier des Cinémas, nous expliquent qu’il s’est passé un « truc » aux Etats Unis où est né un nouvel espace créatif qui est devenu un phénomène artistique de premier plan, un art majeur.
Si nous aimions, c’est parce que ce sont de vrais œuvres d’art dont certaines même sont géniales.
Il y a maintenant sans cesse des classements pour savoir quelle est la série la plus remarquable :
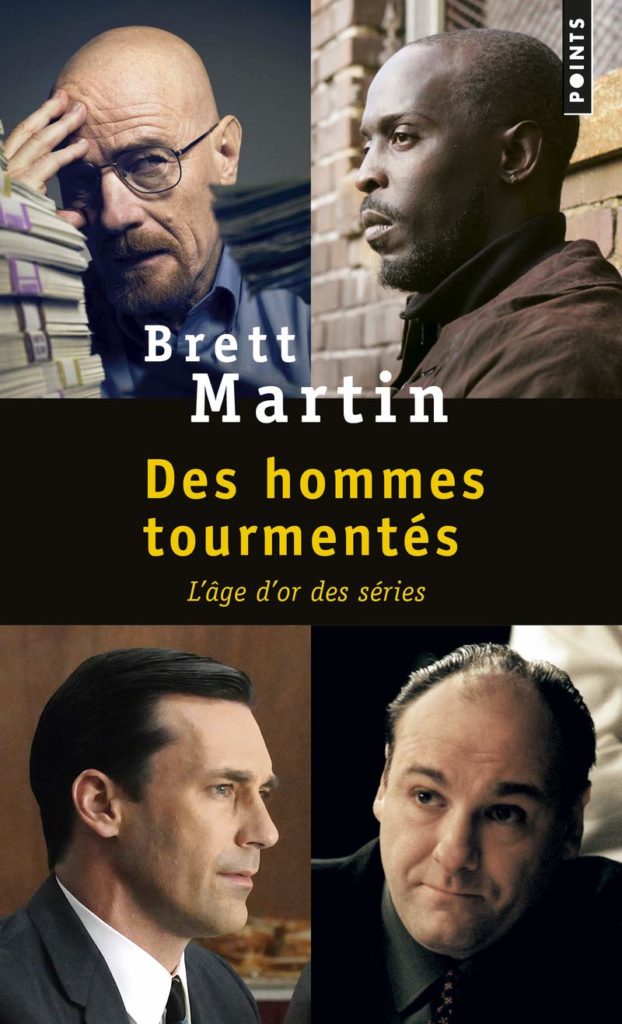 Brett Martin dans son ouvrage <Des hommes tourmentés> raconte cette histoire et parle de l’âge d’or des séries américaines, pour être plus précis, il parle du 3ème âge d’or.
Brett Martin dans son ouvrage <Des hommes tourmentés> raconte cette histoire et parle de l’âge d’or des séries américaines, pour être plus précis, il parle du 3ème âge d’or.
Il était l’invité de Nicolas Demorand <Hommage aux antihéros des séries américaines avec Brett Martin>
Il raconte cette révolution de la télévision américaine.
Avant les années 2000, la télévision était le cimetière des ambitions artistiques.
C’était un désert de platitude où régnait la publicité où il ne fallait pas froisser les annonceurs, les grandes marques étaient très conservatrices. Il fallait des héros positifs, des intrigues claires, avec des bons et des méchants et où à fin le bon devait toujours gagner.
C’est surtout une chaine de télévision Home Box-Office (ou HBO), chaîne de télévision payante qui va balayer tout cela.
C’était une chaine d’abonné sans publicité.
Cette chaîne a eu des patrons intelligents, intuitifs et téméraires pour croire et avoir foi en des artistes.
« Ce fut la source magique, faire confiance aux auteurs. » dit Brett Martin
Cela commence par « Les Soprano », histoire d’un mafieux violent mais dépressif et qui a des problèmes avec ses enfants adolescents.
Ils vont récupérer des cinéastes maudits, des scénaristes qui trainaient dans le milieu de la télévision sans jamais avoir eu la chance de se faire connaître et c’est avec eux qu’ils vont créer cet âge d’or.
Ces hommes tourmentés (les antis héros des séries) sont des hommes fragiles entre leur désir de faire le bien et leur tendance à faire le mal et un mal absolu.
Ces séries sont ouvertes et l’intrigue est inventée d’un épisode à l’autre.
Les personnages deviennent très complexes, le spectateur va suivre leurs évolutions pendant des dizaines d’heures et pas seulement 2 heures comme au cinéma.
Et pour que cela captive il faut de véritables auteurs comme David Simon (The Wire) ou Matthew Weiner (Mad Men).
On apprend qu’il a fallu sept ans à Matthew Weiner pour trouver un diffuseur à Mad Men.
Télérama décrit cette évolution :
« Une rage d’écrire autre chose, d’envoyer balader les codes et les bienséances, de rendre sa noblesse à un genre qui plante ses racines chez Dickens et Dumas, dans le feuilleton littéraire du XIXe siècle. Une envie, un besoin, qui renversera les logiques économiques classiques pour pousser HBO, FX, AMC et d’autres chaînes câblées américaines à développer des séries d’auteurs, à fouiller sans retenue la psyché humaine et les entrailles de la société contemporaine. »
Même les matins de France Culture s’y sont mis : <De Dallas à True detective la révolution des séries>.
Et les séries ont leur festival dont c’est la 6ème saison du 17 au 26 avril, donc en ce moment : < https://series-mania.fr/ > au Forum des images qui se trouve Forum des Halles.
Souvent dans l’Histoire, quand tant d’intellectuels émérites commencent à s’intéresser à un phénomène c’est qu’il touche à sa fin …
Mais Brett Martin pense que ce n’est pas encore la fin de l’âge d’or.
<481>
Simon Leys, nom de plume de Pierre Ryckmans, est un écrivain belge, né en 1935 et mort le 11 août 2014 en Australie.
Sa grande œuvre fut de dénoncer la Chine maoïste, son grand combat fut celui contre les intellectuels maoïstes qui étaient très nombreux à l’époque et qui ont tenté par tous les moyens de le dénigrer.
Il a eu cette phrase, mot du jour d’aujourd’hui, dans une émission Apostrophes de Bernard Pivot de 1983 où il dit que le plus grave ce n’est pas que des gens qui ont le pouvoir médiatique ou littéraire, énonce des contre-vérités mais le plus grave c’est qu’il existe de nombreuses personnes qui les croient et considèrent que c’est la vérité.
 En 1971, sous le pseudonyme de Simon Leys, il publia un essai, «Les Habits neufs du président Mao», dénonciation de la Révolution culturelle chinoise. Il sera immédiatement la cible d’une grande partie des intellectuels parisiens dont beaucoup étaient maoïstes.Il sera attaqué par la revue «Tel Quel» dont Philippe Sollers est un des principaux animateurs et également le journal «Le Monde».
En 1971, sous le pseudonyme de Simon Leys, il publia un essai, «Les Habits neufs du président Mao», dénonciation de la Révolution culturelle chinoise. Il sera immédiatement la cible d’une grande partie des intellectuels parisiens dont beaucoup étaient maoïstes.Il sera attaqué par la revue «Tel Quel» dont Philippe Sollers est un des principaux animateurs et également le journal «Le Monde».
A l’époque, il était assez isolé, soutenu cependant par des intellectuels comme Jean-François Revel et René Étiemble.
Ils étaient peu nombreux à avoir raison devant la cohorte de ceux qui considéraient la Chine de Mao comme un eldorado de la pensée et de l’accomplissement humain.Sartre, Foucault, Barthes, Kristeva étaient dans le camp des idiots.
J’ai choisi cette phrase comme mot du jour, parce que nous sommes le 17 avril 2015 et qu’il y a 40 ans : le 17 avril 1975, alliés de la Chine, les Khmers rouges entraient dans Phnom Penh.<Et vous lirez dans cet article de 2012 de l’Express le même aveuglement d’intellectuels, souvent les mêmes maoïstes, face aux -crimes des khmers rouges>
Les estimations des victimes varient entre 740 000 et 2 200 000 morts sur une population d’un peu moins de 8 000 000 habitants.Vous lirez les noms de ces intellectuels qui ont dit des idioties : Noam Chomsky, Jean Lacouture, Vergés, Serge July et bien d’autres.
Le Monde et la plupart des organes de presse, y compris Le Nouvel Observateur seront du mauvais côté.
La Une de Libération, le 17 avril 1975 s’intitule «Le drapeau de la résistance flotte sur Phnom Penh»
et quelques jours après «7 jours de fête pour une libération.»
Simon Leys, avait raison à l’époque contre beaucoup.
La question qu’il est légitime de se poser : quelles sont les idioties d’aujourd’hui ? et qui sont les Simon Leys ?
Les idiots devraient être plus faciles à reconnaître : on les voit souvent et ils parlent avec l’assurance de la vérité révélée.
<478>