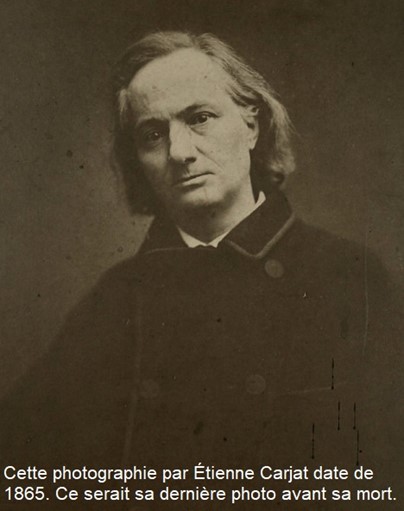« Me voilà prêt à pédaler pour vous nourrir ! »
Julien Blanc-Gras
Il parait qu’il suffit de traverser la rue pour trouver du boulot. Et il est exact que si on traverse la rue, il est possible de trouver un travail de coursier ou de livreur pour Uber eats ou deliveroo ou une autre plate-forme qui permet de gagner un peu d’argent mais au prix de beaucoup d’efforts et de renoncement.
Julien Blanc-Gras est journaliste et écrivain. Il est né en 1976 et a surtout écrit des récits de voyage. Son prochain livre, « Envoyé un peu spécial » doit paraître chez Stock le 27 avril. Le résumé de ce livre est le suivant :
« Tout peut arriver en voyage. Au fil de ses aventures dans une trentaine de pays, Julien Blanc-Gras raconte les galères et les instants de grâce, les no man’s land et les cités tentaculaires, les petits paradis et quelques enfers. On y rencontre un prêtre shintoïste et un roi fantasque, une star du cinéma nigérian et un écrivain américain, un gardien de phare et un héros national – parmi tant d’autres portraits qui peuplent ces récits et cette planète.
Sur une montagne sacrée du Népal ou sur une île déserte d’Indonésie, au fin fond du Kansas ou dans l’agitation de Kinshasa, Julien Blanc-Gras rend compte de notre époque sans jamais asséner, démontrer ou pontifier.
« En s’éloignant de chez soi, on se rapproche de l’universel. »
Julien Blanc-Gras a donc traversé la rue et pour la finalité d’un récit et d’un article dans « L’Obs » : < une semaine dans la vie d’un livreur Uber-Eats, par Julien Blanc-Gras > a exercé un boulot de livreur pendant une semaine.
Il raconte sa première course :
« Le jeune homme qui ouvre la porte est vêtu d’un slip. Un joli slip rouge, de bonne facture, propre. Rien d’autre. Je pensais, naïvement, qu’on se permettait d’ouvrir en petite tenue aux inconnus dans un seul cas de figure : un scénario de film porno. Mais il n’y a pas de caméra et l’homme en slip ne m’invite pas à entrer d’une voix enjôleuse. Il grommelle un vague « merci » quand je lui remets sa commande, avant de me claquer la porte au nez. C’est ma première course, et je viens de saisir l’essence de mon nouveau métier : le livreur, c’est celui qu’on croise (sur le pas de la porte) et qu’on ne regarde pas vraiment. »
 Julien Blanc-Gras rappelle le contexte d’évolution ou d’explosion de ce métier qu’on trouve de l’autre côté de la rue :
Julien Blanc-Gras rappelle le contexte d’évolution ou d’explosion de ce métier qu’on trouve de l’autre côté de la rue :
« Postez-vous à la fenêtre après 18 heures. Vous verrez le défilé permanent des deux-roues chevauchés par des êtres munis de sac siglés Deliveroo, Uber Eats ou Just Eat. Avec les confinements, les couvre-feux et la fermeture des restaurants, la livraison de nourriture à domicile s’est imposée dans nos vies urbaines. Deliveroo, présent dans 300 communes françaises, a annoncé une hausse de 64 % de son activité en 2020. Chez Uber, qui revendique 12,5 millions de téléchargements de son appli en France, les livraisons génèrent depuis l’été dernier plus de chiffre d’affaires que l’activité VTC. Ils seraient environ 60 000 à sillonner ainsi les artères de nos villes, petits globules transportant les protéines destinées à nos estomacs calés devant Netflix. »
L’écrivain journaliste s’est ainsi immergé dans ce travail pour pouvoir comprendre et témoigner. Après une formation succincte, sans jamais rencontrer un être humain, il va pouvoir commencer :
« J’installe mon téléphone sur le guidon du vélo, j’enfile mon casque et m’empare de mon sac 70 litres Uber Eats. Me voilà prêt à pédaler pour vous nourrir. Mon activité sera désormais dictée par l’algorithme, qui me géolocalise pour dénicher des courses à la rémunération prédéfinie, que je suis libre d’accepter ou pas. « Gagnez de l’argent à votre rythme », c’est la promesse. »
Les plateformes ont trouvé cet interstice pervers de notre droit de faire travailler, pour eux, des gens qui ne sont pas leurs employés. Et de cette manière, ils parviennent à externaliser des coûts, comme l’achat des outils de travail :
« De mon côté, j’ai été contraint d’acquérir le sac Uber Eats à 69,90 euros pour avoir le droit de travailler pour eux, tout en me transformant en publicité ambulante. »
Il y a bien sur les problèmes techniques : ne pas renverser les soupes dans le sac et puis outre les plateformes il y a la relation avec les fournisseurs de repas. Ces activités sont déployées dans une situation de compétition exacerbée et soumis aux notations sans compassion des utilisateurs :
« Je suis parti depuis moins de deux heures quand survient la première catastrophe : l’appli a pompé la batterie en un clin d’œil, mon téléphone tombe en rade en plein rush de midi.
« T’as le numéro de livraison ? me lance le manager du Subway sans dire bonjour.
– Attendez, j’ai un problème technique, désolé.
– Pfff… »
Dix secondes plus tard : « Bon, t’as trouvé ? » Le manager du Subway me tutoie et me rudoie, alors qu’on n’a pas gardé les sandwichs ensemble. Mon téléphone se réactive miraculeusement, me préservant d’un fiasco dès le premier jour, ce qui aurait immanquablement altéré ma note. Cette notation opérée par les clients tournoie comme une épée de Damoclès au-dessus du casque du livreur car « un taux de satisfaction de 90 % est requis pour pouvoir continuer à se connecter ». On n’a pas vraiment droit à l’erreur ni à la malchance. »
 Et finalement, le livreur, dans ces temps particuliers de pandémie, se trouvent souvent très seul dans les rues de la ville et parfois dans des conditions climatiques compliquées.
Et finalement, le livreur, dans ces temps particuliers de pandémie, se trouvent souvent très seul dans les rues de la ville et parfois dans des conditions climatiques compliquées.
« La première soirée met ma motivation à rude épreuve. La météo est apocalyptique, et je serais bien resté à la maison pour regarder PSG-Barça, mais une double commande de pizzas se présente. Une double commande, ça ne se refuse pas, il y en a pour 7,62 euros, c’est le jackpot. Je m’extirpe de mon doux foyer pour braver les trombes d’eau et les rafales de vent. Je pédale dans la nuit, où seuls mes congénères se déplacent. Plus une âme qui vive, encore moins qui travaille. Même les prostituées chinoises du boulevard de la Villette ont pris leur RTT, elles qui bossent le 25 décembre comme le 1er mai. Je suis trempé, j’ai froid, je mène ma mission à bien. Des gens comptent sur moi pour se gaver de junk-food à la mi-temps, je ne dois pas les décevoir. Une course chasse l’autre. Je tourbillonne autour de la place de la République, bien fournie en fast-foods, pendant que Kylian Mbappé élimine les Catalans. D’ordinaire pointilleux sur le respect du Code de la Route, je me surprends à griller les feux rouges et à rouler sur les trottoirs sans vergogne. En évitant l’accident, si possible. On a recensé au moins cinq livreurs décédés au travail en France depuis 2019. « Chez Uber, nous avons à cœur votre sécurité. » Chez le livreur, on a à cœur d’arriver à temps pour ne pas voir sa note baisser et ses revenus diminuer. Bilan du jour 1 : je suis resté en ligne, et donc disponible, pendant sept heures vingt-sept. J’ai effectué dix courses et récolté 46,49 euros (dont 2,27 de pourboires). »
Pour replacer ces montants dans un contexte connu : au 1er janvier 2021 le smic journalier pour 7 heures de travail en France, s’élèvent en brut à 71,75 € et en net à 56,77 €. Globalement sur sa semaine de travail, Julien Blanc-Gras a évalué sa rémunération à 3,74 euros de l’heure donc pour 7 heures de travail à 26,18 euros la journée en précisant : « J’ai parcouru une centaine de kilomètres dans Paris pour effectuer trente-deux livraisons en trente-cinq heures d’astreinte (durant lesquelles je n’ai refusé qu’une poignée de courses). »
La rémunération est calculée par un algorithme qui ajoute à l’incertitude qui pèse sur le travail du livreur :
« Les coefficients sont complexes à comprendre. Avant, la tarification était lisible. Désormais, ça manque de clarté. L’algorithme est opaque, dénonce Arthur Hay, secrétaire général du syndicat CGT des coursiers à vélo de Gironde (le premier du genre en France). Surtout, la rémunération est en baisse constante depuis des années. Il faut travailler une soixantaine d’heures par semaine pour vivre décemment.»
Quelquefois des clients marquent un élan de générosité, oserais-je dire d’humanité :
« Ce billet de 5 euros tendu par une jeune femme dans le Sentier m’a réchauffé le cœur après un trajet glacial. A l’usage, je constate qu’environ une personne sur six laisse un pourboire. »
Le livreur occupe, dès lors, une place centrale dans notre société de consommation et voit des comportements…
« Etre livreur, c’est disposer d’un poste d’observation furtif sur l’intimité d’une société sous pandémie. Il faut savoir que des gens commandent des Big Mac à 10 heures du matin. Je regarde l’adresse de livraison : elle se situe en face du fast-food, à moins de 20 mètres. Il s’agit sans doute d’une personne dans l’incapacité de se déplacer. Pas du tout, c’est une étudiante en pleine santé physique. Peur de sortir par crainte du virus ? Agoraphobie ? Dépression ? Ou, tout simplement, une bonne grosse flemme. Si les seniors, moins à l’aise avec les outils numériques, ne font pas partie de ma clientèle, les plus jeunes n’hésitent pas à se faire livrer trois fois rien. Dans la foulée, je vais récupérer des commissions chez Carrefour. Le sac est léger. Il ne contient qu’une baguette et un paquet de sucre. C’est tellement peu cher de se faire livrer, une poignée d’euros. Avec certaines formules d’abonnement, c’est même gratuit. Pourquoi se priver ? »
La toute-puissance de la plateforme, l’absence humaine dans les relations de travail nous emmène dans un monde sans sentiment, sans chaleur.
« Le lendemain, je néglige trois propositions de courses. Je reçois ce message : « Vous ne semblez pas avoir accepté de commandes depuis un moment. Vos commandes sont interrompues. » Sérieusement, l’algorithme ? Tu m’as fait poireauter deux heures sous la pluie hier et tu m’ostracises aujourd’hui parce que j’ai raté trois courses ? Sans même parler du fait que je trouve désormais naturel de m’engueuler à voix haute avec une machine.
A mon grand soulagement, je peux me reconnecter quelques minutes plus tard. J’ai l’impression d’avoir reçu un avertissement. « C’en est un, confirme Arthur Hay. Vous ressentez la pression de l’algorithme. La sonnerie, c’est l’ordre de réagir et de se mettre en mouvement. » La promesse de flexibilité semble avoir ses limites. « Ils n’ont pas le droit de nous virer parce qu’on refuse des commandes, mais ça arrive quand même. Des gens sont débranchés, sans explication, et ils ne peuvent plus travailler. » Quand Arthur a lancé un mouvement de grève pour dénoncer ces pratiques, son compte Deliveroo a été désactivé. « Je n’ai jamais eu de motif. Et c’est impossible de parler à quelqu’un. » Dur de lutter contre une adversité invisible. Parmi les revendications syndicales des livreurs se trouve donc celle-ci : pouvoir discuter avec un interlocuteur en chair et en os. »
 Le monde numérique contrôle, cible, le livreur est cerné :
Le monde numérique contrôle, cible, le livreur est cerné :
« D’autres types de messages me parviennent. Comme je figure dans la base de données, je reçois des publicités ciblées. « Découvrez nos partenariats réservés aux coursiers, Julien ! » Je bénéficie de « nombreuses offres exclusives ». « Un vélo à réparer, une facture à régler, les charges d’autoentrepreneur qui tombent au mauvais moment ? FinFrog propose une solution simple et rapide pour obtenir des microcrédits allant de 200 euros à 600 euros. La demande se fait en 5 minutes, 100 % en ligne. » Si on avait l’esprit mal tourné, on pourrait se dire que les plateformes optimisent la rentabilité d’une précarité qu’elles ont elles-mêmes organisée. »
Et avec tout cela les plateformes ne parviennent pas à gagner de l’argent même s’ils entrent en bourse et trouvent des investisseurs qui profitent des hausses des prix des actions : <Deliveroo annonce une perte de 261 millions d’euros> en 2020 avant son introduction en bourse. Un article plus ancien <Deliveroo, Uber Eats… toujours plus de clients sans gagner le moindre centime> explique la stratégie de ces nouveaux capitalistes.
Sa conclusion est touchante :
« On peut trouver du travail en traversant la rue, c’est vrai. Pour en vivre dignement, il faut toutefois traverser beaucoup, beaucoup de rues, en grillant quelques feux rouges au passage. Je rentre chez moi le mollet renforcé, les fesses endolories et le dos en compote. Pas le courage de me mettre à cuisiner. Je vais commander à manger. »
Voilà la société de la consommation simple comme un clic. Il faut toujours un prolétariat pour que la vie des consommateurs soit simple et peu onéreuse. Un prolétariat qui doit discuter avec des machines.
<1558>

 Je ne suis pas encore arrivé à finaliser la page de mots du jour consacrés à Camus et écrit en novembre 2020, mais je m’y emploie.
Je ne suis pas encore arrivé à finaliser la page de mots du jour consacrés à Camus et écrit en novembre 2020, mais je m’y emploie.
 Le 24 avril 2015 je citais Barack Obama : «
Le 24 avril 2015 je citais Barack Obama : « 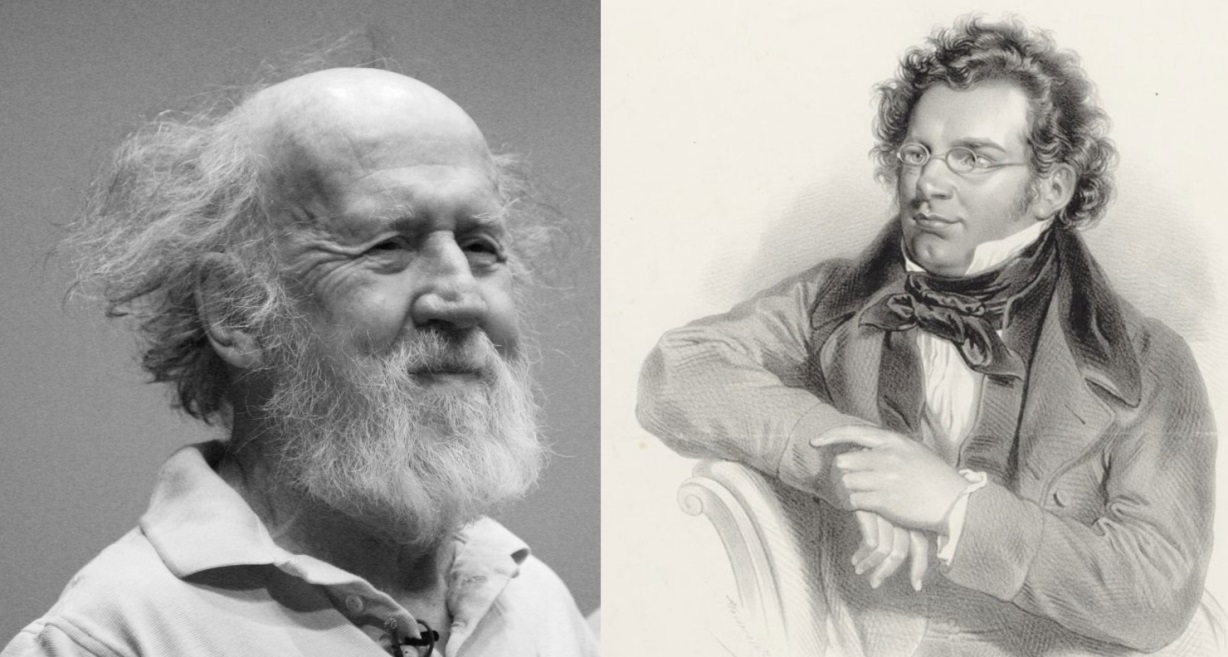
 Julien Blanc-Gras rappelle le contexte d’évolution ou d’explosion de ce métier qu’on trouve de l’autre côté de la rue :
Julien Blanc-Gras rappelle le contexte d’évolution ou d’explosion de ce métier qu’on trouve de l’autre côté de la rue : Et finalement, le livreur, dans ces temps particuliers de pandémie, se trouvent souvent très seul dans les rues de la ville et parfois dans des conditions climatiques compliquées.
Et finalement, le livreur, dans ces temps particuliers de pandémie, se trouvent souvent très seul dans les rues de la ville et parfois dans des conditions climatiques compliquées. Le monde numérique contrôle, cible, le livreur est cerné :
Le monde numérique contrôle, cible, le livreur est cerné :