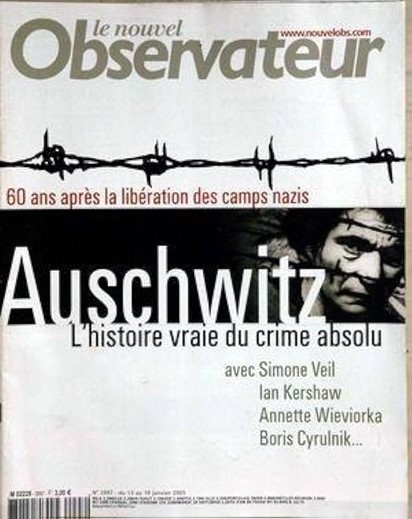« La chute infinie des soleils. »
Pièce de théâtre écrit par Elemawusi Agbedjidji
Avec Annie nous sommes allés, le 17 janvier, au Théâtre des Célestins, à Lyon, voir « La Chute infinie des soleils », écrite et mise en scène par Elemawusi Agbedjidji. Cette pièce sera jouée jusqu’au 27 janvier.
C’est un spectacle qui mêle le récit d’un naufrage, au XVIIIème siècle, avec celui d’un étudiant étranger, en France, qui tente de démontrer à un jury incrédule, lors d’une épreuve universitaire que cette histoire ancienne mérite d’être racontée et étudiée, parce qu’elle parle de nous et de notre humanité. La pièce mêle vérités historiques et fictions.
La scénographie est épurée et seul deux comédiens un homme et une femme se trouvent sur le plateau.
Avec une grande sobriété de moyens, la pièce de théâtre touche juste, et « tape avec le cœur sur le cœur » selon une expression de Christian Bobin.
Le récit historique nous apprend que dans la nuit du 31 juillet au 1er août 1761, une frégate, de la Compagnie française des Indes, « L’utile » fait naufrage près d’une minuscule ile qui s’appelait alors « l’ile des sables », elle porte désormais le nom d’« île de Tromelin »
 Elle a une superficie de 1 km², le tour de l’île fait 3,7 km et le point culminant se situe à 7m au-dessus du niveau de la mer.
Elle a une superficie de 1 km², le tour de l’île fait 3,7 km et le point culminant se situe à 7m au-dessus du niveau de la mer.
Elle se situe dans l’Océan Indien et se trouve à 436 km à l’est de Madagascar et à environ 560 km au nord des îles de La Réunion et de Maurice
A cette époque, la France et l’Angleterre se combattent au cours de la « guerre de Sept Ans »..
La frégate Utile a été envoyée à Madagascar pour ravitailler les colonies.
Le navire a notamment pour mission de ravitailler l’île Maurice qui portait alors pour nom « l’île de France ». Cette île affronte une sévère famine en raison de la surpopulation d’esclaves. Pour cette raison, le gouverneur Antoine Marie Desforges-Boucher interdit temporairement leur commerce sur les terres qu’il administre (les îles de France et Bourbon, actuellement Maurice et La Réunion).
Mais ce trafic rapportant des sommes considérables, des marins se mettent à leur compte.
Ainsi le capitaine de l’Utile, Jean de La Fargue, malgré l’interdit, fait embarquer 160 esclaves malgaches afin de les revendre à Rodrigues pour sa fortune personnelle.
Ce trafic explique non seulement la route empruntée par le marin français (beaucoup plus au nord que la voie connue), mais aussi sa volonté d’expédier son chargement au plus vite, quitte à risquer le naufrage. Il navigue de nuit.
« La Libre Belgique » a consacré une page documentée sur ce drame
« Nous sommes le 31 juillet 1761, il est 22h20. La nuit est noire, la mer houleuse. Seuls quelques officiers et l’homme de barre sont encore sur le pont de l’Utile […]. Malgré les conditions de navigation difficiles, le bateau suit les ordres du capitaine, Jean de Lafargue, et fait route vers l’est. Le matin-même, une dispute avait éclaté entre le capitaine et son second, Barthélémy Castellan du Vernet, au sujet de la direction à prendre. Chacun, muni d’une carte différente, redoutait de passer trop près de l’Ile des Sables, un îlot d’un kilomètre carré dont la position n’était pas connue avec certitude. Buté, le capitaine Jean de Lafargue avait refusé d’écouter son second. Il en était sûr : la carte fournie par la Compagnie française des Indes Orientales était plus précise que celle, plus récente, dessinée par un vieux loup de mer. Le capitaine avait donc tué toute mutinerie dans l’œuf en déclarant d’un ton autoritaire que le cap resterait inchangé. […] »
Le navire va se fracasser contre la barrière de corail qui entoure l’île :
« En quelques secondes, des cris se firent entendre. Des hurlements de désespoir venant aussi bien des hommes d’équipage de toutes nationalités que des esclaves noirs, enfermés dans les cales du navire, piégés derrière des portes clouées. Castellan se mit aussitôt à distribuer des ordres. Son but : garder son bateau à flot jusqu’à ce que le soleil se lève. Durant dix longues heures, il fit son possible pour l’empêcher de tanguer. Malheureusement, il ne pouvait lutter contre les forces de la nature. Aux alentours de huit heures du matin, le 1er août 1761, le navire se brisa en deux, jetant à la mer des hommes désespérés, Blancs et Noirs, pour la plupart incapables de nager. Beaucoup périrent noyés ou déchiquetés contre les rochers. Mais, comme une lumière au bout du tunnel, l’un d’eux aperçut une minuscule île. A peine eut-il crié « Terre en vue » que tous les survivants usèrent leurs dernières forces pour rejoindre les côtes. Cette île de sable qui avait tant effrayé l’équipage et qui les avait fait sombrer était maintenant devenue leur seul espoir de survie.
Durant cette catastrophe, personne ne vit le capitaine Jean de Lafargue, dont l’Histoire nous apprendra qu’il était resté caché dans les toilettes du navire, sans doute occupé à se demander comment tout cela avait pu arriver. Plusieurs facteurs pouvaient en effet expliquer ce naufrage mais, à chaque fois, le capitaine avait sa part de responsabilité. Ainsi, si le bateau avait respecté sa mission de départ, il n’aurait même jamais emprunté cette route chaotique. »
Sur les 140 membres d’équipage, 18 périssent avant d’atteindre la rive, il en reste donc 122.
 Pour les esclaves noirs le bilan est beaucoup plus catastrophique, sur les 160 qui se trouvaient sur le bateau, il n’y a que 88 survivants. Comme l’Utile n’est pas taillé pour le transport d’esclaves, les cales sont clouées chaque soir pour éviter toute révolte. Cette nuit-là, les prisonniers ne doivent leur délivrance qu’à la violence de la houle, qui brise le pont du navire en même temps que les portes de leurs geôles.
Pour les esclaves noirs le bilan est beaucoup plus catastrophique, sur les 160 qui se trouvaient sur le bateau, il n’y a que 88 survivants. Comme l’Utile n’est pas taillé pour le transport d’esclaves, les cales sont clouées chaque soir pour éviter toute révolte. Cette nuit-là, les prisonniers ne doivent leur délivrance qu’à la violence de la houle, qui brise le pont du navire en même temps que les portes de leurs geôles.
Le capitaine a sombré dans la folie, il est incapable d’organiser le sauvetage. C’est désormais son premier lieutenant, Barthélémy Castellan du Vernet, qui mène les opérations. Après une brève reconnaissance de l’île, ce dernier s’aperçoit que la terre qu’il foule n’abrite ni arbre ni eau douce. L’épave de l’Utile représente quasiment l’unique ressource de l’île. Durant les trois premiers jours, le rationnement décrété par les Français entraîne le décès d’une trentaine d’esclaves, privés d’eau potable.
« Au bout de quelques jours, les survivants entament la construction d’un puits de 5 mètres de profondeur qui leur offrira de l’eau saumâtre, de l’eau de mer dont la majorité du sel est filtré par le corail. Une fosse commune est également creusée afin d’y enterrer les corps des Noirs morts de soif. »
Le lieutenant aura l’idée de construire un bateau pour sortir de cet enfer. Il sera construits en 57 jours par une équipe essentiellement composée par les esclaves venues de Madagascar.
Mais il était trop petit pour emmener tout le monde.
Qui va partir ?
Question naïve : les blancs, ceux qui n’avaient pas participé à la construction du bateau de secours.
Castellan promet aux noirs de venir les rechercher.
Ils vivront, mourront et certaines survivront pendant 15 ans, le temps qu’un bateau vienne les chercher.
Dans le texte de la pièce de théâtre, l’auteur met les paroles suivantes dans la bouche de l’actrice :
« Cela fait 4 018 tombés de soleils dans le lointain depuis que le capitaine s’en est allé sur le dos de l’océan jusqu’à derrière la porte fine de l’horizon. 4 018 jours que l’espoir est né. Aujourd’hui, il s’est consumé dans la courbe infinie des couchers de soleil en même temps que tu quittais, nous quittais »
Pendant 15 ans, tous les jours ils ont vu le soleil se coucher sur cette ile inhospitalière.
D’où le titre de la pièce : « La chute infinie des soleils. »
Pour la défense du lieutenant, l’histoire retient qu’une fois sur la terre ferme, Castellan demande l’autorisation au gouverneur de l’île Maurice d’aller secourir les esclaves. Mais le gouverneur refuse d’affréter un bateau pour des esclaves qu’il leur avait interdit de transporter. Après plusieurs tentatives, Castellan renonce et décide de retourner en France. Tout le monde oublie ces naufragés, sans doute morts mais qui en fait attendent toujours du secours. Mais en 1773, un navire passant à proximité de l’île les repère et les signale de nouveau aux autorités de l’île de France. Un bateau est envoyé mais ce premier sauvetage échoue, le navire n’arrivant pas à s’approcher de l’île. Un an plus tard, un second navire, La Sauterelle, ne connaît pas plus de réussite. A partir de ce moment, il faudra encore trois ans pour organiser le sauvetage. Ce n’est qu’au bout de quinze ans le 29 novembre 1776, qu’un bateau viendra enfin les sauver pour de bon. Celui du chevalier de Tromelin qui donnera d’ailleurs son nom à cette île. Malheureusement, il ne trouvera vivants que sept femmes et un bébé de 8 mois.
<Wikipedia> nous apprend que
« En arrivant sur place, Tromelin découvre que les survivants sont vêtus d’habits en plumes tressées et qu’ils ont réussi, pendant toutes ces années, à maintenir un feu allumé grâce au bois provenant de l’épave, l’île étant dépourvue d’arbres. Les survivants sont recueillis par Jacques Maillart du Mesle, intendant de l’île de France, qui les déclare libres (ayant été acquis illégalement, ils ne sont pas considérés comme esclaves et n’ont donc pas à être affranchis) et leur propose de les ramener à Madagascar, ce qu’ils refusent, au motif qu’elles y seraient « esclaves des autres Noirs ». Maillart décide de baptiser l’enfant Jacques Moyse (Moïse), le jour même de son arrivée à Port-Louis le 15 décembre 1776 de renommer d’office sa mère « Ève » (alors que son nom malgache était Semiavou qui se traduit par « celle qui n’est pas orgueilleuse ») et de faire de même avec sa grand-mère qu’il nomme « Dauphine » d’après le nom de la corvette qui les a secourues. Le trio est accueilli dans la maison de l’intendant sur l’île de France. […]
Condorcet plaidant l’abolition de l’esclavage dans son ouvrage Réflexions sur l’esclavage des nègres, paru en 1781 sous nom d’emprunt, relate la tragédie des naufragés de Tromelin afin d’illustrer l’inhumanité de la traite »
Aujourd’hui, l’île Tromelin est une île de l’océan Indien administrée par la France au sein des îles Éparses de l’océan Indien, entité rattachée aux Terres australes et antarctiques françaises. Ces îles sont revendiquées par Madagascar, indépendant depuis 1960 et par l’ile Maurice, indépendant depuis 1968.
En 1947, l’île commence à intéresser les autorités françaises à des fins de météorologie tropicale pour la surveillance des cyclones tropicaux. La direction de la météorologie nationale française, suivant une demande de l’Organisation météorologique mondiale, installe le 7 mai 1954 une station météorologique permanente qui détruit les derniers vestiges des naufragés de Tromelin.
Premier président de la République à le faire, le Président Macron a visité, le 23 octobre 2019, la plus grande île de l’Archipel « La Grande Glorieuse » <pour parler de biodiversité> mais aussi pour répéter que ces îles sont la France :
« Ici c’est la France, c’est notre fierté, notre richesse. Ce n’est pas une idée creuse. Les scientifiques et militaires qui sont là le rappellent. La France est un pays archipel, un pays monde […] On n’est pas là pour s’amuser, mais pour bâtir l’avenir de la planète. Ce que nous préservons ici aura des conséquences sur les littoraux, y compris dans l’Hexagone. »
Cette déclaration <a fortement déplu> à Madagascar.
Mais, il faut comprendre que ces iles représentent une richesse économique considérable. Par exemple L’îlot Tromelin permet de revendiquer le contrôle de 280 000 km² de zone économique exclusive (ZEE), ce qui fait de la France l’État contrôlant le plus vaste espace maritime au monde avec, au total, 11,7 millions de kilomètres carrés de ZEE. Concrètement, la ZEE permet notamment le contrôle des droits de pêche et d’exploitation d’éventuelles autres ressources. Un enjeu de taille pour une telle surface.
Je ne connaissais pas cette histoire, mais elle a depuis de nombreuses années suscitée l’intérêt et divers travaux.
La première fût une expédition archéologique « Esclaves oubliés » menée par Max Guérout, ancien officier de la marine française et directeur des opérations du Groupe de recherche en archéologie navale et Thomas Romon, archéologue à l’Inrap, a lieu d’octobre à novembre 2006. L’expédition sonde l’épave de L’Utile et fouille l’île à la recherche des traces des naufragés dans le but de mieux comprendre leurs conditions de vie pendant ces quinze années.
Selon Max Guérout, chef de la mission, « En trois jours, un puits de 5 mètres de profondeur est creusé. Cela représente un effort considérable. » « On a retrouvé de nombreux ossements d’oiseaux, de tortues, et de poissons. » « L’arrivée de ces naufragés a dû causer une véritable catastrophe écologique pour l’île. »
Des soubassements d’habitations fabriquées en grès de plage et corail sont également mis au jour (les survivants transgressèrent ainsi une coutume malgache selon laquelle les constructions en pierre étaient réservées aux tombeaux. On retrouva aussi six gamelles en cuivre réparées à de nombreuses reprises et un galet servant à affûter les couteaux. Le feu du foyer est maintenu pendant quinze ans grâce au bois provenant de l’épave, l’île étant dépourvue d’arbres.
D’autres expéditions suivirent cette première.
Wikipedia nous apprend ainsi que cette histoire a inspiré le livre « Les Naufragés de l’île Tromelin » d’Irène Frain paru en 2009.
En octobre 2010, les éditions du CNRS et l’INRAP ont publié « Tromelin : L’île aux esclaves oubliés », un ouvrage scientifique destiné au grand public, rédigé par Max Guérout et Thomas Romon.
Parue en 2015, la bande dessinée Les esclaves oubliés de Tromelin de Sylvain Savoia raconte de façon croisée le naufrage et la vie des rescapés sur l’île Tromelin et l’expédition de fouille de 2010.
 Il existe de nombreuses ressources sur Internet :
Il existe de nombreuses ressources sur Internet :
Deux vidéos d’une heure environ :
Un documentaire de 2013 de TV5 Monde <Les esclaves oubliés de l’île Tromelin>
Une conférence du 18 février 2019 au Musée de l’homme : <Tromelin : Bilan des recherches archéologiques>
Et ces pages d’information :
« France Info » : «Tromelin, l’île des esclaves oubliés » une exposition au musée de l’Homme à Paris, en février 2019.
Un article très détaillé de « Ouest France » : « Le tragique destin des esclaves oubliés de l’île Tromelin »
« L’INRAP » : Un dossier thématique conçu en lien avec l’exposition « Tromelin, l’île des esclaves oubliés » présentée au Château des ducs de Bretagne – musée d’histoire de Nantes, du 17 octobre 2015 au 30 avril 2016.
« Geo » : <Tromelin : comment des esclaves naufragés ont survécu pendant 15 ans sur une île déserte>
Une page de « Radio France » : « L’histoire des esclaves oubliés de Tromelin en quelques images »
Il y a bien sûr la Page consacrée au spectacle du Théâtre des Célestins : <La chute infinie des soleils>
Le livre de cette pièce a été publié aux <éditions théâtrales>
<1787>

 Cécile Coulon explique dans la grande Librairie :
Cécile Coulon explique dans la grande Librairie :