«Je n’avais pas du chagrin, j’étais le chagrin»
Philippe Lançon, « Le Lambeau », page 211
« Le Lambeau » est le livre dans lequel le journaliste Philippe Lançon, rescapé du massacre de Charlie Hebdo, raconte sa longue et douloureuse épreuve pour retrouver un visage regardable et une sérénité suffisante pour continuer à vivre, après tant de violences et tant d’amis perdus.
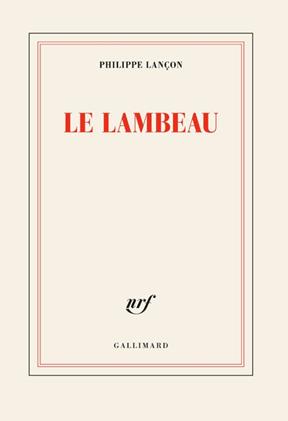 J’ai entendu Philippe Lançon parler de son livre dans deux émissions
J’ai entendu Philippe Lançon parler de son livre dans deux émissions
Sur France Inter l’interview de Léa Salamé : « Les victimes de Charlie Hebdo sont avec moi plus qu’ils ne l’ont jamais été de leur vivant »
Et sur France Culture dans l’invité des matins : «Après « Charlie », vivre et écrire». Dans cette émission il a dit :
« Écrire ce livre est un acte de mémoire sous forme de récit. Le livre fait partie d’une expérience, l’accompagne, lui donne sens et d’une certaine façon la conclut en essayant de la sublimer […] J’avais un problème de sensation à la mémoire. Je ne le sentais plus. C’est comme si j’avais oublié l’homme que j’étais auparavant. De la même façon que les nerfs, la mémoire revient d’une manière particulière dont j’ai essayé de faire le récit. »
Philippe Lançon était, en janvier 2015, journaliste littéraire à Libération et chroniqueur à Charlie Hebdo.
Dans l’équipe de « Charlie », il est avec Bernard Maris l’un des défenseurs de Michel Houellebecq, qui publiait ce même 7 janvier son livre « Soumission » dans lequel l’écrivain imagine un Premier ministre musulman à la France.
La veille, Philippe Lançon a accompagné une amie au théâtre pour assister à la pièce « La Nuit des rois », de William Shakespeare.
Ce matin du 7 janvier, Philippe Lançon est indécis. Passera-t-il d’abord par « Charlie » ou « Libération », dont il est salarié ? A Libération, il devait écrire une critique de la pièce de théâtre à laquelle il a assisté. Il décide que finalement ce sera « Charlie ». La conférence de rédaction est commencée. Les finances sont au plus bas. Depuis l’affaire des caricatures de Mahomet, le journal est « isolé ». Mais l’équipe ne cède rien à sa liberté de débattre. Et lorsque la mort surgit, il est justement question de l’abandon des banlieues, devenues ou non le nid d’un islamisme radical à la violence aveugle.
Il décrit les instants avant l’attaque :
« Il y avait une sorte de brioche devant Cabu. Wolinski dessinait sur son carnet tout en regardant d’un air amusé tel ou tel intervenant. Fabrice Nicolino n’avait pas encore entamé l’une de ses tirades nerveuses et mélancoliques contre la destruction écologique du monde. La voix de crécelle tonitruante d’Elsa Cayat a retenti, suivie d’un immense rire sauvage, un rire de sorcière libertaire. J’aimais beaucoup Elsa. Tignous dessinait peut-être. Il dessinait parfois pendant la conférence, toujours quand elle était finie. J’aimais le regarder travailler : un vieil enfant trapu et concentré, appliqué, lent, les épaules lourdes, un artisan. (…) Bernard Maris était sans doute resté à Charlie, ces dernières années, pour la même raison que moi : parce qu’il s’y sentait libre et insouciant. Ici, on disait ou l’on criait beaucoup de choses vagues, fausses, banales, idiotes, spontanées, on les disait comme on se dérouille le corps, mais, quand la sauce prenait, l’imagination suivait. Ce matin-là comme les autres, lecteur, l’humour, l’apostrophe et une forme théâtrale d’indignation étaient les juges et les éclaireurs, les bons et les mauvais génies, dans une tradition bien française qui valait ce qu’elle valait, mais dont la suite allait montrer que l’essentiel du monde lui était étranger.» »
La scène de l’attentat, longue d’une soixantaine de pages, est presque insoutenable à lire. Les balles des frères Kouachi lui ont arraché la mâchoire, l’ont défiguré, en ont fait une gueule cassée. « Blessure de guerre » a dit le pompier qui le transportait.
« J’étais maintenant à terre, sur le ventre, les yeux pas encore fermés, quand j’ai entendu le bruit des balles sortir tout à fait de la farce, de l’enfance, du dessin, et se rapprocher du caisson ou du rêve dans lequel je me trouvais. Il n’y avait pas de rafales. Celui qui avançait vers le fond de la pièce et vers moi tirait une balle et disait « Allah Akbar ! » Il tirait une autre balle et répétait encore « Allah Akbar ! »
Il était assis à côté de Bernard Maris, avec lequel il blaguait peu avant le massacre. Il se décrit comme dédoublé pour prendre conscience de la réalité :
« « Bernard est mort », m’a dit celui que j’étais, et j’ai répondu, oui il est mort, et nous nous sommes unis sur lui, sur le point de sortie de cette cervelle que j’aurais voulu remettre à l’intérieur du crâne et dont je n’arrivais plus à me détacher, car c’est par elle, à ce moment-là, que j’ai enfin senti, compris, que quelque chose d’irréversible avait eu lieu. […] Combien de temps ai-je regardé la cervelle de Bernard ? Assez longtemps pour qu’elle devienne une partie de moi-même. […] Je ne sentais pas le sang, dans lequel je baignais pourtant, je n’avais même pas encore vu le mien, mais j’entendais le silence, je n’entendais même que ça.»
Et il ajoute :
« Les morts se tenaient presque par la main. Le pied de l’un touchait le ventre de l’autre, dont les doigts effleuraient le visage du troisième, qui penchait vers la hanche du quatrième, qui semblait regarder le plafond, et tous, comme jamais et pour toujours, devinrent dans cette disposition mes camarades »
Et il raconte sa sidération :
« Etais-je, à cet instant, un survivant ? Un revenant ? Où étaient la mort, la vie ? Que restait-il de moi ? Je ne pensais pas ces questions de l’extérieur, comme des sujets de dissertation. Je les vivais. Elles étaient là, par terre, autour de moi et en moi, concrètes comme un éclat de bois ou un trou dans le parquet, vagues comme un mal non identifié, elles me saturaient et je ne savais qu’en faire. Je ne le sais toujours pas… »
Il vivra un incertain et long parcours médical avec une hospitalisation à la Pitié-Salpêtrière, puis à l’hôpital des Invalides, avec dix-sept interventions chirurgicales qui vont permettre à la cicatrisation de ses blessures, et surtout à la patiente reconstruction du tiers inférieur de son visage, détruit par un projectile,
« Ma mâchoire inférieure ayant disparu, on avait greffé à la place mon péroné droit, accompagné d’une veine et d’un bout de peau de jambe qui, sous le nom de palette, me tenait lieu de menton ».
Ce chemin de souffrance et de doute, il en viendra à bout accompagné par la lecture de livres qui puisent au plus profond de l’humanité : Shakespeare, Proust, Thomas Mann et Kafka, de l’écoute de la musique de la paix, de l’équilibre et du divin : Bach, et aussi de la puissance et du réalisme de la peinture de Vélasquez.
Il conclut :
« Il m’avait fallu atterrir en cet endroit, dans cet état […] pour sentir ce que j’avais lu cent fois chez des auteurs sans tout à fait le comprendre : écrire est la meilleure manière de sortir de soi-même, quand bien même ne parlerait-on de rien d’autre ».
<TELERAMA> : décrit ce livre avec ces mots :
« Le Lambeau n’est pas un document sur la violence, encore moins sur le terrorisme, islamiste ou autre (« Je n’ai aucune colère contre les frères K, je sais qu’ils sont les produits de ce monde, mais je ne peux simplement pas les expliquer. Tout homme qui tue est résumé par son acte et par les morts qui restent étendus autour de moi. Mon expérience, sur ce point, déborde ma pensée… »). Il s’agit, au contraire, d’un livre empreint d’une grande, d’une admirable douceur, s’employant à sonder, sans culpabilité, « la solitude d’être vivant ». Un livre calme, déterminé, à l’image de son auteur et en dépit de l’omniprésence de la douleur physique et morale, de l’angoisse, à « ne pas faire à l’horreur vécue l’hommage d’une colère ou d’une mélancolie que j’avais si volontiers exprimées en des jours moins difficiles, désormais révolus ».
<La page culturelle de France Info> commente et encense cette œuvre :
« En écrivant « Le lambeau » Philippe Lançon, […] ne fait pas seulement le choix de l’écriture ET de la vie. Il dépose à nos pieds une offrande. En partageant avec nous par la littérature son expérience, il nous autorise à faire corps avec les victimes de l’indicible événement, et ainsi, nous donne la possibilité d’en faire le deuil. […]
Le livre de Philippe Lançon est une offrande, déposée au pied de tous ceux qui ont été touchés par les attentats et l’indicible violence, par la perte de ces figures qui les ont accompagnés comme des tontons, des frères, des amis, depuis l’enfance : l’indémodable bouille et les dessins grinçants de Cabu, les dessins de Wolinski que l’on regardait en cachette quand on était enfant, les unes de Charb, la voix de Bernard Maris sur France Inter le vendredi matin[…]
C’est le récit d’une reconstruction, dans lequel l’auteur rend un hommage bouleversant à l’univers de l’hôpital, et plus largement à un monde dans lequel on ne tire pas sur les gens parce qu’ils ont fait des dessins, mais dans lequel au contraire on met tout en œuvre pour réparer les vivants, avec une place, toujours et quoi qu’il arrive, pour l’humour, pour les blagues, et pour la dérision. Le livre de Philippe Lançon est écrit dans une langue magnifique, tendue comme une peau de percussion au début du livre, puis se relâchant au fil du récit, à mesure que l’étau se desserre, que se banalisent les événements, que la vie revient, au rythme d’une marche paisible au bras de la femme qu’il aime, même si la violence, tapie, peut surgir à nouveau.
En partageant son expérience Philippe Lançon fait don au lecteur de la possibilité d’intérioriser un événement d’une violence tellement sidérante qu’il n’était pas possible de s’en emparer, de le faire sien ou de le digérer (d’autres diraient d’en faire le deuil). Avec ce livre, en faisant du « Je » un « Nous », il autorise chacun à faire entrer en soi les disparus. Comment réussit-il cette prouesse ? En produisant de la littérature, tout simplement. Merci Monsieur Lançon. »
J’ai aussi puisé la matière de ce mot du jour, hormis les articles et émissions déjà cités :
Dans le « Parisien » : <Dans l’enfer de l’attentat de Charlie>
Dans « Libération » : «J’allais partir quand les tueurs sont entrés…»
Dans « La Croix » : «Philippe Lançon, le Lazare de Charlie Hebdo »
Dans l’émission du « Masque et la Plume » de France Inter : <Philippe Lançon bouleverse les critiques du Masque et la Plume>
Dans l’émission du « Ca peut pas faire de mal » de France Inter : <Emission du 10 novembre 2018>
Il y a aussi cette interview dans « Elle » : <Je n’ai pas éprouvé de colère, jamais>
J’en tire ces extraits :
D’abord le commentaire du magazine :
« C’est un livre extraordinaire que « Le Lambeau », un récit splendide sur une expérience atroce, une épopée dans une chambre d’hôpital, la traversée d’un revenant, du monde des morts vers celui des vivants. […] Avec une fluidité remarquable, une intelligence éblouissante, Philippe Lançon raconte comment la nature de l’événement a changé la sienne, au cours de mois d’hospitalisation à la Salpêtrière puis aux Invalides. On dévore ce livre comme « Guerre et Paix », on en est sorti renversé, comme de cette rencontre avec cet homme revenu des enfers.
Puis des réponses de Philippe Lançon
« Je n’ai pas éprouvé de colère, jamais. Pendant quelques mois après l’accident, cela peut sembler paradoxal, mais j’ai été au meilleur de ce que je pouvais être, dans l’ordre de la patience, de l’endurance et de la bienveillance. Je pense que les caractères sont comme des palettes de peintre, certaines couleurs ne sont jamais utilisées. Des traits de mon caractère ont connu une excroissance soudaine. Je ne m’en vante pas, c’était un réflexe vital. Aujourd’hui, je sens avec une certaine mélancolie que ces trois vertus s’amenuisent à mesure que je vais vers une vie normale. Mais j’en ai toujours plus qu’avant ! […]
Ma vie, mon métier, c’est lire et écrire. Comment pouvais-je restituer le bien que m’ont donné Chloé – la chirurgienne qui m’a opéré -, les soignants, mes amis, ma famille, sinon en en faisant des personnages ? Si j’avais été charpentier, je leur aurais fait des tables et des chaises. Mon frère a été infiniment proche, cette histoire nous a rendus jumeaux alors que cinq ans nous séparent. Il était mon interface avec l’extérieur, nous étions arrivés, sans paroles, à un point de compréhension extraordinaire, presque à la vitesse de la lumière, en tout cas à la vitesse de l’amour fraternel. On va croire que je raconte « Le Manège enchanté », mais c’est vrai. […]
Écrire des chroniques pour « Libération » m’a aidé à sortir de ma condition de malade, chacune était un ballon d’oxygène, c’était un acte vital. Le livre, c’était différent. […]
Cette expérience m’a également enlevé le goût de juger. »
Et je finirai par ce qu’il disait dans l’interview de Léa Salamé citée en début d’article :
« Dans Le Lambeau, Philippe Lançon rend aussi hommage à « sa » chirurgienne, Chloé, la femme qui lui a permis de se reconstruire. « Ce processus m’a appris que le patient est quelqu’un qui doit y mettre du sien, absolument, ce n’est pas un enfant ou un oiseau qui attend la béquée ».
Son nouveau visage, trois ans après l’attaque, « n’est pas si différent de ce qu’il était avant ». « Si je me regarde dans une glace ou sur une photo, c’est plus moi. C’est une vision psychologique, moi je sais que mon visage a changé mais c’est surtout à l’intérieur que j’ai changé ». »
<1188>
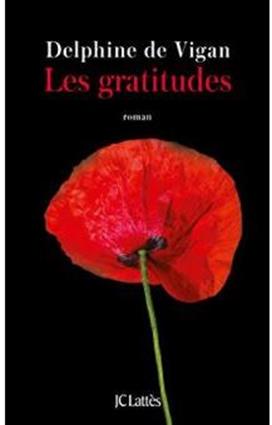 Michka est une vieille dame, qui vit désormais dans un Ehpad. Elle était dans sa jeunesse journaliste et correctrice. Mais maintenant elle perd le sens des paroles et des mots, le terme savant est «aphasie». Pourtant elle se souvient de son enfance où des personnes bienveillantes l’ont sauvé des gens qui voulaient lui faire du mal, parce qu’elle était juive. Elle n’a pas encore exprimé sa gratitude à leur égard et elle voudrait le faire.
Michka est une vieille dame, qui vit désormais dans un Ehpad. Elle était dans sa jeunesse journaliste et correctrice. Mais maintenant elle perd le sens des paroles et des mots, le terme savant est «aphasie». Pourtant elle se souvient de son enfance où des personnes bienveillantes l’ont sauvé des gens qui voulaient lui faire du mal, parce qu’elle était juive. Elle n’a pas encore exprimé sa gratitude à leur égard et elle voudrait le faire. « Un concept parfois très éloigné de nos sociétés, alors que paradoxalement, « merci est un des mots qu’on emploie le plus souvent » dans une journée, pour tout et n’importe quoi. « D’une manière générale on a plus de mal à nommer les choses, on est dans une méfiance, une suspicion sur les sentiments qui nous habitent. Exprimer sa gratitude, c’est accepter l’idée qu’on a besoin de l’autre. Dans une société comme la nôtre, c’est compliqué de dire à l’autre ‘sans toi je ne serai rien’. »
« Un concept parfois très éloigné de nos sociétés, alors que paradoxalement, « merci est un des mots qu’on emploie le plus souvent » dans une journée, pour tout et n’importe quoi. « D’une manière générale on a plus de mal à nommer les choses, on est dans une méfiance, une suspicion sur les sentiments qui nous habitent. Exprimer sa gratitude, c’est accepter l’idée qu’on a besoin de l’autre. Dans une société comme la nôtre, c’est compliqué de dire à l’autre ‘sans toi je ne serai rien’. »
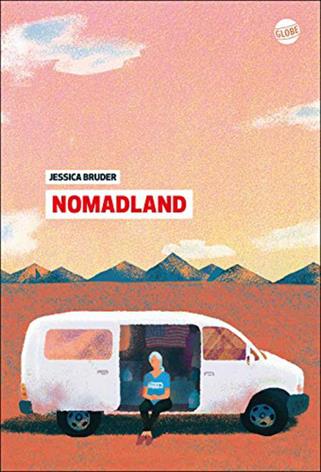

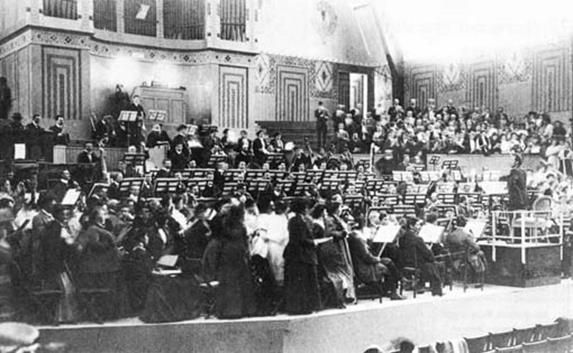


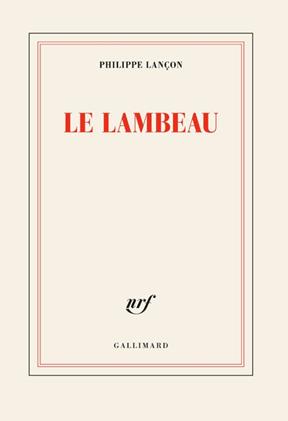



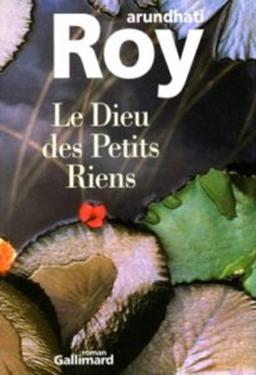 soleil.
soleil. politique et religieux, « on la traite de sympathisante terroriste, de communiste et de sécessionniste », souligne India Today.
politique et religieux, « on la traite de sympathisante terroriste, de communiste et de sécessionniste », souligne India Today.



 Le Racing Universitaire Algérois, voilà la grande affaire de Camus. « Je ne savais pas que vingt ans après, dans les rues de Paris ou de Buenos Aires (oui ça m’est arrivé) le mot RUA prononcé par un ami de rencontre me ferait battre le cœur le plus bêtement du monde », s’épanche-t-il un rien grandiloquent, contrairement à son habitude. S’il supporte le RC Paris, il n’y a d’ailleurs pas de hasard: « Je puis bien avouer que je vais voir les matchs du Racing Club de Paris, dont j’ai fait mon favori, uniquement parce qu’il porte le même maillot que le RUA, cerclé de bleu et de blanc. Il faut dire d’ailleurs que le Racing a un peu les mêmes manies que le RUA. Il joue ‘scientifique’, comme on dit, et scientifiquement, il perd les matchs qu’il devrait gagner », confie-t-il au journal du RUA, repris par France Football, à l’époque. Le mauvais sort de la ville lumière ne semble apparemment pas dater du PSG.
Le Racing Universitaire Algérois, voilà la grande affaire de Camus. « Je ne savais pas que vingt ans après, dans les rues de Paris ou de Buenos Aires (oui ça m’est arrivé) le mot RUA prononcé par un ami de rencontre me ferait battre le cœur le plus bêtement du monde », s’épanche-t-il un rien grandiloquent, contrairement à son habitude. S’il supporte le RC Paris, il n’y a d’ailleurs pas de hasard: « Je puis bien avouer que je vais voir les matchs du Racing Club de Paris, dont j’ai fait mon favori, uniquement parce qu’il porte le même maillot que le RUA, cerclé de bleu et de blanc. Il faut dire d’ailleurs que le Racing a un peu les mêmes manies que le RUA. Il joue ‘scientifique’, comme on dit, et scientifiquement, il perd les matchs qu’il devrait gagner », confie-t-il au journal du RUA, repris par France Football, à l’époque. Le mauvais sort de la ville lumière ne semble apparemment pas dater du PSG.