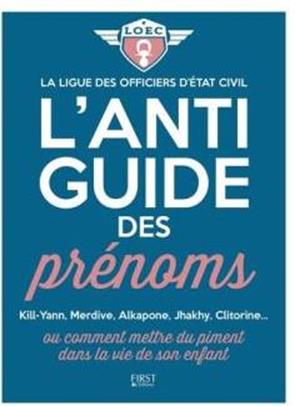«Les Hikikomori»
Phénomène japonais qui a tendance à s’étendre
France Culture a consacré deux émissions à la paresse. Grâce à la première j’ai appris l’existence des hikikomori : « Les Hikikomori, se retirer pour ne rien faire »
C’est un phénomène qui serait apparu au début des années 1990 au Japon et qui tendrait à s’étendre aux États-Unis et à l’Europe.
Les hikikomori décident soudain de se couper du monde pour une durée indéterminée, et de se murer dans leur chambre, avec l’objectif de suivre le modèle d’une vie idéale, passée à ne rien faire : aucune ambition, aucune préoccupation vis-à-vis de l’avenir, un désintérêt total pour le monde réel.
Selon cette émission le phénomène toucherait aujourd’hui, au Japon, près d’un adolescent sur cent.
L’origine du terme « hikikomori » (hiki vient de hiku (reculer), komori dérive de komoru qui signifie « entrer à l’intérieur ») traduit un repli sur soi.
Dans une société japonaise dans laquelle la réputation sociale et le culte de la performance sont très valorisées, ce phénomène met en présence un enfant qui entend se retirer de la pression sociale et des parents paralysés par la honte d’avoir à leur domicile un enfant qui n’assume pas son rôle social. C’est pourquoi souvent les parents cachent la réalité.
Si j’ai bien compris dans le lieu de résidence les interactions sociales entre les parents et l’enfant sont également très réduites.
Le jeune homme, car il s’agit essentiellement d’un phénomène masculin, reste reclus dans sa chambre et souvent s’enferme.
Mais depuis quelques années cette pathologie est reconnue au Japon, des médecins et psychologues analysent ces cas et tentent d’aider les jeunes reclus à sortir de leur condition.
Pour qu’on parle d’hikikomori il faut que la réclusion dure plusieurs mois. Selon ce que j’ai compris, on fixe la limite inférieure à 6 mois, mais la réclusion peut durer plusieurs années.
Une fois qu’on connait le mot hikikomori, on constate qu’il existe beaucoup d’articles et d’émissions qui ont été consacrés à ce phénomène.
 Il y a aussi un livre : « HIkikomori, ces adolescents en retrait » chez Armand Colin.
Il y a aussi un livre : « HIkikomori, ces adolescents en retrait » chez Armand Colin.
C’est un ouvrage collectif dans lequel sociologues, anthropologues, psychiatres, psychologues et psychanalystes essayent de décrire, comprendre et prendre en charge ce phénomène qui émerge
En 2015, un film « De l’autre côté de la porte » de Laurence Thrush a également été consacré à ce phénomène.
En 2018, une autre émission de France Culture : < Les hikikomoris ou le retrait du monde > expliquait :
« En 2016, c’était près de 600 000 personnes qui avaient fait le choix de renoncer au monde. Un chiffre qui pourrait rapidement atteindre le million, tant le phénomène prend de l’ampleur ces dernières années.
L’AFP a ainsi rencontré un de ces « retirants » -selon les termes de la sociologue Maïa Fansten, spécialiste du sujet en France- un certain M. Ikeida, nom d’emprunt donné au journaliste, âgé de 55 ans et qui vit reclus dans sa chambre depuis près de trente ans.
Et c’est surtout une grande souffrance qui transparaît de cet entretien. Une souffrance et une décision de rejeter les impératifs de conformité auxquels l’astreignent la société, son entourage, sa famille. Il explique ainsi la pression et les brimades de sa mère pour qu’il réussisse à l’école.
Il raconte aussi son parcours sans faute, des bancs de l’une des meilleures universités de Tokyo, aux offres d’emploi qu’il reçoit de la part de grandes entreprises prestigieuses. Il parle enfin du déclic, de sa terreur de passer une vie en costume, à exercer un métier dénué de sens, dans un système compétitif qu’il abhorre.
Au-delà de cette expérience personnelle, nombreux sont les témoignages de « retirants » qui expliquent leur choix comme un réflexe de défense, une réaction de survie face à l’intense pression du système scolaire et du marché du travail japonais.
Certains parlent ainsi d’une volonté de faire cesser le temps. De créer un abri, un repli face aux vicissitudes du monde. Une pause avant l’entrée définitive dans la vie adulte. C’est l’aboutissement paradoxal d’une société qui, en multipliant les injonctions à la vitesse, à la croissance et au progrès, finit par reléguer certains de ses membres dans un état de paralysie sociale et de retranchement hors du temps.
Cette faille creusée comme une grotte primaire, cette rupture temporaire pour se panser dans un monde mauvais, pourraient avoir quelque chose de poétique, si elles ne traduisaient pas dans le même temps, une profonde souffrance humaine, un sentiment d’inadéquation avec la société dans laquelle ils ont été projetés.
Une situation encore aggravée par les mutations de la famille japonaise. C’est en tout cas ce qu’explique le neuropsychiatre Takahiro Kato pour qui on est passé de la famille traditionnelle, qui comptait beaucoup d’enfants et de générations réunies sous le même toit, à une cellule familiale réduite : père, mère et enfant, réduisant d’autant les mécanismes de solidarité familiale.
Ainsi de nombreux hikikomoris résident chez leurs parents, faute de moyens financiers, mais aussi comme une manière de se construire un cocon, protecteur et familier, dans un espace connu. Mais cela n’améliore pas nécessairement la situation. Comme l’explique Rika Ueda, qui travaille pour une association de parents, « les familles éprouvent une grande honte. Elles préfèrent cacher leur situation et à leur tour s’enferment ».
Un isolement facilité selon les spécialistes par les nouvelles technologies. Ces dispositifs permettent de s’enfuir, de s’évader virtuellement, grâce à internet et aux jeux vidéos. Ces appareils permettent de maintenir des liens, aussi ténus soient-ils, par le biais de relations numériques. Une sorte d’évasion vers un monde alternatif, fait de sociabilités sans paroles, de présences sans rencontre. »
Un article plus ancien de la revue « Cerveau & Psycho » : <Hikikomori : ces jeunes enfermés chez eux> essaye d’analyser plus en profondeur le phénomène :
Il donne d’abord un exemple d’un jeune japonais de 23 ans, Tatsuya, qui vit enfermé chez soi :
« Il n’est quasiment pas sorti de sa chambre depuis trois ans. Fils unique, il habite un deux-pièces qu’occupent ses parents dans la banlieue de Tokyo. Il passe sa journée à dormir. Il mange les repas préparés par sa mère qui les dépose sur le pas de la porte de sa chambre, toujours fermée. Il se réveille le soir pour passer la nuit à surfer sur Internet, à chatter sur des forums de discussion, lire des mangas et jouer à des jeux vidéo. Il refuse de s’inscrire dans une école de réinsertion professionnelle ou de chercher du travail, et même de partir en vacances. L’an dernier, ses parents se sont décidés à l’emmener consulter dans plusieurs hôpitaux de la région qui, tour à tour, ont évoqué une dépression ou une schizophrénie latente. La scolarité de Tatsuya à l’école élémentaire s’est déroulée normalement, mais il a commencé à manquer l’école quand il est entré au collège. Se mêlant peu à ses camarades, il se plaint d’être moqué et même humilié. Malgré ces brimades, ses résultats scolaires sont bons et il poursuit une formation universitaire d’ingénieur. Il y a trois ans, il a subitement tout arrêté et, depuis, vit cloîtré à domicile.
Tatsuya souffre d’hikikomori, c’est-à-dire en français de « retrait social ». […] Selon les critères diagnostiques réactualisés en 2010 par le ministère de la Santé japonais, le hikikomori est un phénomène qui se manifeste par un retrait des activités sociales et le fait de rester à la maison quasiment toute la journée durant plus de six mois. Il n’y a pas de limite d’âge inférieure. Bien que le hikikomori soit défini comme un état non psychotique, excluant donc la schizophrénie, les autorités sanitaires admettent qu’il est probable que certains cas correspondent en fait à des patients souffrant de schizophrénie, mais dont le diagnostic de psychose n’a pas encore été posé.
Qu’est-ce que le hikikomori ? En réalité, la situation peut se présenter sous plusieurs formes. S’il arrive que l’adolescent ou le jeune adulte puisse rester totalement reclus pendant des mois, voire des années, il peut aussi accepter de sortir, le temps de faire des courses dans le quartier, même s’il replonge dans son isolement en se barricadant dans sa chambre de retour dans l’appartement familial. Il peut aussi lui arriver de sortir la nuit ou au petit matin, lorsqu’il est le moins susceptible de rencontrer des gens, en particulier des camarades ou des voisins. Dans de rares cas, le sujet hikikomori dissimule son état en quittant son domicile chaque matin pour se promener ou prendre le train comme s’il se rendait à l’école, à l’université ou à son travail. »
La relation de cet état avec une addiction au numérique n’est pas avéré. Il semblerait plutôt que c’est la situation de réclusion qui entraîne une consommation du Web, pour occuper le temps :
« Dans 20 pour cent des cas, la pathologie commence entre 10 et 14 ans et, dans plus d’un tiers des cas, elle débute vers la fin de l’adolescence, entre 15 et 19 ans. Les premiers signes d’absentéisme scolaire ou d’isolement peuvent apparaître dès 12 à 14 ans. En 2003, on a constaté que certains élèves refusant d’aller à l’école devenaient par la suite des hikikomori. […]
Loin des idées reçues et des stéréotypes qui voudraient que cyberdépendance et hikikomori soient associés, il apparaît que si les reclus, au Japon comme en France, passent souvent beaucoup de temps sur le Web, ils ne témoignent pas d’une « addiction à Internet ». Selon Nicolas Tajan, doctorant en psychologie à l’Université Paris-Descartes et chercheur à l’Université de Kyoto, surfer sur Internet n’est qu’une de leurs activités dans la mesure où ils regardent aussi la télévision passivement pendant des heures, lisent ou écoutent de la musique. Certains ne se connectent d’ailleurs pas à Internet. Toutefois, note N. Tajan qui étudie depuis deux ans le hikikomori dans l’Archipel, une dépendance semble de plus en plus fréquente chez les hikikomori japonais, une tendance également observée en France. Surtout, il semble que l’apparition d’une utilisation intensive d’Internet soit plus le résultat de la claustration à domicile qu’une cause du retrait social. En fait, selon le psychiatre Takahiro Kato, de l’Université de Kyushu, Internet et les jeux vidéo contribuent à réduire le besoin de communication en tête-à-tête avec ses semblables et créent un sentiment de satisfaction sans qu’il soit nécessaire de passer par des échanges directs.
Internet et les jeux vidéo facilitent donc la vie du hikikomori, plutôt qu’ils n’en sont la cause. Dans de très rares cas, observés tant au Japon qu’en France, le hikikomori met à profit cette très longue période d’enfermement à domicile pour se former sur Internet et acquérir de façon autodidacte un nouveau savoir, parfois encyclopédique, sur un sujet technique ou artistique. »
Cet article souligne le lien de cette pathologie avec la culture japonaise :
« Plusieurs particularités socioculturelles et anthropologiques de la société nipponne pourraient intervenir dans « l’épidémie » d’hikikomori. Selon T. Kato, un facteur clé associé à ce phénomène tiendrait au concept d’Amae, défini par le fait de chercher à être gâté et choyé par son entourage. Cela peut parfois inciter le jeune à se comporter de façon égoïste vis-à-vis de ses parents avec le sentiment qu’ils lui pardonneront son comportement. Il existe dans la culture japonaise une tolérance, voire une complaisance, de l’entourage vis-à-vis du hikikomori, d’autant que les jeunes Japonais (comme en Corée du Sud ou à Taïwan) ont tendance à dépendre, plus encore qu’en Occident, de leurs parents sur le plan financier.
Par ailleurs, le Japon se trouve être une « société de la honte ». Le concept de Haji imprègne profondément la société : honte d’avoir échoué, de déshonorer son nom, de ne pas avoir tenu ses engagements, de mettre les autres dans l’embarras. De fait, les parents éprouvent une grande honte d’avoir un enfant hikikomori et tardent à consulter un médecin. Par ailleurs, fait remarquer Maki Umeda, chercheur en santé publique au Département de santé mentale de l’Université de Tokyo, certains parents préfèrent encore que leur enfant soit un hikikomori plutôt que d’apprendre qu’il souffre d’une maladie psychiatrique ou d’un trouble du développement, ce qui entraînerait une forte stigmatisation. […]
À tout cela s’ajoutent les brimades (Ijime) que subissent certains élèves à l’école (harcèlement, intimidation, persécution). Enfin, serait également en cause l’intense pression du système scolaire. Les lycées et les universités sont très hiérarchisés, en fonction de la difficulté du concours d’entrée obligatoire, ce qui susciterait chez une fraction des jeunes une peur de l’échec conduisant au retrait social définitif. »
Mais ce phénomène n’est pas que japonais.
Ainsi « le Monde » avait publié un article <Des cas d' »hikikomori » en France> et plus récemment, en février 2019, « L’Express » s’interrogeait : <Reclus et sans projet: qui sont les Hikikomori français ?>
Le phénomène est désormais mondial : <Hikikomoris : du Japon aux Etats-Unis, vers une jeunesse évaporée>
Un article de janvier 2020 de « Sciences et Avenir » évoque des études qui élargissent le phénomène hikikomori à d’autres populations que les jeunes hommes :
« Mais, selon des experts japonais et américains de l’équipe de l’Oregon Health and Science University (Portland, Oregon, États-Unis), ce phénomène qui a désormais dépassé les frontières de l’archipel, serait plus répandu qu’on ne le pense et mérite de fait une définition plus claire, dans le but d’un meilleur repérage et d’une prise en charge adaptée.
Dans une publication récente dans la revue World psychiatry, ces scientifiques pointent un persistant manque de connaissance de ce tableau clinique par les psychiatres et souhaitent donc sensibiliser leurs pairs à sa détection, comme le précise l’auteur principal, le Dr Alan Teo. Ils estiment en effet que les adolescents et les jeunes adultes ne sont pas les seuls concernés et que le syndrome peut aussi démarrer bien après l’âge de 30 ans et concerner des personnes âgées ou aussi des femmes au foyer. »
J’ai trouvé un site français entièrement consacré à l’accompagnement des familles qui sont dans la situation d’héberger un hikikomori : <https://hikikomori.blog/>
Je finirai par ce conseil donné dans l’article de la revue « Cerveau & Psycho »
« Pour la psychiatre, le message essentiel à faire passer lors des visites à domicile auprès de ces jeunes qui vivent cette tragique situation d’enfermement est qu’« ils font toujours partie du monde des humains ». »
<1407>
 Guillaume Erner a invité Dominique Manotti, écrivaine, ancienne professeure de l’histoire économique du XIXe siècle parce qu’elle avait écrit un livre : « Le rêve de Madoff » paru en 2013 aux éditions Allia.
Guillaume Erner a invité Dominique Manotti, écrivaine, ancienne professeure de l’histoire économique du XIXe siècle parce qu’elle avait écrit un livre : « Le rêve de Madoff » paru en 2013 aux éditions Allia.
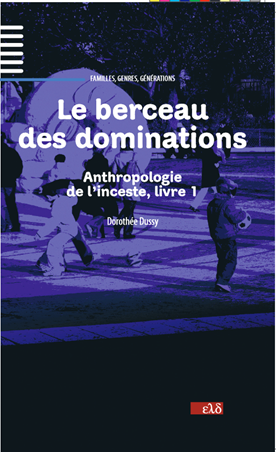







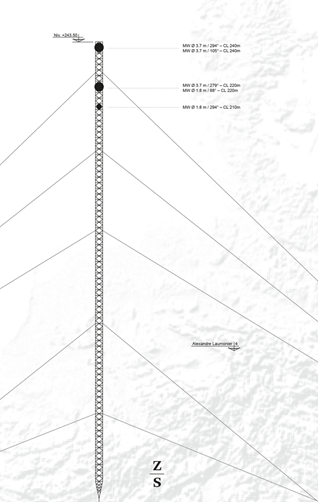




 A priori, ils ne veulent pas créer un parti politique :
A priori, ils ne veulent pas créer un parti politique :