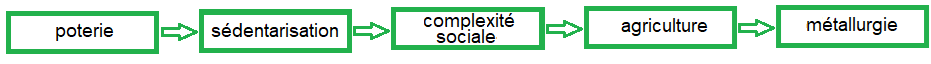Depuis longtemps Annie voulait que nous regardions ce film qui lui avaient été chaudement recommandé par des agriculteurs. Nous n’avons pas pu le voir en salle, nous nous y sommes pris trop tard. Le film est sorti le 25 septembre 2019. Mais nous avons trouvé le DVD et ce week-end prolongé fut l’occasion de le voir.
 C’est un choc, un moment d’émotion et de multiple questionnements.
C’est un choc, un moment d’émotion et de multiple questionnements.
Ce film a été réalisé par Edouard Bergeon. Il était journaliste à France 2, spécialisé dans le documentaire, quand il s’est lancé dans l’aventure de la réalisation d’un film, de ce film.
Il est né en 1982 et a grandi dans une ferme, près de Poitiers.
Le film « Au nom de la terre » est une fiction largement inspirée de faits réels qu’il a vécus avec son père, sa mère et sa sœur.
Son père a repris la ferme familiale.
Le contexte est celui d’une économie aux mains des industriels, de la grande distribution et du règne du prix bas.
Pour s’en sortir, il faut investir. Pour investir il faut s’endetter.
Quand la dette devient trop compliquée à rembourser, des coopératives, des banquiers ou des industriels viennent vous aider et vous envoie un commercial qui explique au paysan que pour s’en sortir, il faut encore industrialiser davantage, donc investir, donc s’endetter mais avec de beaux rendements qui rendront possible le remboursement de la nouvelle dette et des anciennes dettes.
Cette industrialisation conduit à produire une alimentation de plus en plus médiocre.
Il suffit d’un grain de sable, d’un accident et toute cette construction dévoile sa fragilité.
Dans le film, un violent incendie ravage une grande partie des installations productives dans la ferme. Edouard Bergeon explique que dans la vraie vie, celle de son père, il y eut plusieurs incendies.
C’est trop lourd pour le paysan, il n’a plus la force de continuer le combat.
La fin du film, comme la réalité est une longue déchéance, un état de désordre psychologique qui nécessite des soins psychiatriques et qui mènent finalement au suicide.
C’est une chose de lire dans un article de septembre 2019 que
« Ce serait plus de deux suicides par jour, selon les chiffres de la Mutualité sociale agricole parus cet été. Elle évoque 605 suicides chez agriculteurs, exploitants et salariés. […] On parle bien de surmortalité. Le risque de se suicider est plus élevé de 12,6% chez les agriculteurs. Et ce chiffre explose chez les agriculteurs les plus pauvres. On atteint 57% chez les bénéficiaires de la CMU. Deux activités sont particulièrement touchées : les éleveurs bovins et les producteurs laitiers ».
C’est une autre chose que de le vivre dans l’émotion d’une œuvre de fiction dont on sait qu’elle montre la réalité de la vie, des contraintes et du piège dans lequel sont attirés grand nombre de paysans.
Avant ce film, Edouard Bergeon avait réalisé un documentaire <Les fils de la terre> dans lequel il racontait déjà l’histoire de son père avec en parallèle le récit contemporain d’un paysan et de son père confrontés aux mêmes difficultés de l’endettement et des prix bas dans le cadre d’une ferme de vaches laitières.
 Le film est porté par des acteurs remarquables et notamment Guillaume Canet qui joue le rôle du père. Et lorsque Guillaume Canet, lui-même fils de paysan, découvre par hasard le documentaire « Les fils de la terre » en allumant sa télévision, il est immédiatement conquis et veut en faire une œuvre de fiction. Il est alors en tournage de « Mon garçon », produit par Christophe Rossignon. L’acteur dit alors à ce dernier qu’il aimerait adapter un long métrage de ce documentaire et qu’il souhaite le réaliser. Christophe Rossignon explique que ce projet est déjà en développement et qu’il va le produire et qu’Edouard Bergeon va le réaliser. Il accepte immédiatement de jouer le rôle du Père dans cette distribution.
Le film est porté par des acteurs remarquables et notamment Guillaume Canet qui joue le rôle du père. Et lorsque Guillaume Canet, lui-même fils de paysan, découvre par hasard le documentaire « Les fils de la terre » en allumant sa télévision, il est immédiatement conquis et veut en faire une œuvre de fiction. Il est alors en tournage de « Mon garçon », produit par Christophe Rossignon. L’acteur dit alors à ce dernier qu’il aimerait adapter un long métrage de ce documentaire et qu’il souhaite le réaliser. Christophe Rossignon explique que ce projet est déjà en développement et qu’il va le produire et qu’Edouard Bergeon va le réaliser. Il accepte immédiatement de jouer le rôle du Père dans cette distribution.
Lors de la sortie du film Guillaume Canet et Edouard Bergeon avaient été invités sur France Inter dans l’émission de Nicolas Demorand et Léa Salamé
Dans cette interview Edouard Bergeon a dit :
« Aujourd’hui, beaucoup d’agriculteurs souffrent, se battent : un tiers de nos paysans français gagnent moins de 350 euros par mois. Ce sont eux qui remplissent notre assiette, il ne faut pas l’oublier. Moi je me bats pour tous ces agriculteurs qui se battent pour survivre, pour nourrir la France, et pour tous ceux qui sont partis trop jeunes. Mon père est parti il y a 20 ans, il avait 45 ans, je crois que c’est un peu trop jeune. C’est pour cela que j’ai voulu réaliser ce film, qui n’est pas un documentaire, qui est un film de cinéma, où j’ai voulu filmer de beaux moments et magnifier la nature.
[…] J’ai voulu faire un film sur la transmission de la terre sur trois générations : le grand-père, le père, le fils. Moi je suis le fils. Le grand-père, c’est la génération des 30 glorieuses. Il faut produire, on travaille, on modernise et on gagne de l’argent. On créée des outils, on les transmet au fils… et là on arrive en 1992, l’économie de marché, le marché intérieur, la bourse de Chicago qui fixe tout, et on est obligé de se diversifier pour faire bouillir la marmite. C’est une catastrophe pour cette génération-là qui travaille toujours plus, qui perd son bon sens paysan.
Et puis il y a cette génération, la mienne. Moi je suis parti. Mon père m’avait dit : « Travaille bien à l’école et tu choisiras ton métier… » et « tu mérites d’avoir une vie meilleure que la mienne : ne sois pas paysan… »
J’avais des parents qui avaient compris qu’il fallait que l’école représente notre ascension sociale. Car eux n’avaient pas choisi leur métier ».
[…] Les agriculteurs français sont vraiment isolés, parce qu’ils sont très incompris aujourd’hui. Mon père souffrait de l’image qu’avait le grand public des agriculteurs.
disait qu’il en avait marre de ce métier, et il s’est isolé. Lui qui avait un caractère fort, il a plongé encore plus fort dans un mal-être. C’est pour cela qu’aujourd’hui nous soutenons une association qui s’appelle <Solidarité paysans>, qui fait un travail incroyable de veille et d’accompagnement des agriculteurs en détresse. »
Et Guillaume Canet a ajouté :
« On les traite d’empoisonneurs, aujourd’hui, alors que ce sont eux qui sont les premiers empoisonnés aussi.
[…] j’étais tombé sur le documentaire « Les fils de la Terre » qu’avait réalisé Edouard et qui m’avait bouleversé. Et parce que son histoire est bouleversante, celle de son père, de sa famille, mais ça allait au-delà de cela. J’ai lu aussi ce scénario comme un citoyen, comme un père de famille, et il est vrai que les causes environnementales me touchent et m’importent, mais là, on va au-delà de l’agriculture. Ce qui m’intéressait dans ce scénario, c’est qu’il n’oppose pas les agricultures, la traditionnelle à la biologique. Simplement, il y a un état de fait qui renvoie à des questions importantes où l’on est concerné nous, en tant que consommateur. On a tous une assiette devant nous. Et cette assiette, c’est notre santé. Il faut se poser la question de savoir si ce qu’on a dans notre assiette nous fait du bien. Une chose est évidente, c’est que tout le monde n’a pas le pouvoir d’achat et la possibilité d’acheter bio. Mais il y a aussi une autre agriculture plus raisonnée, plus courte et moins dangereuse pour la santé. »
[…] Et moi c’est ce qui m’a touché : le fait de me dire qu’il faut alerter la population, que des gens n’ont pas la possibilité de choisir ce qu’ils mangent, mais que beaucoup d’autres l’ont, ce choix-là. Qu’on peut consommer autre chose. Et surtout, qu’on arrête d’importer des produits de l’étranger qui sont souvent de la merde, alors qu’on produit en France des produits d’exception que l’on exporte. »
En février 2020, le site <Allo Ciné> annonçait que le film avait fait plus de 2 000 000 d’entrées. Mais on apprend aussi que ce succès est un succès en province, les parisiens ont plutôt boudé le film.
Il est donc possible de le voir en DVD ou sur une plate-forme qui permet de le télécharger ou de le regarder en ligne, ce qu’on appelle le VOD : vidéo à la demande.
Il n’est pas nécessaire de passer par les fourches caudines et américaines de Netflix mais un site indépendant français comme <Universciné> permet de faire la même chose.
D’ailleurs, les <Inrocks> proposent 8 plateformes dont celle-ci, alternatives à Netflix.
 Vous pouvez aussi voir <La bande d’annonce> du film.
Vous pouvez aussi voir <La bande d’annonce> du film.
Il y a aussi cet article de Sud Ouest : « « Au nom de la terre », un film coup de poing qui a changé le regard sur l’agriculture » et qui permet de voir un court entretien d’Edouard Bergeon qui en quelque mots dit l’essentiel.
Et en plein confinement, le 29 avril Edouard Bergeon a pris une nouvelle initiative :
Il a créé une chaîne de télévision en ligne, <CultivonsNous.tv>.
Cette chaîne, créée en partenariat avec la plateforme numérique Alchimie se présente comme un « espèce de Netflix », explique Edouard Bergeon. C’est une « chaîne thématique de l’agriculture, du bien manger et de la transition écologique » qui ambitionne de « recoudre le lien entre la terre et les urbains. »
CultivonsNous.tv fonctionne sur la base de l’abonnement (4,99€ par mois), dont 1€ est reversé à des structures associatives. Pour le lancement du projet, l’association Solidarité Paysans, soutenue de longue date par Edouard Bergeon, est celle retenue.
La chaîne propose déjà une série de documentaires sur plusieurs thématiques : « Ceux qui nous nourrissent », « Ma vie de paysan 2.0 », « Dans quel monde vit-on ? », « Ce qu’on mange », « Ce qu’on boit »
Edouard Bergeon précise :
« Les documentaires racontent toute forme d’agriculture avec une envie d’être plus vertueux »
Je redonne le lien vers cette plate-forme : <https://www.cultivonsnous.tv/FR/home>
<1429>