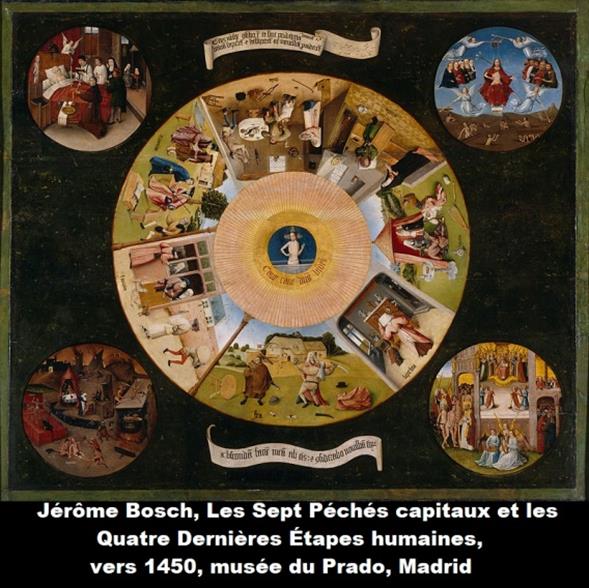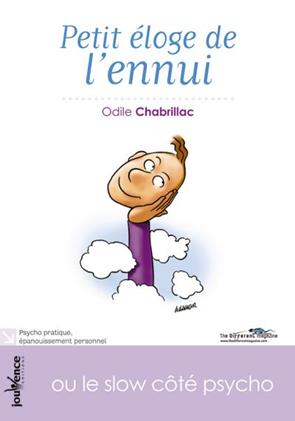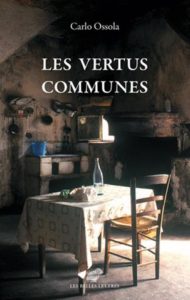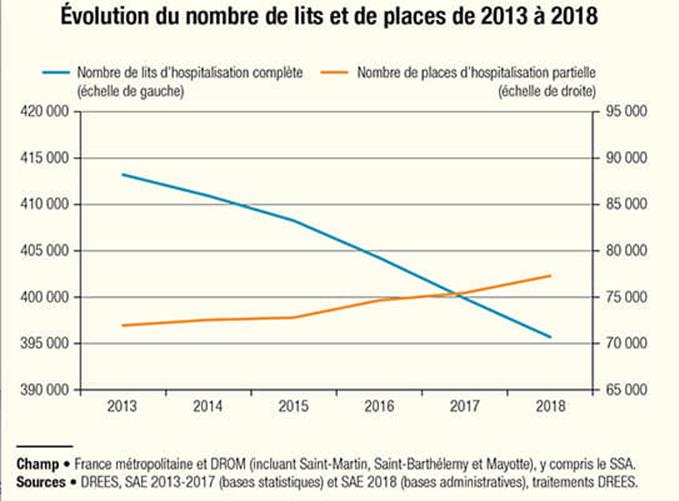Nous sommes donc tombés encore plus bas que lors du débat entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron.
Le débat entre Trump et Biden a été pire que ce que l’on pouvait imaginer
 Pour l’éditorialiste Dan Balz, du Washington Post :
Pour l’éditorialiste Dan Balz, du Washington Post :
« Aucune personne vivante n’avait jamais assisté à un débat comme celui-ci. Un festival de cris inconvenants, d’interruptions et d’insultes personnelles. C’était une insulte au public et un triste exemple de l’état de la démocratie américaine, cela cinq semaines avec les élections ».
Pour le site « Politico » le débat fut un « moment épique de honte nationale ».
« Annulez les deux prochains débats » supplie le magazine « Time »
Le chaos est presqu’uniquement imputable à l’occupant actuel de la Maison Blanche. Il est arrivé à rendre Joe Biden sympathique. Et quand ce dernier l’a traité de « clown », de « menteur », de « raciste » et surtout quand il a fini par lâcher : « Tu vas la fermer, mec ? » (« Will you shut up, man », en anglais), nous ne pouvions que l’approuver.
Il y a encore plus inquiétant lorsque Trump refuse de s’engager à reconnaître le résultat du scrutin, laissant entendre que s’il perd cela ne peut être qu’en raison de tricheries de ses adversaires.
Et il prépare les ferments de guerre civile en refusant de condamner les milices d’extrême droite qu’on appelle les suprémacistes et même encore plus grave quand il envoie, en plein débat, ce message explicite à l’organisation d’extrême droite : «Proud Boys, mettez-vous en retrait, tenez-vous prêts». <Le Figaro> explique qui sont ces hommes misogynes, racistes et amateurs d’armes à feu.
Est-ce ainsi que les démocraties finissent ?
Parallèlement j’ai regardé un nouvel épisode de cette remarquable série que Diffuse ARTE et dans laquelle l’historien Patrick Boucheron, professeur au Collège de France, nous raconte les dates marquantes de l’Histoire. Mais il ne raconte pas seulement ce qui s’est passé à cette date, mais aussi avant et après, le contexte qui explique ce qui s’est passé et les conséquences jusqu’à nos jours de cet évènement : <Quand l’Histoire fait dates>.
Cette fois la date étudiée se situait il y a 2400 ans, plus exactement 2419 ans en -399, dans la cité d’Athènes. <-399, le procès de Socrate | Quand l’histoire fait dates | ARTE>
Il introduit son sujet ainsi
« De quoi sommes-nous redevables à l’Athènes du 5ème siècle. De ce passé ancien, ensoleillé.
On dirait deux choses : La philosophie d’une part, la Démocratie, d’autre part.
On aimerait tant que ce soit la Philosophie et la Démocratie, la Philosophie avec la Démocratie.
On aimerait tant voir Socrate converser avec des citoyens qui l’interpelleraient et lui répondrait.
Et de ce dialogue naîtrait un rapport raisonnable qu’on appellerait la Politique
Alors tout serait raccordé
Alors ce que nous devons à la Grèce, la Démocratie et la Philosophie seraient ensemble dans une même scène apaisée.
Mais cela ne s’est pas du tout passé comme cela ! »
Patrick Boucheron va développer son propos pendant une demi-heure : <-399, le procès de Socrate | Quand l’histoire fait dates | ARTE>
 Le procès de Socrate est l’un des procès les plus célèbres de l’Histoire.
Le procès de Socrate est l’un des procès les plus célèbres de l’Histoire.
Il était accusé de corrompre la jeunesse, de nier les dieux de la cité et d’introduire des divinités nouvelles. Pour cette raison il sera condamné à mort, il avait 70 ans. Contrairement aux demandes pressantes de ses amis, il refusera de s’enfuir et se soumettra à la décision du Tribunal de la démocratie athénienne, il boira la cigüe.
Nous connaissons cette histoire par le récit qu’ont en fait deux de ses disciples Platon et Xénophon, dans leur Apologie de Socrate respective.
Évidemment nous n’entendons ainsi qu’une partie au Procès. Platon développera des thèses très anti-démocratiques, la démocratie a tué son maître et l’homme qu’il admirait le plus.
De très nombreux ouvrages ont discuté de ce procès.
Boucheron aborde un sujet développé ces dernières années qui est l’opinion de Socrate sur la démocratie avant le procès. Parce ce que les chefs d’accusation sont la corruption de la jeunesse et une question sur les dieux de la cité. Dans l’apologie de Socrate il n’est pas question d’une atteinte à la démocratie athénienne. Mais il semble qu’il y a aussi un conflit sous-jacent à ce sujet.
Car la cité d’Athènes est une démocratie qui se trouve en difficulté au moment du Procès de Socrate.
Athènes est durant le Ve siècle la cité la plus puissante du monde grec. Mais la guerre du Péloponnèse contre Sparte et ses alliés, commencée en -431, se termine par une terrible défaite.
À la fin de la guerre, c’est le régime démocratique lui-même qui est mis en cause.
Il y eut une première tentative pour renverser la démocratie en 411 et en 404, une nouvelle tentative, dirigée par Théramène, institue le régime des Trente qui est un régime oligarchique.
La défaite fut attribuée à une prétendue perte des valeurs traditionnelles. Ce n’est pas très éloigné des blancs qui font le succès de Trump et qui pense que l’Amérique est en train de perdre la guerre de la mondialisation, parce qu’elle a abandonné ses valeurs originelles. C’est exactement les thèses défendues par les suprémacistes.
Pour revenir à Socrate et son opinion par rapport à la démocratie, on lit dans <Wikipedia>
« Les opinions politiques qu’on lui attribue et qu’ont embrassées certains de ses disciples n’aident pas sa défense. Critias, un ancien élève de Socrate, a été l’un des chefs de file des Trente tyrans, un groupe d’oligarques favorables à Sparte qui dirige Athènes durant un peu plus de sept mois, de mai 404 à janvier 403, après la fin de la guerre du Péloponnèse. Durant cette même guerre, Alcibiade, un des principaux disciples de Socrate durant sa jeunesse, a trahi Athènes en rejoignant le camp des spartiates. De plus, d’après les portraits laissés par des disciples de Socrate, ce dernier épouse ouvertement certaines vues anti-démocratiques, estimant que ce n’est pas l’opinion de la majorité qui donne une politique correcte, mais plutôt le savoir et la compétence professionnelle, qualités que peu d’hommes possèdent. Platon le décrit aussi comme très critique envers les citoyens les plus importants et les plus respectés de la démocratie athénienne ; il le montre affirmant que les responsables choisis par le système athénien de gouvernement ne peuvent être regardés de façon crédible comme des bienfaiteurs, car ce n’est pas un groupe nombreux qui bénéficie de leur politique, mais « un seul homme […] ou alors un tout petit nombre ». Enfin Socrate est connu pour louer les lois des régimes non démocratiques de Sparte et de la Crète. »
 L’historien , Paulin Ismard a écrit un livre en 2013 « L’événement Socrate » : dans lequel il revient sur « l’affaire » Socrate et pose la question : <Socrate, ennemi de la démocratie ?>
L’historien , Paulin Ismard a écrit un livre en 2013 « L’événement Socrate » : dans lequel il revient sur « l’affaire » Socrate et pose la question : <Socrate, ennemi de la démocratie ?>
Dans l’entretien au Point il explique :
« Mais sa condamnation s’explique aussi en partie par le contexte politique athénien de la charnière des Ve et IVe siècles. A la fin de la guerre du Péloponnèse (431-404), les partisans du régime oligarchique profitent du soutien des troupes spartiates pour renverser le régime démocratique et instaurer durant quelques mois ce qui s’avère rapidement être une pure tyrannie, connue sous le nom de régime des Trente. Le procès de Socrate se déroule quatre ans après ces événements, à un moment où le camp démocrate, désormais tout-puissant, désire solder ses comptes avec ses anciens adversaires. A cette date, Socrate est clairement assimilé aux anciens partisans de l’oligarchie dans la mesure où plusieurs de ses disciples (dont Critias, l’idéologue des Trente) ont participé à son instauration. Socrate lui-même, contrairement à de nombreux Athéniens, était resté dans la ville durant les heures les plus sombres du régime des Trente, ce qui devait apparaître aux yeux de nombreux citoyens comme un témoignage de soutien.
[…] Incontestablement, la philosophie politique socratique, d’après ce qu’en rapporte l’ensemble de ses disciples, était hostile aux principes fondamentaux du régime démocratique, le cœur du différend portant sur la place octroyée au savoir dans l’exercice du pouvoir. Socrate pouvait apparaître comme un promoteur du gouvernement des experts, alors que le régime démocratique athénien refusait que la compétence technique puisse être un titre à gouverner. ».
Ce sont finalement des débats très actuels.
Si la démocratie conduit à ce que le peuple souverain élise un type comme Trump, ne faut-il remettre en cause la démocratie ?
Et comme le pense le philosophe Socrate donner le pouvoir à ceux qui savent ?
C’est un peu ce que l’Union européenne, essaye de mettre en place et qui est dénoncé par Emmanuel Todd ou Michel Onfray.
J’avais évoqué ce sujet lors de mots du jour. Par exemple mercredi 21 octobre 2015 : « Mon mandat ne provient pas du peuple européen. » qui est une phrase qu’a tenue Cécilia Malmström, la commissaire européenne, en 2015, chargée du commerce et donc des négociations du TTIP ou TAFTA, ou celui du mercredi 25 mars 2015 qui rapportait les propos d’un fonctionnaire européen : «Ne vous inquiétez pas, en Europe nous avons le système qui permet de ne pas tenir compte des élections.»
Sommes-nous condamnés à choisir entre un gouvernement des experts ou un gouvernement à la Trump ?
N’est ce pas des gouvernements d’experts qui ont conduit à élire des gens comme Trump ?
Boucheron prétend que nous ne sommes pas encore remis de cette divergence initiale entre la philosophie et la démocratie qui a eu lieu il y a 2400 ans.
<-399, le procès de Socrate | Quand l’histoire fait dates | ARTE>
<1465>

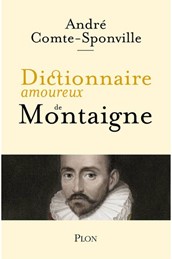
 « Un baiser d’amour pour mourir ? je veux bien cela ! ». En quelques mots l’essentiel est dit.
« Un baiser d’amour pour mourir ? je veux bien cela ! ». En quelques mots l’essentiel est dit.