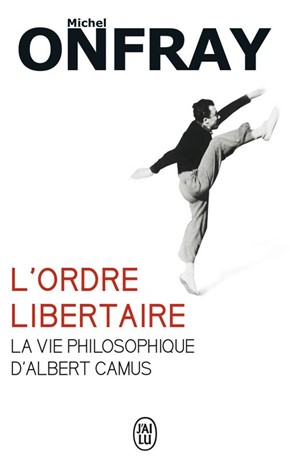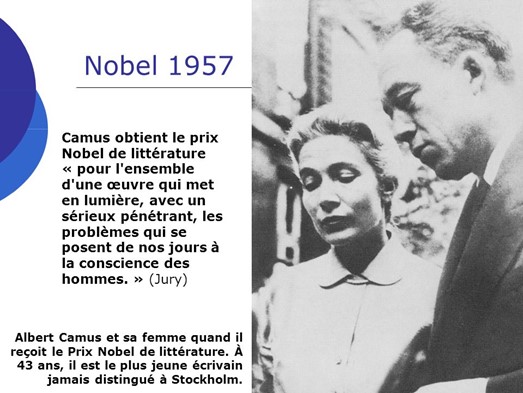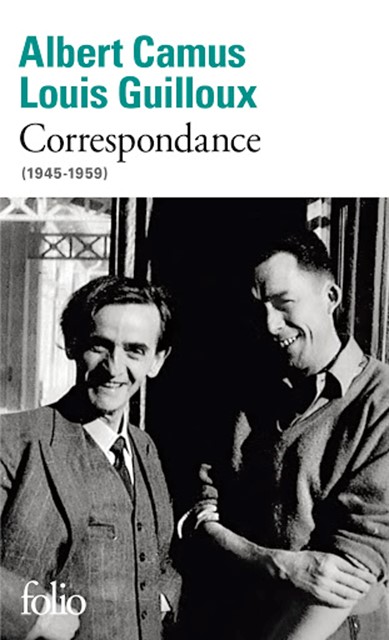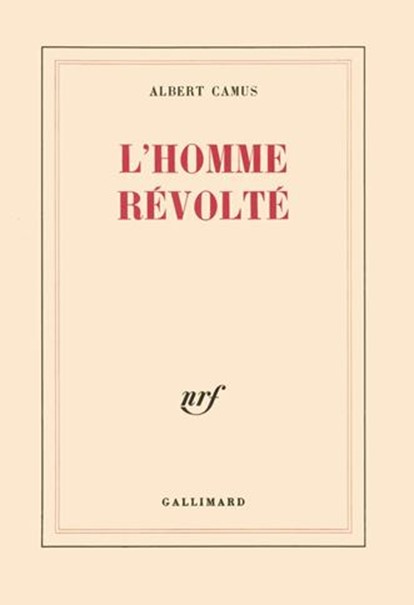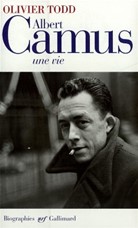« Juste une femme ».
Anne Sylvestre, titre d’une chanson et d’un album
Aujourd’hui, je ne saurais parler que d’Anne Sylvestre.
J’aurais pu connaître ses fabulettes, alors que j’étais enfant puisque le premier album est paru en 1962, j’avais quatre ans.
 Mais il n’en fut pas ainsi, je l’ai connue alors que j’étais devenu père et que j’écoutais ces merveilles avec mes enfants.
Mais il n’en fut pas ainsi, je l’ai connue alors que j’étais devenu père et que j’écoutais ces merveilles avec mes enfants.
Ces chansons sont toujours des histoires qu’elle raconte avec malice « Le Toboggan », avec du vécu « Les Sandouiches Au Jambon », pédagogie familiale « Cécile et Céline », naturaliste « Tant De Choses », poésie « Balan Balançoire », lumineuse « La Petite Rivière ».
Les paroles sont simples, compréhensibles par des enfants mais les phrases ont du sens et expliquent les choses de la vie.
Je prends l’exemple de cette chanson « Je t’aime » :
Ce sont les mots les plus doux
Comme deux bras autour du cou
Comme un grand rayon de soleil
Ce sont des mots Merveille
Ce sont des mots légers, légers
Un papillon qui vient voler
Pour faire plaisir à une fleur
Ce sont des mots Douceur
Ce sont des mots tout ronronnants
Comme le chat quand il est content
Comme le duvet d’un poussin
Ce sont des mots Câlin
Ce sont des mots qui tiennent chaud
Comme la laine sur le dos
Comme une lampe dans le noir
Ce sont des mots Espoir
Ce sont des mots qu’on peut garder
Dans son cœur toute la journée
On peut les dire et les redire
Ce sont des mots Sourire
Ce sont les mots les plus précieux
C’est la prunelle de tes yeux
Tu n’entendras jamais les mêmes
Ecoute bien: je t’aime
Mais c’est encore plus tard que j’ai appris qu’Anne Sylvestre n’était pas qu’une chanteuse pour enfants bien qu’elle fut « fabuleuse » dans cette quête de distraire, d’enchanter et d’enseigner les enfants.
Elle était chanteuse tout simplement, chanteuse avec des textes d’une poésie, d’une profondeur et d’une force extraordinaire.
Le spécialiste de musique, Bertrand Dicale, donne un avis avec lequel je suis pleinement d’accord : « Anne Sylvestre était une des plus grandes plumes de l’histoire de la chanson »
Je lis aussi :
« On doit à cette femme des morceaux gigantesques d’intelligence et de subtilité »
Valérie Lehoux, Télérama, 17 septembre 2007.
 Elle savait parler aux enfants comme aux adultes, de sujets légers et de sujets beaucoup plus durs.
Elle savait parler aux enfants comme aux adultes, de sujets légers et de sujets beaucoup plus durs.
Elle a toujours défendu la cause des femmes et dénoncé la violence et l’injustice dont elles étaient victimes.
Et j’ai choisi comme exergue de ce 1501ème mot du jour, le titre d’une de ses chansons « féministes » qui était aussi un titre d’album : « Juste une femme ». Et j’ai trouvé pertinent de citer des extraits de cette chanson tout au long de cet article.
« Petite bedaine
Petite sal’té dans le regard
Petite fredaine
Petite poussée dans les coins »
Cette chanson a été créée en 2013, Anne Sylvestre a presque 80 ans puisqu’elle née le 20 juin 1934 à Lyon. Elle écrit cette chanson dans la suite de « l’affaire DSK », et ne le cache pas aux journalistes qui l’interviewent alors. Elle exprime sa colère face à tous ceux qui relativisent la gravité des agressions sexuelles. Le texte d’Anne Sylvestre jette au monde l’indignation et l’exaspération qui explosera quatre ans plus tard des dizaines de milliers de femmes, lors de la déferlante #Metoo.
Mais ce n’était pas sa première chanson qu’on peut déclarer féministe : « La Faute à Eve », « La vaisselle », « Une sorcière comme les autres », et « Rose » peuvent être classés ainsi.
« C’est juste une femme
C’est juste une femme à saloper
Juste une femme à dévaluer »
Un seul mot du jour lui a été dédié jusqu’à présent. C’était lors de la série sur mai 68 et le mot du jour à la lutte pour la dépénalisation de l’avortement. Elle avait écrit en 1973 la chanson : « Non, Non tu n’as pas de nom »
J’avais pris pour exergue un extrait de cette chanson : « Ils en ont bien de la chance, ceux qui croient que ça se pense. Ça se hurle ça se souffre, c’est la mort et c’est le gouffre »
Cette chanson avait été écrite, deux ans après le manifeste publié en 1971 par Le Nouvel Observateur dans lequel 343 Françaises célèbres reconnaissant avoir avorté. L’année suivante, le « procès de Bobigny », celui d’une jeune fille ayant avorté avec l’aide de sa mère et défendue par Gisèle Halimi, fait grand bruit puis en 1973, 331 médecins déclarent publiquement avoir pratiqué des avortements, crime que la loi punit sévèrement.
Anne Sylvestre écrit l’hymne de cette lutte. Mais elle précisait que ce n’était pas une chanson sur l’avortement, mais une chanson sur l’enfant ou le non-enfant.
« Petit pouvoir, p’tit chefaillon
Petite ordure
Petit voisin, p’tit professeur
Mains baladeuses »
 Elle portait une blessure intérieure.
Elle portait une blessure intérieure.
Daniel Cordier était du côté de la France Libre et De Gaulle, le père d’Anne Sylvestre était de l’autre côté, celui de Pétain et du Régime de Vichy.
Car elle est née Anne-Marie Beugras. Son père, Albert Beugras, fut l’un des bras droits du collaborateur Jacques Doriot pendant la seconde guerre mondiale. Sauvé de justesse de la condamnation à mort à la Libération, il purgea dix ans de prison à Fresnes. Elle ne s’est libérée de ce secret que dans les années 1990. Elle le partageait avec sa sœur Marie Chaix, écrivaine et secrétaire de Barbara.
<Le Monde> dans l’hommage qu’il lui a consacré, en dit davantage :
« Marie Chaix, […] raconte, dans Les Lauriers du lac de Constance (Seuil, 1974), la fuite, lors de la débâcle allemande – « Anne, assise près de toi, muette, serrant sa poupée » –, l’arrivée semi-clandestine chez un oncle, à Suresnes (Hauts-de-Seine), la disparition de leur frère, Jean, sous un bombardement, les hommes armés qui viennent quelques jours plus tard, cherchant Albert Beugras. « Et la famille du traître. » Marie a 3 ans, Anne 10.
Longtemps Anne Sylvestre a caché son secret, refusant de dire que Marie Chaix était sa sœur : « J’avais 10 ans, la photo d’Albert Beugras était partout, des pages entières dans les journaux. C’était mon père, un père aimant. Je suis allée à son procès, maman y tenait, elle a eu raison. On m’avait mise à l’école chez les dominicaines. Mes camarades chapitrées par leurs parents, m’ont placée en quarantaine. La directrice, qui était la sœur du colonel Rémy, résistant notoire, elle-même déportée, m’a défendue et sauvée. »
[…] Elle aime les marges et déteste la droite radicale. En 1997, elle publie un album succulent, Chante… au bord de La Fontaine, douze chansons inventées à partir du fabuliste, dénonciation des loups patrons de bistrots glauques, qui font la peau du petit mouton noir et frisé qui a taggé leurs murs. « Le racisme, la banalisation de la discrimination me font froid dans le dos, et cette façon de dire : « On n’y peut rien » ! », dit-elle alors. Le spectacle est créé à La Comedia de Toulon, « en solidarité pour ce théâtre qui avait en face de lui une mairie Front national ».
Anne Sylvestre écrira une chansons paru dans l’album « D’amour et de mots », sorti en 1994. Cette chanson a pour titre «Roméo et Judith». Elle y chante ces vers
«J’ai souffert du mauvais côté
Dans mon enfance dévastée
Mais dois-je me sentir coupable»
On ne choisit pas ses parents
« Mais c’est pas grave
C’est juste une femme
C’est juste une femme à humilier
Juste une femme à dilapider »
<Libération a republié un portrait de 2019> la qualifie justement d’artiste féministe et libre. Dans cet article, le journaliste pose la question : « Mais ces chansons, elles ne sont jamais vraiment passées à la radio. Pourquoi ? ».
La réponse d’Anne Sylvestre est dubitative :
«Il ne faut pas trop faire réfléchir les gens, j’imagine.»
Les médias sont, en effet, passés grandement à côté de son immense talent. Pour ma part, je ne l’ai compris que récemment il y a environ 5 ans, après avoir entendu une émission de radio.
Alors Pourquoi ?
« Le Monde » suggère :
« Anne Sylvestre n’a pas toujours eu la place qu’elle méritait dans la chanson française. Il est vrai qu’elle n’a pas tout fait pour. Elle n’était pas tous les jours de bonne humeur. « »
Une autre explication se trouve peut-être dans les sujets abordés par la chanteuse.
Parmi ses premières remarquables chansons, en 1959 avec « Mon mari est parti» qui est une chanson sur la guerre à l’heure où la France est aux prises avec ce qu’on appelle les «événements» en Algérie.
Et Pendant toute sa carrière, elle s’intéresse aux faits de société, et notamment à la condition des femmes, revendiquant le terme de chanteuse « féministe », qui fut parfois lourd à porter. Elle dit elle-même
« Je suppose que ça m’a freinée dans ma carrière parce que j’étais l’emmerdeuse de service, mais ma foi, si c’était le prix à payer… »
Mais l’explication qui semble la plus vraisemblable est que c’est l’immense succès des « Fabulettes » qui a vampirisé l’autre partie de son œuvre.
Elle a raconté à <France Culture> que le succès des fabulettes ont peut être joué un rôle de frein pour la réputation de sa carrière de chanteuse universelle :
« Je ne me suis pas méfié suffisamment puisque beaucoup de gens ont continué à me considérer comme une chanteuse pour enfants, sans faire attention du tout à mon répertoire qui est quand même un répertoire de chanteuse pour les « gens », les adultes.
Ainsi, elle évoque l’anecdote de cette petite fille à qui l’on demandait de citer des chanteuses qu’elle aimait. La liste de chanteuses et chanteurs passant à la radio s’allonge. « Mais, et Anne Sylvestre que tu aimes tant ? ». La petite fille de répondre étonnée : « Oooh, mais ce n’est pas pareil, Anne Sylvestre ce n’est pas une chanteuse ! ». La chanteuse sourit : « Vous voyez, moi j’étais un meuble ». »
 Ainsi le succès des Fabulettes, soutenues par toutes les écoles de France, dont les ventes se comptent en millions ont conduit l’auteure-compositrice-interprète y être exclusivement identifiée, alors qu’elle avait écrit près de quatre cents chansons « adultes », dont des chefs-d’œuvre tels que « Lazare et Cécile », « Les Gens qui doutent », « Maryvonne »
Ainsi le succès des Fabulettes, soutenues par toutes les écoles de France, dont les ventes se comptent en millions ont conduit l’auteure-compositrice-interprète y être exclusivement identifiée, alors qu’elle avait écrit près de quatre cents chansons « adultes », dont des chefs-d’œuvre tels que « Lazare et Cécile », « Les Gens qui doutent », « Maryvonne »
Le Monde rapporte sa colère devant une « fake news » :
« On a dit : quand Anne Sylvestre a eu moins de succès, elle s’est reclassée dans la chanson pour enfants. Faux.
Ce sont deux répertoires distincts, deux activités parallèles.
J’ai commencé à chanter en 1957 et, dès 1961, je me suis mise à écrire des chansons pour les enfants, par plaisir et pour ma fille. Parce que je voulais retarder la crétinisation…
En 1963, pour me faire plaisir, Philips avait accepté d’enregistrer un 45-tours où il y avait Veux-tu monter sur mon bateau, Hérisson.
Je savais ce qui est au centre des préoccupations quotidiennes des enfants, le rôle du vélo, des nouilles…
Avec les Fabulettes, j’ai pu les structurer, leur donner le goût de la liberté, du plaisir de chanter. »
Anne Sylvestre a toujours refusé de chanter ses Fabulettes sur scène. Elle a dit :
« Et puis une salle remplie d’enfants… ça me fait peur !»
Et dans la Grande table du 06/02/2014 elle a dit :
« Je suis heureuse et fière d’avoir écrit les Fabulettes. Mais je ne suis pas une chanteuse pour enfants. »
Mais celles et ceux qui ont écouté avec attention son autre répertoire savent combien il est grand.
<TELERAMA> raconte
« Une jeune femme vient de lui sourire. Sans rien dire. Mais avec dans les yeux une joyeuse reconnaissance. « Voilà ce qui arrive dans la rue : des gens m’offrent leur sourire. C’est joli. » Ceux-là, c’est sûr, ont écouté son œuvre. Pas seulement ses Fabulettes pour enfants mais aussi ses chansons pour adultes. Ils savent combien elles sont précieuses. Pour qui connaît le répertoire français, le nom d’Anne Sylvestre égale ceux de Brassens, Brel, Barbara, Ferré, Trenet. On ne le dit pas assez ? Si seulement les radios et les télés avaient daigné diffuser ses chansons, tout le monde saurait. Mais l’histoire s’est écrite autrement, et le trésor s’est partagé avec plus de discrétion, scène après scène, disque après disque. »
« Mais c’est pas grave
C’est juste une femme
C’est juste une femme à bafouer
Juste une femme à désespérer »
Christine Siméone a titré son hommage : <Mort d’Anne Sylvestre après 300 chansons et une vie passée à raconter les gens> et nous apprend qu’Anne Sylvestre est l’autrice de 18 albums de « Fabulettes », pour les enfants, et d’une vingtaine d’albums pour les adultes. Parisienne et citadine dans l’âme, Anne Sylvestre est montée pour la première fois sur scène en 1957, dans le cabaret parisien « La Colombe » où ont également débuté Jean Ferrat, Pierre Perret, Guy Béart ou Georges Moustaki.
Et elle cite Georges Brassens qui écrit, en 1962, au dos d’une des pochettes de disques d’Anne Sylvestre :
« On commence à s’apercevoir qu’avant sa venue dans la chanson, il nous manquait quelque chose et quelque chose d’important. »
<TELERAMA> a tenté de sélectionner les dix plus grandes chansons d’Anne Sylvestre, « Juste une femme » en fait partie. Et ajoute :
« Nous en avons choisi dix…Nous aurions pu en prendre vingt, ou trente, tant [son] répertoire est l’un des plus riches et des plus beaux de la chanson française. Curieusement méconnu, mais à la hauteur de ceux de Barbara, Brassens, Brel. »
 Il est difficile de choisir parmi tant de beautés, j’avoue une faiblesse pour cette chanson « Écrire pour ne pas mourir »
Il est difficile de choisir parmi tant de beautés, j’avoue une faiblesse pour cette chanson « Écrire pour ne pas mourir »
Elle a dit
« Écrire pour ne pas mourir, écrire fait beaucoup de bien. »
Et aussi « Je me vois comme un écrivain public : je trouve les mots » ou encore « Les mots, il faut les laisser venir, et il faut aller les chercher »
Elle n’a pas arrêté.
« Y a-t-il une vie après la scène ? Je m’aperçois, après cinquante ans de chanson, qu’à part ma famille et mes amis proches, il n’y a qu’une seule chose qui m’intéresse, écrire et chanter. C’est mon bonheur, c’est ma vie », racontait-elle à Bertrand Dicale dans les pages du Figaro pour
Jamais elle n’a posé le micro. Elle avait encore une tournée prévue pour jouer son spectacle « Nouveaux manèges », notamment quatre dates à la Cigale en janvier 2021.
Mais dès qu’une femme […]
Est traitée comme un paillasson
Et quelle que soit la façon
Quelle que soit la femme
Dites-vous qu’il y a mort d’âme
C’est pas un drame
Juste des femmes »
Le texte intégral de « Juste une femme » peut être trouvé <ICI> et son interprétation <ICI>
Je vous donne aussi le lien vers <Ecrire pour ne pas mourir> elle chante dans l’émission de Pivot, puis répond à ses questions.
Et je finirai par ce bel hommage du Rabbin Delphine Horvilleur :
« Anne Sylvestre
Bien souvent, on me demande qui je rêverais de rencontrer.
Depuis longtemps, c’est ton nom que je cite.
Je rêvais de te croiser, pour simplement de te dire merci. »
<1501>
 Lors de l’émission elle a dit :
Lors de l’émission elle a dit :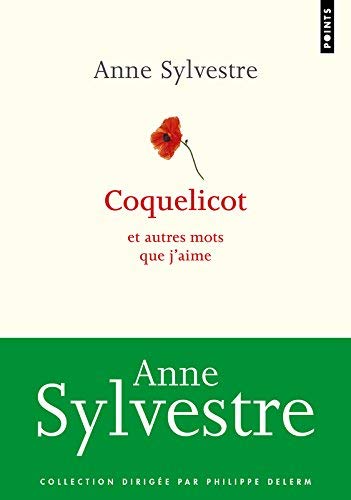 François Busnel l’avait reçu à la Grande librairie parce qu’elle venait d’écrire <Coquelicot> un livre sur ses mots préférés. Ce même soir Daniel Pennac était invité aussi. Vous apprendrez le sens du verbe : « débarouler »
François Busnel l’avait reçu à la Grande librairie parce qu’elle venait d’écrire <Coquelicot> un livre sur ses mots préférés. Ce même soir Daniel Pennac était invité aussi. Vous apprendrez le sens du verbe : « débarouler »








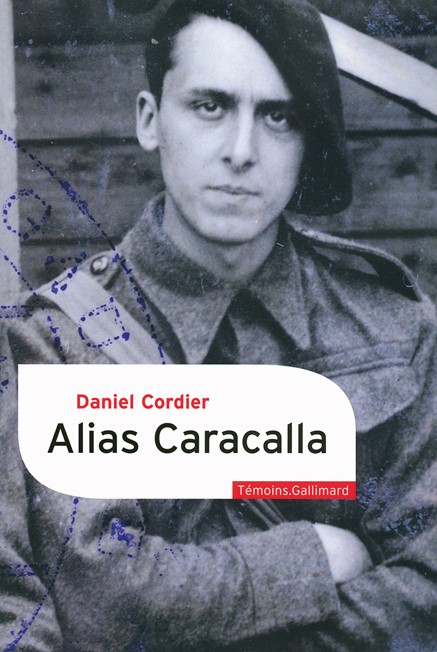


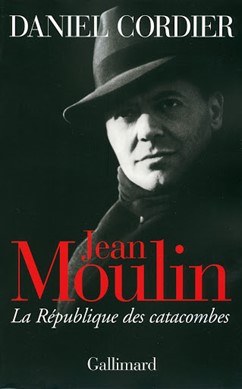

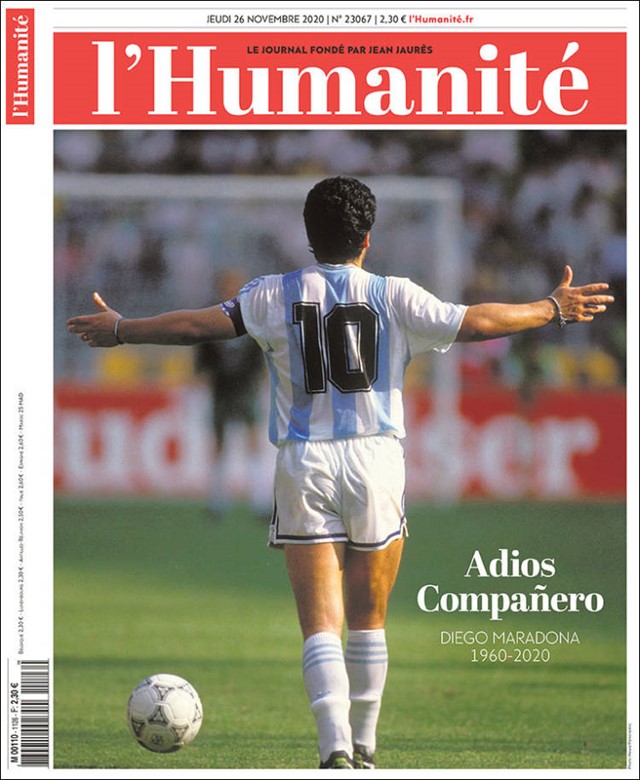
 Son goût de la justice va plus loin. Après que Naples son club après Barcelone, ait gagné pour la première fois le championnat italien grâce à son rayonnement, le Président avait décidé de verser une prime de victoire aux joueurs : une grosse prime pour les titulaires et une petite prime pour les remplaçants. Alors « El Pibe de Oro » est allé voir le président et l’a menacé de quitter le club si la même prime n’était pas versée à tous les joueurs titulaires et remplaçants et il a exigé que tous les salariés du club, même les plus modestes touchent également une prime parce que par leur engagement ils avaient aussi contribué au succès.
Son goût de la justice va plus loin. Après que Naples son club après Barcelone, ait gagné pour la première fois le championnat italien grâce à son rayonnement, le Président avait décidé de verser une prime de victoire aux joueurs : une grosse prime pour les titulaires et une petite prime pour les remplaçants. Alors « El Pibe de Oro » est allé voir le président et l’a menacé de quitter le club si la même prime n’était pas versée à tous les joueurs titulaires et remplaçants et il a exigé que tous les salariés du club, même les plus modestes touchent également une prime parce que par leur engagement ils avaient aussi contribué au succès.