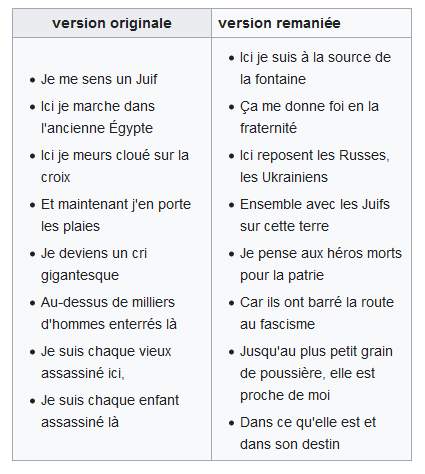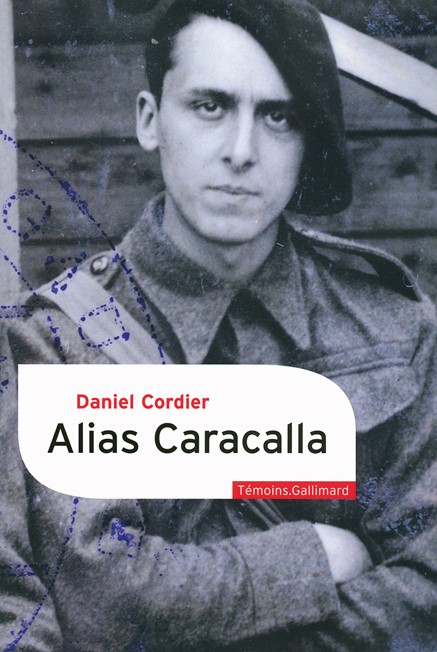Robert Badinter a vécu les horreurs de l’antisémitisme. :
Il se définissait comme « républicain, laïque et juif », c’est ce qu’a rappelé Richard Zelmati, lors de la <commémoration> de la rafle du 12 de la rue Sainte-Catherine à Lyon, en bas des pentes de la Croix Rousse.
Cette rafle a eu lieu le 9 février 1943. Parmi les 86 personnes arrêtées, il y avait Simon Badinter le père de Robert Badinter.
Le destin a voulu que Robert Badinter soit décédé 81 ans, jour pour jour, après l’arrestation de son père à Lyon.
<Le Mémorial de la Shoah> précise :
« C’est un piège que les nazis tendent au 12 de la rue Sainte-Catherine, siège de la Fédération des sociétés juives de France et du comité́ d’assistance aux refugies, réunis au sein de l’Union générale des israélites de France. La Gestapo attend plusieurs heures sur place pour arrêter le maximum de personnes, employés et personnes qui se présentent dans les locaux.
D’abord emprisonné au Fort Lamothe, le groupe est transféré́ au camp de Drancy le 12 février. Sur place, se trouvent notamment les victimes de la rafle du département de la Seine des 10 et 11 février, opérée par la police française à l’initiative des autorités allemandes. Il s’agit pour beaucoup de personnes âgées et d’enfants accueillis dans des foyers et des hospices, notamment ceux de la fondation Rothschild.
Sur les 86 Juifs raflés à Lyon, 80 sont déportés dans les camps d’Auschwitz-Birkenau, Sobibor et Bergen-Belsen. Le plus jeune a 13 ans. Parmi eux figure Simon Badinter, le père de Robert Badinter.
En 1945, il demeure 4 survivants. »
Le père de Robert Badinter, mourra à 47 ans, dans le camp d’extermination de Sobibor
Robert Badinter fut toujours en première ligne dans le combat contre l’antisémitisme et le négationnisme.
Israël était important pour lui, comme un refuge protecteur des juifs. Mais il considérait toujours qu’Israël devait, pour sa sureté, accepter un état palestinien à côté de lui.
J’ai retrouvé un article dans lequel il expliquait la psychologie de la majorité des juifs israéliens de manière qui m’a paru très pénétrante.
J’ajoute tout de suite qu’il ne parle pas de la minorité des messianiques qui poursuivent une vision religieuse délirante du destin d’Israël et qui, au même titre que le Hamas, sont des propagandistes de la haine et du chaos.
Le Monde avait publié le 20 août 2001 cet article : <L’angoisse et la paix par Robert Badinter>
Il réagissait après un attentat anti-israélien dans une pizzeria, au cœur de Jérusalem, dans lequel 3 enfants de 14 ans, 4 ans, 2 ans avaient été tués avec leurs parents
Robert Badinter écrivait :
« Nul ne saurait demeurer indifférent aux morts et aux souffrances du peuple palestinien. Pour ma part, je souhaite depuis longtemps qu’il connaisse une vie paisible dans un Etat indépendant. »
Et puis il a ajouté cela sur Israël, les juifs et les palestiniens :
« Juif du XXe siècle ayant traversé, jeune adolescent, les ténèbres de la guerre et de l’Occupation, j’ai vu naître, au travers d’épreuves inouïes, l’Etat d’Israël. Il en va des peuples comme des humains.
Les premiers jours de leur vie et ceux qui précèdent leur naissance sont lourds de conséquences pour leur sensibilité et leur avenir.
Or Israël est le fruit de la plus tragique histoire. Les peuples arabes rappellent avec raison qu’ils ne portent pas la responsabilité de la Shoah. Ce crime sans pareil contre l’humanité s’inscrit en lettres de sang dans l’histoire européenne. Dès l’origine, le projet sioniste a pris corps parce que dans les premières décennies du 20e siècle l’antisémitisme n’avait cessé de régner en Europe jusqu’à l’apocalypse nazie.
Les vagues d’immigrants en Palestine depuis le début du 20e siècle succèdent aux persécutions. Le « foyer juif » promis par Lord Balfour pendant la première guerre mondiale répond à cette aspiration d’un peuple si éprouvé à trouver, sur la terre dont les écritures disent qu’elle lui fut promise, un refuge, un lieu de paix et d’enracinement.
On sait ce qu’il advint de cette promesse d’un « foyer juif » du temps du mandat britannique.
Sur la terre de Palestine, les immigrants en petit nombre rencontrèrent l’hostilité de ceux qui s’y étaient établis avant eux. A croire que seuls les juifs n’avaient pas le droit de vivre en Terre sainte !
Après la guerre, lorsque les survivants de la Shoah se comptèrent, l’élan fut irrésistible qui poussa les plus engagés d’entre eux vers la Palestine. Si les autorités anglaises s’y opposèrent, c’est d’abord parce que les peuples arabes de la région ne voulaient pas d’un Etat hébreu parmi eux. On a trop oublié dans quelles conditions fut arrachée la reconnaissance de l’Etat d’Israël, là où d’ailleurs n’avait jamais existé d’Etat palestinien. Cet Etat hébreu était l’expression non pas de l’impérialisme colonial, comme certains le disent aujourd’hui, mais de la tragique condition qu’avait souffert à travers les siècles un peuple dispersé et toujours persécuté. Israël est né de la Shoah. Il ne faut jamais l’oublier. Non parce que les Israéliens ou les juifs seraient devenus des créanciers moraux du monde jusqu’à la fin des temps. Mais parce qu’on ne peut rien comprendre à l’Israël d’aujourd’hui si on ne prend pas en compte cette vérité : Israël est né d’une angoisse de mort comme aucun peuple n’en a connue à ses origines.
Or cette angoisse-là, elle ne l’a jamais quitté. Il faut rappeler à ceux qui aujourd’hui mettent l’accent sur les exactions et les crimes commis par les activistes sionistes lors de la guerre de 1948 que, dès la proclamation de l’Etat d’Israël, toutes les puissances arabes, ses voisins, ont proclamé la guerre sainte et juré sa destruction. Si le sort des armes n’en avait pas décidé autrement, si les Israéliens avaient succombé sous le nombre et le poids de leurs ennemis coalisés, il n’y aurait jamais eu d’Etat d’Israël.
Après un demi-siècle écoulé et tant de campagnes victorieuses, les Israéliens demeurent convaincus en majorité que les peuples arabes autour d’eux veulent en définitive l’anéantissement de l’Etat d’Israël. Sentiment absurde, disent les esprits raisonnables. Tsahal est la première armée de la région. Israël jouit de l’appui inconditionnel des Etats-Unis, superpuissance du monde et gardien ultime de l’ordre international. Aucune menace sérieuse ne pèse donc sur l’avenir d’Israël, hormis son impuissance à résoudre le problème palestinien.
Mais là est précisément le cœur du problème. La plupart des Israéliens sont prêts aux plus importantes concessions pour obtenir une paix réelle pour eux et leurs enfants. Mais la paix n’est acquise réellement que lorsque les adversaires ont renoncé en eux-mêmes à la volonté d’abattre l’autre. La seule paix durable, c’est celle du cœur et de l’esprit. A défaut, il n’y a que des armistices entre deux guerres.
Or cette paix-là, cette paix spirituelle sans laquelle rien ne sera acquis au Proche-Orient, nombre d’Israéliens aujourd’hui demeurent convaincus qu’elle est hors de leur portée. A lire les manuels d’histoire palestiniens, à écouter les discours à usage interne des leaders, à entendre les cris de haine des plus violents d’entre eux, les Israéliens ressentent que c’est bien la destruction d’Israël que leurs adversaires veulent.
Rien ne leur paraît, à cet égard, avoir changé depuis l’époque où les chefs des Etats arabes s’unissaient pour envahir et détruire le minuscule Etat qui venait de naître. A ce sentiment-là, chaque attentat terroriste donne une intensité nouvelle. La mort des victimes, au-delà de la souffrance des parents, résonne dans tout Israël comme le glas de l’espérance de paix. Elle fait renaître cette angoisse existentielle qui n’a jamais cessé depuis la naissance d’Israël, enfant des pogromes et de la Shoah. A quoi bon rendre les territoires, abandonner les colonies de peuplement, reconnaître à Jérusalem-Est le statut de capitale de l’Etat palestinien, indemniser les réfugiés palestiniens, à quoi bon tant de concessions et de renoncements si l’on n’atteint pas le but : la paix, la vraie paix, celle des âmes.
Le recours à la force qui assure le statu quo permet au moins de rassurer pour un moment les esprits. Jusqu’au prochain attentat, jusqu’au prochain mort. La douleur renaît alors, et la colère, et la fureur. Et la riposte vient qui sème à son tour la mort de l’autre côté, en attendant la prochaine bombe de kamikaze qui lui fera écho.
Devant pareil désastre, les hommes de paix s’interrogent sur les moyens de mettre un terme à cette violence toujours sanglante, toujours stérile. Mais tous les efforts demeureront vains s’ils ne prennent pas en compte cette donnée psychologique essentielle : le sentiment angoissé des Israéliens qu’en définitive, pour leurs ennemis, tout accord n’est qu’une étape vers la réalisation de leur objectif ultime : la destruction d’Israël.
Sans doute il incombe aux Israéliens de mettre un terme, sans différer, aux souffrances et aux humiliations subies par les Palestiniens. Mais il appartient à ceux-ci et à leurs alliés de mesurer enfin que, aussi longtemps que demeurera vivant au cœur des Israéliens la conviction que leurs adversaires veulent la mort de l’Etat hébreu, rien ne sera possible.
Au moment décisif, l’homme d’Etat sait que c’est à l’imagination et au cœur qu’il faut s’adresser pour donner à l’histoire un cours nouveau. Le génie de Sadate fut de l’avoir un jour compris. Son exemple, hélas, paraît aujourd’hui oublié. »
Robert Badinter présente l’Histoire de ce conflit du point de vue d’Israël.
Comme toujours, il trouve les mots justes pour décrire très précisément les sentiments et les peurs du côté israélien de cette tragédie.
« Challenges » lui avait rendu visite après le 7 octobre 2023.
Le journaliste Maurice Szafran résume cet entretien, sur ce sujet du 7 octobre et de la suite de la manière suivante :
« Jusqu’à ce pogrom du 7 octobre 2023. « Une monstruosité, évidemment, relève-t-il. Mais il s’est aussi produit un événement capital : Israël devait être le pays du « plus jamais ça », protéger, ce devait être son rôle historique. Et là, Israël a échoué dans sa mission ».
Robert Badinter critique rudement Benyamin Netanyahou — comment pourrait-il d’ailleurs en aller autrement, lui qui a pour référence et « compagnons » Itzhak Rabin et Shimon, Peres, lui qui a toujours défendu la solution à deux états, lui qui estime que « la sécurité des Israéliens passe par l’émancipation des Palestiniens ». « Netanyahou, ajoute-t-il sans même qu’il soit nécessaire de lui poser la question, est un danger pour les Israéliens, un danger pour les libertés publiques, un danger pour la démocratie. Heureusement une partie du peuple s’était soulevée avant le 7 octobre. Il y a pire encore : des partis ouvertement racistes qui « font » la majorité parlementaire, des ministres favorables à l’expulsion des Palestiniens… C’est invraisemblable ». Il dit : « je suis inquiet pour Israël ». Comme un voile de tristesse sur son visage. »
Lucide, pleinement engagé pour la sécurité d’Israël dans la paix, il me semble que lire Robert Badinter permet d’améliorer notre compréhension de cette tragédie.
<1792>








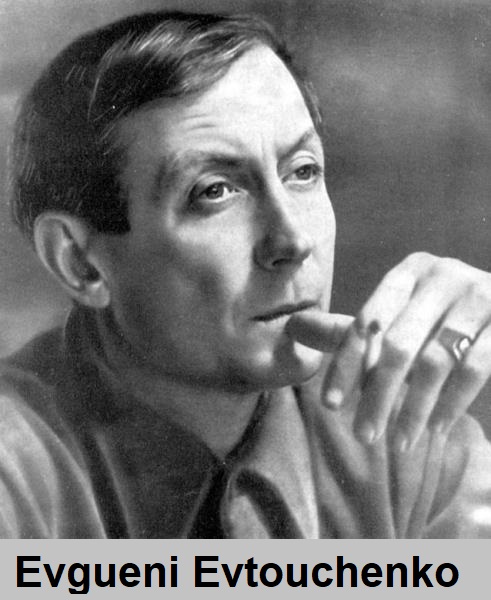 Avant la création de la symphonie, Evtouchenko était sous le feu de fréquentes et violentes attaques pour avoir laissé entendre que seules des victimes juives étaient mortes à Babi Yar et que l’antisémitisme persistait en Union soviétique.
Avant la création de la symphonie, Evtouchenko était sous le feu de fréquentes et violentes attaques pour avoir laissé entendre que seules des victimes juives étaient mortes à Babi Yar et que l’antisémitisme persistait en Union soviétique.