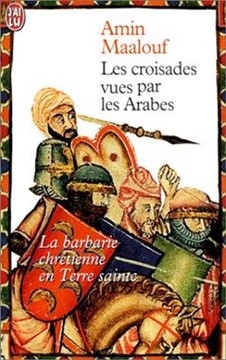J’ai déjà écrit deux mots du jour sur le sujet du comportement des policiers français dans le cadre de leurs missions.
Le premier était pour prendre leur défense de manière résolue, lors des manifestations des gilets jaunes : « C’était de l’ultraviolence. Ils avaient des envies de meurtre. Nous, notre but c’est juste de rentrer en vie chez nous, pour retrouver nos familles. »
Dans cet article, je prenais presque une posture émotionnelle : « Ces personnes sont des fonctionnaires comme moi. Ils ont fait le choix de se mettre au service de L’État et de la République. Mais quand ils sont appelés à assurer leur mission, sur un théâtre d’opération, ils ne sont pas certains de rentrer en bonne forme le soir, en retournant dans leur famille retrouver leurs enfants, leur compagne ou compagnon. »
Mais dans ce genre de questions il ne me semble pas pertinent de ne rester que dans l’émotion. Il faut aussi de l’analyse, des faits et de la rigueur dans le propos.
Plus d’un an plus tard, je me suis résolu à évoquer certains dysfonctionnements en utilisant explicitement le terme de « violences policières. »
Ce second article ne contredisait pas le premier, il exprimait simplement un autre aspect de la même réalité.
Pour ce faire j’ai d’abord entendu et lu des amis qui m’informaient de cette face sombre de la police en France.

Il y avait aussi le travail rigoureux et documenté du journaliste David Dufresne :
Il a effectué sur twitter, le recensement de violences policières : <Allo place Beauvau>.
Il a aussi écrit un roman traitant de ce sujet : « Dernière sommation ».
Il dispose aussi d’un site qui traite de l’ensemble de ses travaux : http://www.davduf.net/
Plus récemment, il s’est intéressé aux rapports de l’IGPN, cette structure interne à la Police qui a vocation à exercer un contrôle sur les activités de police. Mediapart l’a interrogé, il y a quelques jours sur les conclusions de son enquête : « Allo l’IGPN ». Selon lui, ce travail de contrôle n’est pas assez rigoureux et manifeste trop de laxisme sur les comportements déviants de la police.
Dans ce second article je citais aussi Sébastien Roché qui a écrit un livre : <De la police en démocratie>

« Sébastien Roché » est un chercheur spécialisé en criminologie, docteur en sciences politiques, directeur de recherche au CNRS et éditeur (Europe) de Policing and Society, un des journaux internationaux sur la science de la police les plus importants.
Ses travaux portent essentiellement sur les questions de délinquance et d’insécurité, puis sur les politiques judiciaires et policières comparées ainsi que sur la gouvernance de la police et les réformes du secteur de la sécurité.
C’est un chercheur respecté dans son domaine. Il avait été nommé en 2016 par Bernard Cazeneuve au Conseil de la stratégie et de la prospective du ministère de l’Intérieur. Et il a enseigné pendant 16 ans à l’École nationale supérieure de la Police (ENSP).
Mais le 27 août 2019, il est informé qu’il n’enseignera plus dans cette école.
Difficile de ne pas y voir un lien avec ses analyses critiques sur des violences policières pendant le mouvement des Gilets Jaunes.
Ce point m’alerte !
Il ne me semble pas pertinent de ne pas accepter la critique et de refuser de discuter des faiblesses et des problèmes. Le déni ne permet pas de progresser.
En ce moment, la question des violences policières est revenue sur le devant de la scène.
Sur France Culture Guillaume Erner a donc invité Sébastien Roché, vendredi le 12 juin, pour reparler de ce sujet : <La Police doit-elle se réformer ?>.
Dans cet entretien, il n’a pas été question de violences, mais de discrimination et de racisme. Sébastien Roché ne laisse pas de doutes sur le caractère extrêmement répandu de comportements discriminatoires :
« On a maintenant depuis plus de dix ans un grand nombre d’enquêtes sur la manière dont la police travaille, sur les contrôles d’identité et sur le traitement des personnes pendant les contrôles et les sanctions à l’issue des contrôles. Ces enquêtes je me rends compte qu’elles ne sont pas connues. Pourtant dès 2007, on a observé les comportements policiers dans les gares parisiennes avec une méthodologie très précise. Un peu plus tard « l’agence européenne pour les droits fondamentaux » a fait des enquêtes dans toute l’Europe, dans les grandes villes de France avec des échantillons qui permettent de bien comparer les gens, qu’ils soient blancs ou non, d’origine étrangère ou nationale. Et puis, il y a une énorme enquête, l’enquête « TeO » Trajectoire Et Origine, faite par l’INED (publié en 2016. Et puis il y a encore d’autres enquêtes, j’en ai dirigé une avec Dietrich Oberwittler pour comparer la manière avec laquelle la police travaille en France et en Allemagne et le contact avec les jeunes. Bref on a aujourd’hui un énorme corpus de données qu’on n’avait pas il y a dix ans. Et je me rends compte que le gouvernement fait comme s’ils n’existaient pas et le public ne les connait pas forcément.
Et toutes ces études montrent une chose simple : dans toutes les villes où on a fait les enquêtes, la police en France a des comportements discriminatoires. Que ce soit Grenoble, que ce soit Lyon, que ce soit les transports de la région parisienne, que ce soit Marseille, que ce soit Aix en Provence. […]
On a désormais la preuve d’une discrimination systémique. Cela ne fait plus de doute. »
Concernant l’accusation de racisme systémique dans la police, Sébastien Roché n’est pas aussi catégorique :
« Nous ne l’avons pas beaucoup observé ».
Toutefois récemment, le 4 juin, <Street Press> a révélé qu’un groupe facebook composé de milliers (8000) de policiers écrit des propos ouvertement racistes et vulgaires.
<Un deuxième groupe facebook> a été également révélé le 8 juin.
A la question de savoir, si la police Française se distingue par rapport aux autres polices européennes, Sébastien Roché répond :
« Toutes les polices sont différentes. La discrimination ethnique est un problème sérieux dans certains pays, particulièrement en France. Les écarts de traitement suivant votre couleur de peau, sont particulièrement nets. C’est pour cela qu’il y a cette émotion. Évidemment, ce n’est pas le seul pays en Europe à observer ce phénomène. Vous allez retrouver également en Espagne. Mais si vous prenez les pays qui sont les plus grandes puissances économiques européennes, c’est-à-dire celles qui ont le plus de moyens pour former les policiers et les encadrer, la France et l’Allemagne, vous voyez qu’en France, ces pratiques discriminatoires sont bien établies, alors qu’en Allemagne, elles sont très faibles, voire nulles pour la police des Länder. On voit simplement qu’on peut faire la police sans discrimination ou avec des niveaux de discrimination qui sont beaucoup plus réduits qu’en France. Donc on peut faire une meilleure police. Faire la police ne justifie pas la discrimination. »
Pour Sébastien Roché, avant toute chose il faut une vraie prise de conscience.
« La première étape, c’est vraiment la prise de conscience. C’est ce qu’il y a de plus inquiétant. On a le sentiment que le gouvernement n’a pas pris conscience du choc moral, malgré la vague de protestation au niveau mondial. Les syndicats de police majoritaire n’ont pas non plus pris conscience de ce choc. Il faut voir que la discrimination policière c’est une violation, tous les jours de la constitution et de la déclaration des droits de l’homme. […] C’est curieux que le gouvernement ne se mobilise pas pour défendre les droits constitutionnels des français.
On a pu penser que M. Castaner avait pris conscience d’un certain nombre de choses lors de ses premières annonces. Il a eu des propos qui laissaient entrevoir une ouverture du ministère de l’Intérieur, qui n’est pas courante. Mais il n’a pas annoncé de choses pratiques. Il n’a pas annoncé la création d’outils de connaissance de la discrimination. Comment lutter contre quelque chose que l’on ne connaît pas. Comment faire si on ne dispose pas d’outils de connaissance. Il n’a pas fait d’annonces au sujet des moyens. On sait très bien que si on veut faire une politique de lutte contre la discrimination efficace dans la police à tous les niveaux, il faut des moyens. Et il n’a pas non plus annoncé d’objectifs quantifiés clairs. De combien il veut réduire le phénomène, dans combien de temps. »
En mars, avant le confinement Sébastien Roché avait été interviewé par Mediapart : «Le modèle français, c’est la police qui fait peur».
La « Loi et l’ordre » disait récemment un dirigeant peu recommandable.On peut être d’accord sur cette devise, mais il est question d’abord de Loi. Il faut que la Loi soit respectée. La discrimination, l’usage disproportionné de la force ne sont pas conformes à la Loi.
Il ne s’agit pas de sous-estimer la difficulté de l’exercice du métier de la police et de la violence à laquelle elle-même doit faire face. Mais on ne peut pas rester dans le déni.
Il faut d’abord que la Police soit capable d’aider à maintenir la paix dans la société. Certains comportements ne vont pas dans ce sens.
<1439>



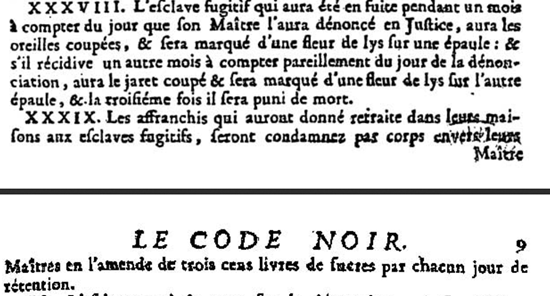


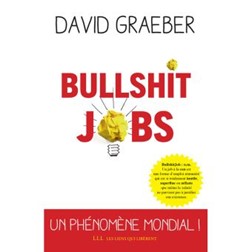





 du sarcome épithélioïde, une forme rare de cancer qui lui avait été diagnostiquée en avril 2019
du sarcome épithélioïde, une forme rare de cancer qui lui avait été diagnostiquée en avril 2019