Amin Maalouf est né en 1949 à Beyrouth, dans une famille d’intellectuels de confession melkite, c’est-à-dire une petite communauté chrétienne du Liban.
Il a d’abord été journaliste comme son père, puis il est devenu écrivain.
Il a notamment reçu le Prix Goncourt en 1993 pour «Le Rocher de Tanios», et a été élu à l’Académie française en 2011.
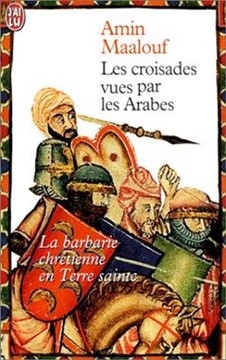 Pour ma part j’ai découvert cet auteur par l’essai « Les Croisades vues par les Arabes » qu’il a publié en 1983 qui a été à la fois une révélation et un choc pour moi.
Pour ma part j’ai découvert cet auteur par l’essai « Les Croisades vues par les Arabes » qu’il a publié en 1983 qui a été à la fois une révélation et un choc pour moi.
Entendre le point de vue des arabes sur ces grandes expéditions des occidentaux en Palestine, à Jérusalem et plus largement dans les pays de l’Islam entre 1096 et 1291 m’ouvrit d’autres horizons et me fit comprendre qu’il faut accueillir le point de vue de l’autre pour comprendre un évènement dans toute sa dimension.
Dans cet essai Amin Maalouf s’inspire des historiens et des chroniqueurs arabes de l’époque pour raconter comment fut ressenti, dans la civilisation islamique raffinée et sophistiquée de cette époque, l’arrivée des chrétiens pillant, massacrant et ne reculant devant aucune horreur par rapport à « l’autre » qui était « l’infidèle » celui qui ne partageait pas la même religion.

Amin Maalouf fait partie de ces intellectuels qui se révèlent dans le livre « Comprendre de Monde » élaboré à partir de la Revue XXI.
L’entretien qui a été mené par Maxime Amieux et Myriam Blal a été publié dans le N°26 de la revue XXI paru au printemps 2014. Il avait pour titre « Se mettre à la place de l’autre »
Il évoque d’abord son enfance au Liban, tant il est vrai que beaucoup se joue pendant l’enfance.
« Mon père était un homme très doux. Ma mère avait peur pour nous, elle nous protégeait plus que nous le voulions. […]. J’ai toujours vécu à la maison au milieu des journaux et des livres. Mon père recevait la plupart des quotidiens du pays. Le matin, nous recevions toute la presse quotidienne. Depuis mes 7 ans, nous nous installions ensemble avec un peu de café et nous parcourions l’actualité.
Mon père enseignait, comme certains de ses frères et sœurs. Enfant, je l’ai vu journaliste et enseignant. La sœur de mon père, dont nous étions proches, était professeur à l’université américaine de Beyrouth. Elle venait souvent nous raconter la vie de l’université. Le savoir et l’information étaient très présents. J’ai grandi dans une maison où mon père écrivait, je l’ai toujours vu écrire et, pour moi, travailler c’était écrire. La vie a fait que j’ai écrit plus que d’autres, mais je savais que j’allais avoir un métier d’écriture. J’en étais certain »
Ses parents organisent de nombreuses réceptions avec l’élite intellectuelle du Liban et de Beyrouth. Une divergence de point de vue allait naître entre Amin est ses parents.
« Oui, ces réceptions commencent à partir de 1963. Mon père, Rushdi, vient de fonder son journal. Il loue avec ma mère un très bel appartement de cinq cents mètres carrés à Beyrouth. Nous venons de quitter le quartier cosmopolite de Ras-Beyrouth pour nous installer dans un quartier à majorité chrétienne. Des ministres, des députés, des directeurs de journaux, des intellectuels […] viennent à la maison et je participe à ces activités mondaines avec mes sœurs. Mais à partir de 1964, mes idées commencent à différer de celles de mes parents. Je suis révolté contre le système communautaire au Liban, contre les inégalités, contre le colonialisme.
Mes parents reçoivent les notables du pays, et moi, je me mets à recevoir et organiser des réunions d’étudiants de gauche, dans l’esprit de ce que connaîtra la France en 1968. C’est ainsi que je rencontre des militants venus d’ailleurs : des Erythréens, des Sud-Africains. Olivier Tambo, alors président du Congrès national africain, le parti de Nelson Mandela, est venu une fois, j’avais 17 ans. Notre maison était grande, il était pratique de s’y réunir à plusieurs. Je faisais partie des dizaines d’étudiants libanais militants, mais je n’ai jamais eu de véritable rôle.
Mon père acceptait le fait que nous ne soyons pas d’accord, même s’il était mal à l’aise que je critique son entourage. Cela n’a pas affecté nos relations, mais nous étions en tension.»
Mais la guerre civile éclate au Liban, sous ses fenêtres, le 13 avril 1975. Ce qui va le conduire à quitter son pays natal pour venir en France :
« C’était un dimanche. Je rentrais de reportage. Je m’étais rendu au Bangladesh, en Thaïlande et au Vietnam où j’avais assisté au début de la bataille de Saïgon. J’avais quitté le Vietnam le 10 avril, pour me rendre à New Delhi où j’ai rencontré Mme Gandhi.[…] Le lendemain, un samedi, je suis monté ) à bord du Pan American 001, qui assurait la liaison New Delhi-Karachi-Téhéran-Beyrouth. On croit rêver aujourd’hui ! C’était un vol de nuit. Je suis arrivé à Beyrouth le matin du 13 avril 1975. Vers midi, j’étais chez moi avec ma femme et notre fils. C’est alors que nous avons entendu des tirs puis des cris. Nous avons sorti la tête pour regarder par la fenêtre de notre chambre et aperçu un autobus arrêté à un carrefour, à une centaine de mètres de chez nous. Il y avait un attroupement d’individus autour du car, qui discutaient avec des personnes armées. Soudain, nous entendons des tirs. Nous nous cachons derrière le mur. Au bout d’une dizaine de secondes, silence. Nous sortons discrètement nos têtes à travers la fenêtre. Il devait y avoir une vingtaine de cadavres au sol. J’ai appelé mon père pour le prévenir que nous ne pouvions aller déjeuner chez lui. Je me souviens lui avoir dit : « Je crois que la guerre a commencé. » Le soir même, notre quartier était sous les bombes. »
 C’est donc ainsi que la guerre a éclaté entre les communautés du Liban. Le Liban qui avait la réputation d’être la Suisse du proche orient.
C’est donc ainsi que la guerre a éclaté entre les communautés du Liban. Le Liban qui avait la réputation d’être la Suisse du proche orient.
La<guerre du Liban> qui s’est déroulée de 1975 à 1990 a fait entre 130 000 et 250 000 victimes pour un pays de 5 000 000 d’habitants. Comme toute guerre civile, elle fut le théâtre de massacres et d’horreurs.
Amin Maalouf et sa famille ont voulu rester au Liban, mais le déchainement de la violence a été trop intense. Ils ont finalement quitté le Liban en juin 1976.
Cette terrible expérience l’a conduit aux réflexions sur la place de l’autre et la nécessité de le comprendre pour s’entendre.
Cet homme issu de la communauté chrétienne du Liban et qui évoque souvent le monde chrétien comme le monde musulman manifeste une relation singulière à la spiritualité et aux croyances. Il répond à la question : Êtes vous croyant ?
« Si l’on entend par croyant être adepte d’une religion particulière, pas vraiment. Le dogme ne m’intéresse pas. Est-ce que je crois en revanche que le monde ne fonctionne que par des forces matérielles ? Non plus. Je ne suis pas un athée, je ne pense pas que monde soit arrivé par un jeu de molécules. Nous avons besoin d’une dimension spirituelle. Un des drames du XXème siècle est d’avoir laissé fleurir des idéologies totalitaires qui ont cherché à expulser la religion. Cela a abouti à des désastres. »
 La partie la plus importante à mon sens de cet entretien consiste à cet appel de sagesse de se mettre à la place de l’autre. Amin Maalouf tire cette intelligence d’abord de sa position de minoritaire au Liban et aussi de sa double appartenance au Liban et à la France.
La partie la plus importante à mon sens de cet entretien consiste à cet appel de sagesse de se mettre à la place de l’autre. Amin Maalouf tire cette intelligence d’abord de sa position de minoritaire au Liban et aussi de sa double appartenance au Liban et à la France.
Ayant grandi au Liban, j’ai conscience depuis ma naissance de faire partie d’une minorité. En France, les recherches liées aux origines ethniques et à la religion sont interdites, ce qui est compréhensible et honorable. Mais au Liban, c’est impensable : là-bas, chacun connaît sa communauté d’appartenance. C’est inscrit sur les papiers d’identité, ça détermine l’école où chacun ira. Nous naissons avec la conscience d’appartenir à une communauté.
A partir de cette conscience communautaire, certains vont développer des attitudes hostiles envers les autres communautés, d’autres vont rêver d’établir des rapports harmonieux et vont consacrer leur vie à essayer de bâtir des passerelles. La question du vivre ensemble est une interrogation présente depuis ma naissance. Elle ne se pose pas de la même manière au Liban, en Bosnie, en France ou ailleurs, mais elle se pose partout.
Je viens d’une petite communauté. Et j’ai appris que lorsqu’on appartient à une petite minorité, on ne cherche pas à dominer, mais à mettre de l’huile dans les rouages. C’est dans une société réconciliée que nous vivons le mieux. Quand il y a des conflits, les petites communautés sont les premières victimes et les premières à fuir. Les plus faibles ont peur d’être écrasés ; les plus forts, peur d’être envahis.
Mais le monde change, il est devenu pluriel. Nous sommes chacun devenus les minoritaires des autres. De fait, personne ne peut plus considérer qu’il peut tout dicter. […]
Quand je suis avec des amis libanais, je parle du Liban comme si j’étais libanais.
Quand je suis avec des amis français, parle de politique intérieur en tant que Français. Mais, dans un cas comme dans l’autre, personne n’ignore, ne serait ce qu’à cause de mon accent, que je viens d’ailleurs et que mon regard est celui de quelqu’un d’extérieur. […]
Lorsque nous essayons d’établir des relations harmonieuses, la première attitude indispensable est d’être capable de se mettre à la place de l’autre. Si je peux me mettre à la place de l’autre, alors nous pouvons réfléchir ensemble. Si chacun reste à sa place, aucun de nous ne peut comprendre les besoins et les préoccupations de son interlocuteur. Il n’y a pas uniquement « moi » et « l’autre ». En « moi », il y a un peu de « l’autre », et en « l’autre », il y a un peu de « moi ». Se mettre à la place de « l’autre », c’est le commencement de la sagesse.
Et il finit par un exemple tout simple de la vie quotidienne et intime :
Dans l’intimité, nous pouvons ressentir les besoins de l’autre. Ma femme, Andrée, sait que l’écriture est essentielle pour moi, qu’elle est ma vie, que je pourrais passer ma vie entière à écrire. Mais elle sait également que lorsqu’elle m’exprime un besoin important, elle est prioritaire sur tout. »
C’est avec cet invitation à se mettre à la place de l’autre que je finis cette série de mots du jour que j’ai tirée du livre « Comprendre le monde » qui récapitulait certain des grands entretiens que la Revue XXI avait réalisé et publié avant fin 2016, date de la publication de cet ouvrage.
Amin Maalouf comme Tobie Nathan, dont j’ai parlé vendredi 29 mai, font partie de ces éclaireurs qui s’intéressent aux autres, d’abord par respect, puis pour comprendre et avancer ensemble, enfin pour s’enrichir spirituellement.
<1434>

Je crois moi que la première attitude est de savoir écouter l’autre pour le comprendre plutôt que d’essayer artificiellement de se mettre à sa place
Tu joues un peu sur les mots. Je prendrai un seul exemple : pour tous ceux qui critiquent de manière acerbe Macron. Le seul conseil que je puisse leur donner c’est de se mettre à sa place, s’imaginer être dans son bureau de l’Élysée et alors de se demander je fais quoi ? et si je prends telle ou telle mesure quelles conséquences rationnelles pourraient suivre cette décision ?
J’ai évoqué les croisades, pour essayer de comprendre il faut bien essayer de se mettre à la place de réfléchir comment je réagis si je vis dans cette région avec son contexte, son environnement et que des gens extérieurs avec les mœurs des francs débarquent chez moi ?
Il ne s’agit pas de se croire artificiellement l’autre bien sûr, mais d’essayer de regarder le monde, appréhender la situation en me mettant dans la position de l’autre. Je pense que c’est fécond et permet de lancer le mouvement de mieux comprendre l’autre.