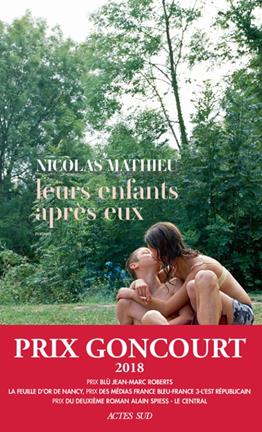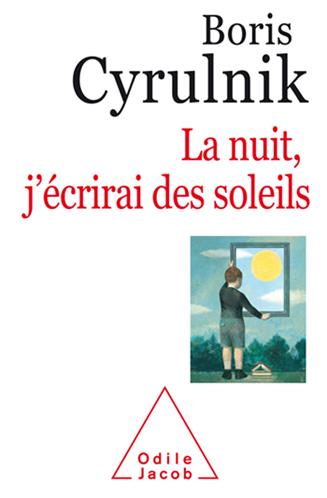« Le Petit Prince, un livre pour enfant ? »
Question que je me pose et que je pose
Gérard Philippe est mort le 25 novembre 1959, à 36 ans, d’un cancer du foie qui l’a emporté en 3 mois. C’était donc il y a 60 ans et 2 jours.
 Un article du Figaro : «La mort il y a soixante ans de Gérard Philipe a provoqué un tsunami» renvoie vers un livre de Jérôme Garcin qui vient de paraître : « Le dernier hiver du Cid »
Un article du Figaro : «La mort il y a soixante ans de Gérard Philipe a provoqué un tsunami» renvoie vers un livre de Jérôme Garcin qui vient de paraître : « Le dernier hiver du Cid »
Gérard Philippe a beaucoup contribué à la popularité du « Petit Prince » de Saint Exupéry lorsque parut, en 1954, son enregistrement du conte, toujours disponible.
Cet enregistrement de 1954 célébrait les dix ans de la mort de Saint-Exupéry.
Sa voix envoutante qui distillait l’émotion a su porter ce conte à la dimension d’un mythe.
Antoine de Saint-Exupéry qui est né à Lyon en 1900, n’est pas non plus mort vieux. Il a disparu, pendant la guerre, en vol le 31 juillet 1944 au large de Marseille. Il est mort pour la France.
Le « Petit Prince » a été publié à New York en 1943, donc un an avant son décès.
Le livre du « Petit Prince » selon Wikipedia a été vendu à plus de cent quarante-cinq millions d’exemplaires dans le monde et douze millions d’exemplaires en France. Il est traduit en 270 langues et dialectes, ce qui en fait l’ouvrage de littérature le plus vendu au monde et le plus traduit après la Bible.
Comme beaucoup, j’ai succombé à ce mythe. J’ai cédé à la faiblesse d’acheter un de ces mobiles qu’on trouve dans tous les magasins d’enfants représentant le petit prince dans son univers. Mobile que nous avons accroché dans la chambre des enfants, à Montreuil.
Récemment, j’ai retrouvé ce mobile. Ma première réaction a été de vouloir l’offrir à d’autres enfants. Mais les années avaient passé et ma réflexion a évolué et je n’ai pas persévéré dans ce souhait.
Peut-on remettre en cause le mythe du Petit Prince ?
Je pense que nous devons questionner tous les mythes, mythes religieux, mythes nationalistes et mythes littéraires.
Très récemment, un article de France Culture sur Facebook m’a conduit à une réaction d’humeur et à de beaux échanges avec d’autres personnes qui ont tenté de me convaincre que je ne voyais pas toute la complexité du Petit Prince.
« Voici mon secret. Il est très simple : on ne voit bien qu’avec le cœur. L’essentiel est invisible pour les yeux ».
Une de ces phrases du Petit Prince qu’on aime à distiller dans des conversations, quand ils touchent un peu plus à l’intime. Mais avant de venir à cette discussion sur Facebook, parce que Oui on peut avoir des conversations intelligentes sur Facebook avec des inconnus avec qui on partage des valeurs et des sujets de conversation qui ont du sens.
Mais avant de venir à ces échanges, quelques éléments un peu factuels.
A peu près dans tous les pays du monde si vous cliquez sur ce lien : <Le Petit Prince> vous tombez sur un site canadien qui donne accès gratuitement au texte intégral du « Petit Prince » écrit il y a 76 ans.
Mais si vous êtes en France, cela ne fonctionne pas.
Au Canada, l’œuvre est entrée dans le domaine public mais pas en France.
Dans la plupart des pays du monde, c’est la Convention de Berne qui s’applique avec une protection de 50 ou 70 ans révolus après la mort de l’auteur. Aux États-Unis c’est plus compliqué et plus long, vous pouvez approfondir avec <cet article> si vous le souhaitez.
Mais « Le Petit Prince », comme le reste de l’œuvre de Saint-Exupéry, reste en France protégé par le droit d’auteur jusqu’en 2032. Cette exception tient à l’extension de la durée des droits concernant les auteurs morts pour la France avec en plus une prorogation de guerre, comme toutes les œuvres publiées avant 1948. Dans les autres pays du monde, où la durée de soixante-dix ans après la mort de l’auteur est en vigueur, l’œuvre de Saint-Exupéry est bien dans le domaine public depuis le 1er janvier 2015, 70 ans après la fin de la guerre. Au Canada et au Japon, où la durée des droits n’est valable que cinquante ans après la mort de l’auteur, le Petit Prince est déjà dans le domaine public depuis 1995.
C’est bien naturel quand les enfants de l’auteur ont la douleur de perdre leur père pendant la guerre, de leur donner quelques signes de réconfort et de reconnaissance supplémentaire sous la forme d’espèces sonnantes et trébuchantes.
Antoine de Saint Exupéry n’avait pas d’enfants.
Mais il a des héritiers et il existe même un légataire universel de la veuve. Et tous ces gens se disputent le magot. La <Justice a dû intervenir> notamment concernant les produits dérivés, comme ce mobile que je ne veux plus donner à un enfant.
Dans le clan des héritiers, il y a la famille Giraud d’Agay qui descend de la sœur cadette de Saint-Exupéry, et José Martinez-Fructuoso, ancien secrétaire de l’épouse de Saint Exupéry, Consuelo, qu’elle a désigné comme légataire universel.
Bien entendu, comme c’est déjà le cas pour les personnages de Tintin et de Zorro, les héritiers de Saint-Exupéry ont déposé le personnage du roman comme marque de commerce jusqu’en juin 2028.
Donc chaque fois que vous achetez une bricole qui a un rapport avec « Le Petit Prince », celui qui dit :
« Les hommes n’ont plus le temps de rien connaître. Ils achètent des choses toutes faites chez les marchands. Mais comme il n’existe point de marchands d’amis, les hommes n’ont plus d’amis. (Chap. XXI) »
le tiroir-caisse de ces rapaces tinte délicatement avec le son métallique des pièces de monnaie qui y tombe. Bien sûr, cela est encore beaucoup moins poétique dans la réalité, ces sommes alimentent automatiquement et informatiquement la ligne dématérialisée et sans âme d’un compte en banque.
Ils font certainement une lecture orientée de cette autre phrase :
« Il faut exiger de chacun ce que chacun peut donner. (Chap. X) »
Il y a bien sûr une boutique en ligne pour vous permettre de faire de magnifiques cadeaux de Noël. Une boutique en ligne qui vend 80.000 produits chaque année. Plus de 800 références y sont disponibles, livraison dans le monde entier
Elle a une adresse toute simple : https://www.lepetitprince.com/
Il y a un tel décalage, entre le discours tenu par le Petit Prince et toute la camelote autour qui est vendue au profit d’un mercantilisme le plus obscène. Je trouve cela d’autant plus choquant pour ce livre précisément. Je ne suis pas seul à critiquer les héritiers mercantiles. Vous trouverez un article dans L’express qui détaille les obsessions des ayants droits à utiliser tout prétexte, tout vague anniversaire pour organiser des commémorations promptes à dégager des revenus : <Le Petit Prince : le grand ras-le-bol !>
Mais passons au fond sur l’Histoire. La publication de France Culture que j’ai évoquée est celle-ci : Pourquoi il faut relire « Le Petit Prince » d’Antoine de Saint-Exupéry
Avec cette entame : « Le Petit Prince » : qu’est-ce que c’est ? Une histoire pour enfants ? Un conte fantastique ? Un conte philosophique ? Peut-être tout cela à la fois… Dans tous les cas, le plus grand livre de la littérature du XXe siècle pour le philosophe Martin Heidegger ! Une œuvre assurément attentive au présent. »
C’est bien d’en appeler au grand philosophe allemand « Martin Heidegger » au goût si sûr puisqu’il jugeait aussi avec grande bienveillance et admiration le national socialisme. Il adhéra au Parti nazi en 1933 alors qu’il avait déjà 44 ans et une réputation de philosophe affirmé. Il resta nazi jusqu’en 1944.
Je critique le Petit Prince mais je ne comprends pas bien le lien qui peut exister entre la doctrine nazi et le contenu du Petit Prince. Mais Heidegger n’est pas le seul à classer le Petit Prince en haut de l’affiche.
En 1999, la Fnac et Le Monde ont tenté de trouver un comité capable d’établir un classement français des livres considérés comme les cent meilleurs du XXe siècle.
« Le Petit Prince » termine quatrième, devancé par « L’Étranger » d’Albert Camus, « À la recherche du temps perdu » de Marcel Proust et « Le Procès » de Franz Kafka.
Ce type de palmarès me semble assez vain pour les œuvres de l’esprit.
Mais que « Le Petit Prince » devance « Les raisons de la colère » de Steinbeck ne me convainc pas et ce n’est qu’un exemple parmi d’autre.
Il faut bien comprendre que je ne nie pas les qualités de ce livre mais je trouve qu’on en fait trop et surtout je prétends que ce n’est certainement pas un livre pour enfant, ou alors il faut mentir aux enfants ou travestir la réalité.
Donc j’ai réagi à la publication de France Culture par cette envolée :
« Je ne partage pas l’enthousiasme du plus grand nombre.
Un livre pour enfant ?
C’est l’histoire d’un petit prince poète et malheureux.
Et la porte de sortie qu’il trouve est le suicide.
Ce n’est pas un livre d’enfant, c’est un livre de dépressif qui finit mal ! »
A ce niveau il y a toujours quelqu’un pour marquer son étonnement : « Ah bon le Petit Prince se suicide ? »
Dans le fil de la discussion, la question qui est venue avec 4 points d’interrogations « A quel moment il se suicide ???? »
Eh bien, à l’avant dernier chapitre, le 26, il le fait à la Cléopâtre.
Il y a des circonvolutions, des échanges avec le narrateur qui dilue un peu le récit. Mais il suffit de lire :
« Le petit prince dit encore, après un silence : – Tu as du bon venin ? Tu es sûr de ne pas me faire souffrir longtemps ?
[…]
Alors j’abaissai moi-même les yeux vers le pied du mur, et je fis un bond ! Il était là, dressé vers le petit prince, un de ces serpents jaunes qui vous exécutent en trente secondes. Tout en fouillant ma poche pour en tirer mon revolver, je pris le pas de course, mais, au bruit que je fis, le serpent se laissa doucement couler dans le sable, comme un jet d’eau qui meurt, et, sans trop se presser, se faufila entre les pierres avec un léger bruit de métal.
Je parvins au mur juste à temps pour y recevoir dans les bras mon petit bonhomme de prince, pâle comme la neige.
– Quelle est cette histoire-là ! Tu parles maintenant avec les serpents !
[…]
– Je suis content que tu aies trouvé ce qui manquait à ta machine. Tu vas pouvoir rentrer chez toi…
– Comment sais-tu !
Je venais justement lui annoncer que, contre toute espérance, j’avais réussi mon travail !
Il ne répondit rien à ma question, mais il ajouta:
– Moi aussi, aujourd’hui, je rentre chez moi…
[…]
– Cette nuit… tu sais… ne viens pas.
– Je ne te quitterai pas.
– J’aurai l’air d’avoir mal… j’aurai un peu l’air de mourir. C’est comme ça. Ne viens pas voir ça, ce n’est pas la peine…
[…]
– Tu comprends. C’est trop loin. Je ne peux pas emporter ce corps-là. C’est trop lourd.
[…]
Et il se tut aussi, parce qu’il pleurait…
– C’est là. Laisse-moi faire un pas tout seul.
Et il s’assit parce qu’il avait peur.
[…]
– Voilà… C’est tout…
Il hésita encore un peu, puis il se releva. Il fit un pas. Moi je ne pouvais pas bouger.
Il n’y eut rien qu’un éclair jaune près de sa cheville. Il demeura un instant immobile. Il ne cria pas. Il tomba doucement comme tombe un arbre. Ça ne fit même pas de bruit, à cause du sable. »
Peut-être certains seront-ils scandalisés par ce traitement aux ciseaux du chapitre. Mais quand on enlève, l’enluminage, le rêve, les histoires qu’on raconte pour supporter la réalité de la mort : c’est un suicide.
Des internautes ont tenté de me convaincre
« C’est l’enfance qui cède sa place ! En ce qui concerne la mort du Petit Prince, c’est une métamorphose initiatique. »
Ou
« Ce n’est pas un suicide, mais une transformation. Tel Dante, le petit Prince quitte son corps de chair pour s’élever dans les étoiles. »
Évidemment, si on fuit le réel et on se réfugie dans le mythe, on arrive à écrire que se donner la mort est une transformation. Je rappelle Camus : « mal nommer les objets, c’est ajouter du malheur au monde. »
Je me souviens que les adeptes du temple solaire parlaient aussi en allégorie et en langage transcendantal. Ils pensaient se retrouver sur Sirius.…
Je m’insurge sur le fait de dire que c’est un conte pour enfant.
Quel serait le message de ce conte pour enfant ?
Quand on ne se sent pas bien nulle part, il faut mourir ?
Il y a dans ce livre de la dépression, de la collapsologie avant l’heure et l’odeur de la mort
Rien de ce que je dis n’est absolu. Je ne prétends pas dire la vérité qui n’existe pas d’ailleurs dans cette matière. Je pousse seulement les gens à se questionner, à interroger et non pas à suivre la foule et dire comme cette histoire est belle, poétique et instructive !
Vous apprendrez dans cet article que <Le Petit Prince est le fruit d’un chagrin d’amour>
Un des internautes qui croit aux grandes vertus de ce petit livre a fini notre conversation de réseaux sociaux sur ce petit texte et je lui laisse, bien volontiers, le dernier mot
« Tout est contenu dans tout: le mal dans le bien, le bien dans le mal, comme le laid dans le beau ou le beau dans le laid. Ainsi, une parole lumineuse peut dissimuler un dessein sombre, de même qu’un langage rustre peut dissimuler une âme pure et belle. L’allégorie n’est qu’une forme ou une apparence pour dissimuler un autre sens que ce qui est immédiatement lu.
Nous ne sommes pas jury littéraire, critique ni censeur. Chacun reçoit une œuvre et l’apprécie au regard de son histoire personnelle, de sa culture, son éducation, ses valeurs ou ses croyances. Ce que vous ressentez ne se juge pas.
Au moins, je constate un point en faveur de l’œuvre: elle ne vous indiffère pas. Elle nous amène d’ailleurs à échanger et partager nos avis ici. Même à travers un ressenti contradictoire, le Petit Prince réunit.
C’est toute la puissance d’une œuvre littéraire au-delà de sa résonance immédiate : que laisse-t-elle dans la culture, quelle empreinte imprime-t-elle dans l’histoire ? Une œuvre qui dépasse les générations, qui séduit petits et grands, qui s’étudie de l’école à l’université reste un marqueur de notre temps, de notre société, de notre pensée.
Ne pas y avoir été sensible ne vous éloigne aucunement d’une quelconque vérité. J’imagine que votre sensibilité s’exprime ailleurs et c’est toute la richesse de la diversité humaine. Peut-être avons-nous une lecture commune qui nous rassemble entièrement ? A l’inverse, peut-être êtes-vous marqué par une œuvre à côté de laquelle je suis passé sans la moindre émotion ?
Quant au marketing littéraire, comment ne pas vous rejoindre ? Tout ce qui peut rapporter de l’argent est source de commerce. Du magnifique à l’abject, de l’utile au futile.
Le marketing nous retient dans la matérialité, ce que le Petit Prince justement nous invite à dépasser. Souvenez-vous : « on ne voit bien qu’avec le cœur. L’essentiel est invisible pour les yeux. »
<1316>
 L’immense auteur des « Raisins de la Colère », « A l’est d’Eden », « Des souris et des hommes » voulait exprimer par cette phrase que les américains exploités n’avaient pas de conscience de classe. Ils ne considéraient pas qu’ils faisaient partie d’une même classe mais ils croyaient au récit du rêve américain qui prétendait que tout le monde avait la possibilité de devenir riche s’il travaillait beaucoup et savait saisir les opportunités qui lui étaient offerts.
L’immense auteur des « Raisins de la Colère », « A l’est d’Eden », « Des souris et des hommes » voulait exprimer par cette phrase que les américains exploités n’avaient pas de conscience de classe. Ils ne considéraient pas qu’ils faisaient partie d’une même classe mais ils croyaient au récit du rêve américain qui prétendait que tout le monde avait la possibilité de devenir riche s’il travaillait beaucoup et savait saisir les opportunités qui lui étaient offerts.



 Nul ne saurait, quand il assiste à un tel échange, douter de ce qu’un chef apporte à son orchestre. Il est vrai que Jansons est le directeur musical de l’orchestre de la radio de Bavière depuis 16 ans.
Nul ne saurait, quand il assiste à un tel échange, douter de ce qu’un chef apporte à son orchestre. Il est vrai que Jansons est le directeur musical de l’orchestre de la radio de Bavière depuis 16 ans.