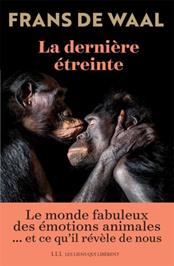Franciscus Bernardus Maria de Waal, plus connu sous le nom de Frans de Waal est né en 1948 aux Pays-Bas. C’est un primatologue et un éthologue.
La primatologie est la discipline qui étudie les espèces de l’ordre des Primates donc essentiellement les singes, les humains et leurs ancêtres.
L’éthologie est l’étude scientifique du comportement des espèces animales, incluant l’humain, dans leur milieu naturel ou dans un environnement expérimental, par des méthodes scientifiques d’observation et de quantification des comportements animaux.
Deux mots du jour lui ont déjà été consacrés :
- Le 28 juin 2017 : « Est-ce que l’homme est plus intelligent que le poulpe ? On ne sait pas »
- Le 25 janvier 2019 : « La dernière étreinte » qui était le titre de son dernier livre, pour l’instant. Il portait pour sous-titre : « le monde fabuleux des émotions animales et ce qu’il révèle de nous »
 Frans de Waal a fait l’objet d’un entretien de la revue XXI, c’était dans le numéro 12 paru en octobre 2010.
Frans de Waal a fait l’objet d’un entretien de la revue XXI, c’était dans le numéro 12 paru en octobre 2010.
L’entretien, qui avait été mené par Pierre Vandeginste a été repris dans l’ouvrage « comprendre le monde
Dans son introduction le journaliste présente Frans de Waal de la manière suivante :
« L’homme descend du singe ? alors observons les singes pour mieux comprendre l’homme ! Tel est le point de départ du travail considérable abattu par Frans de Waal.
Il explique comment lui est venu le principal objet de ses études : l’observation de l’empathie chez les grands singes :
« Dans les années 1970, j’étais étudiant aux Pays-Bas et le grand sujet à la mode en éthologie était l’agression. C’était l’un des thèmes favoris de Konrad Lorenz, lauréat du prix Nobel 1973 qui avait publié en 1969 : « l’Agression, une histoire naturelle du mal ».
J’ai commencé à travailler sur ce sujet. Et, très vite, j’ai été surpris. J’ai constaté en observant des macaques, à Utrecht, que les conflits étaient rares et brefs. Et surtout, ils étaient séparés par de longues périodes pacifiques pendant lesquelles les ennemis de la veille vivaient en bonne entente. »
 Et il raconte des choses étonnantes qu’il a vu :
Et il raconte des choses étonnantes qu’il a vu :
« Un jour, mon attention a été attirée par une étrange scène : après une sévère bagarre, le groupe encerclait deux chimpanzés qui s’embrassaient, en les encourageant bruyamment. Or les deux singes s’étaient battus dix minutes plus tôt. Je venais de découvrir la réconciliation chez les primates.
J’ai longuement étudié le phénomène. Régulièrement, après une bagarre, je voyais les protagonistes entamer ce patient processus de réconciliation, qui les ramène l’un vers l’autre. Pendant un certain temps, ils gardent leurs distances, évitent de se croiser. Puis, insensiblement, ils se rapprochent, sans se regarder. Ils finissent par se trouver à proximité, mais dos à dos. Arrive enfin le moment où ils rétablissent le contact. Ils se rapprochent un peu plus, toujours sans croiser leur regard. Jusqu’à ce que l’un des deux pose une main – tout à fait par hasard – sur le dos de son adversaire pour se mettre négligemment à l’épouiller. »
Le plus étonnant de cette expérience, ce n’est finalement pas que Frans de Waal ait fait ces constats, mais c’est que la communauté scientifique ne les a pas tout de suite accepté et reconnu :
« A l’époque, tout comportement considéré comme négatif pouvait être associé aux animaux sans choquer. A l’inverse, les esprits n’étaient pas prêts à entendre que l’on observe chez l’animal, fut-il primate, un comportement présumé « humain ».
L’agression étant considérée comme quelque chose de « mal », il semblait logique que les bêtes en soient aussi capables. L’idée commune était que l’agressivité des hommes tenait à leur lointaine condition animale, ce n’était donc pas un problème d’utiliser le même mot pour parler de ce type de comportement chez l’homme et chez l’animal.
Pour ma part, je n’ai jamais considéré l’agression comme quelque chose de « mauvais ». C’est simplement une réalité biologique, un comportement que la sélection naturelle a retenu parce qu’il améliore la survie des individus »
Frans de Waal ne peut pas être considéré comme un homme naïf croyant à la bienveillance générale. Il a simplement observé que la bienveillance existait chez les primates, comme le désir de réconciliation.
Mais il a aussi constaté que les grands singes étaient des animaux politiques :
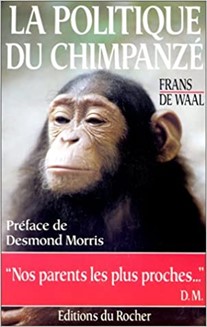 « Dans mon premier ouvrage pour le grand public « la Politique du chimpanzé », nos proches cousins ne sont pas présentés sous leur meilleur jour. C’est même souvent leur machiavélisme que je pointe.
« Dans mon premier ouvrage pour le grand public « la Politique du chimpanzé », nos proches cousins ne sont pas présentés sous leur meilleur jour. C’est même souvent leur machiavélisme que je pointe.
Par la suite il va s’installer aux Etats-Unis, à Atlanta au Yerkes, un centre de recherche sur les primates, où il disposera de moyens de recherche tout à fait remarquables. Lui et son équipe réalise des expériences sur des thèmes comme le partage de la nourriture, la réciprocité, la coopération et la résolution de conflits. Et son analyse est la suivante :
« Ces résultats scientifiques montrent qu’à des degrés divers, les grands singes, notamment le chimpanzé et le bonobo, mais aussi des petits singes comme le capucin ou le macaque, sont capables de certains comportements que nous avons l’habitude de qualifier de « moraux ».
Il devient de plus en plus raisonnable de soutenir l’hypothèse que la propension humaine à se préoccuper du bien d’autrui est apparue bien avant nous, et s’appuie sur des mécanismes présents depuis longtemps au cours de l’évolution. »
Il publie en 1996 un ouvrage au titre provocateur : « Le bon singe » dans lequel il entend étudier les origines du bien et du mal chez les humains et d’autres animaux :
« J’ai voulu poser clairement la question de la morale en termes évolutionnistes. »
Cet ouvrage suscite des réticences chez certains chercheurs qui l’accuse d’appliquer une grille de lecture humaine au comportement animal, de se laisser subjuguer par son amour des animaux. Il conteste cela et invente un nouveau concept « l’anthropodéni » :
« Nos expériences sont réalisés dans des conditions rigoureuses. […] Nous nous donnons beaucoup de mal pour nous en tenir à des faits observables, mesurables. […]
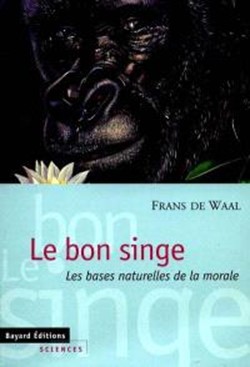 J’ai fini par construire le « anthropodéni », anthropodenial en anglais. L’anthropomorphisme consiste à prêter abusivement une caractéristique humaine à un animal. A contrario, quand tout montre que certains animaux partagent réellement quelque chose avec l’homme, mais que, pour des raisons extérieures, philosophiques, religieuses ou autres, on ne veut pas le voir, c’est une attitude que je propose de nommer « anthropodéni ».
J’ai fini par construire le « anthropodéni », anthropodenial en anglais. L’anthropomorphisme consiste à prêter abusivement une caractéristique humaine à un animal. A contrario, quand tout montre que certains animaux partagent réellement quelque chose avec l’homme, mais que, pour des raisons extérieures, philosophiques, religieuses ou autres, on ne veut pas le voir, c’est une attitude que je propose de nommer « anthropodéni ».
Dans la conclusion de l’article, l’éthologue donne sa conviction :
« Aujourd’hui encore, des économistes, des hommes politiques, notamment dans le camp républicain aux Etats-Unis, émaillent de justifications naturalistes leurs discours prônant le chacun pour soi. A les entendre, puisque l’homme est naturellement égoïste, il serait contre-nature de proposer des réformes allant dans le sens de la solidarité ou d’une réduction des inégalités. Nous ne serions, disent-ils, que motivés par la conquête du pouvoir, l’accumulation de biens matériels, sans aucune considération pour les autres.
Ces discours sont anciens. Darwin avait à peine publié que, déjà, on lui faisait dire – au mépris de ses textes – que l’homme se devait d’être un loup pour l’homme. Au nom du struggle for life*, de la lutte pour la survie, ce qu’il n’a jamais écrit.
Pour un biologiste, tout particulièrement pour un éthologue, c’est énervant, pour ne pas dire plus. A fortiori quand vous avez passé quarante ans à étayer la thèse inverse. Pour ma part, j’en suis sûr : le sens de la solidarité nous vient du fond des âges, il est profondément ancré dans notre nature. »
<1432>




 Nul ne saurait, quand il assiste à un tel échange, douter de ce qu’un chef apporte à son orchestre. Il est vrai que Jansons est le directeur musical de l’orchestre de la radio de Bavière depuis 16 ans.
Nul ne saurait, quand il assiste à un tel échange, douter de ce qu’un chef apporte à son orchestre. Il est vrai que Jansons est le directeur musical de l’orchestre de la radio de Bavière depuis 16 ans.