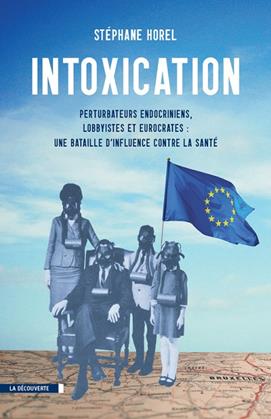Le concept de guerre civile globale est extrait de « Age of Anger » (âge de la colère) qui est un livre d’un romancier d’origine indienne, Mishra Pankaj qui selon « Le Point » est l’essai le plus commenté en ce début d’année dans le monde anglo-saxon.
Ce livre dont le sous-titre est « Une histoire des temps présents » n’est pas encore traduit en français, mais le magazine Le Point a publié une longue interview de cet auteur qui analyse notre présent non comme un choc des civilisations mais comme une explosion de colère née d’une intense frustration : <vers la guerre civile mondialisée ?>
 Sa thèse c’est que symptômes que nous percevons (Election de Trump, éclosion des populismes, des régimes autoritaires et des manifestations de nationalismes et de xénophobie sont le signe d’une « guerre civile globale » opposant une élite cosmopolite et libérale à des masses frustrées de ne pas voir les fruits du progrès tant vanté.
Sa thèse c’est que symptômes que nous percevons (Election de Trump, éclosion des populismes, des régimes autoritaires et des manifestations de nationalismes et de xénophobie sont le signe d’une « guerre civile globale » opposant une élite cosmopolite et libérale à des masses frustrées de ne pas voir les fruits du progrès tant vanté.
Ses prévisions sont peu optimistes, il pense que la colère des masses ne va que s’accroître, car ses racines sont profondes.
Le Point commente :
« Dérangeant et pessimiste, rempli de bruit et de fureur, cet Age of Anger est éminemment discutable, mais personne, même pas le très libéral The Economist, n’a nié la puissance et l’ampleur [de cet] essai »
J’en tire quelques extraits :
« Selon Pankaj Misrah, c’est tout le programme des Lumières qui, dès le départ, contient un bug : en voulant façonner des individus libres, rationnels, mais soumis à la compétition et au désir mimétique, il porte en lui le virus du « ressentiment » ».
Tout se résume au fond à l’opposition entre Voltaire et Rousseau, réunis au sein du Panthéon, mais dont la rivalité n’a pas fini de faire des émules.
D’un côté, le chantre de la raison et du libéralisme anglo-saxon, qu’on qualifierait aujourd’hui de membre d’une « élite » coupée du peuple.
De l’autre, le rejeté de la bonne société parisienne, le paria paranoïaque qui a le premier annoncé toutes les passions négatives que pouvait susciter la société moderne.
« C’est triste de voir qu’on réchauffe [la] théorie de la guerre des civilisations qui se fonde sur des différences absolues culturelles et raciales… C’est ce genre de pensées qui motivent des personnes comme Stephen Bannon, le suprématiste blanc conseillant Trump. Au contraire, mon livre tente d’expliquer, en se basant sur le travail de René Girard, comment dans un monde moderne de plus en plus homogène l’individualisme et le désir mimétique sont la clé pour analyser une société marchande universalisée. Je cite Alexandre Herzen, le grand écrivain russe, et son affirmation que la civilisation occidentale moderne est une civilisation d’une minorité privilégiée, qui prend part au « festin de la vie », alors que les masses en sont les « invités indésirables ». Et cette guerre civile globale ne fait que s’intensifier du fait de l’uniformisation grandissante provoquée par la mondialisation.[…]
Mon livre se base sur une thèse historique : les pathologies politiques qu’a connues l’Europe à la fin du XIXe siècle en réaction au libéralisme, à la démocratie et à une croissance économique irrégulière sont aujourd’hui devenues universelles. Depuis la fin de la guerre froide, nous avons connu trois décennies d’un libéralisme extrême – souvent qualifié de néo-libéralisme – qui a pourtant été discrédité par les désastres de la première moitié du XXe siècle. Que ce soit aujourd’hui l’implosion des États-nations en Asie ou en Afrique, le ralentissement des économies ou la hausse des inégalités en Europe, ces pathologies rappellent ce qu’on a pour la première fois observé à la fin du XIXe siècle : des démagogues promettant le renouveau d’une communauté nationale ou des terroristes anarchiques trouvant dans la violence non seulement une expérience esthétique et existentielle, mais aussi une rédemption politique. Aujourd’hui, ces pathologies se sont répandues partout dans le monde. Elles touchent autant des Indiens déracinés, ayant migré de zones rurales aux métropoles, que la classe moyenne américaine délaissée par un capitalisme globalisé et opaque qu’elle ne comprend plus. Dans les deux cas, ces gens se cherchent un ennemi facilement identifiable et qu’on a sous la main : immigrants, femmes, élites…
[…] Les gens, en théorie, devraient être plus libres, riches et mobiles que jamais…
Qui dit ça ? Les idéologues du néo-libéralisme, qui ne cessent de nous répéter, alors que les inégalités grandissent, qu’une marée montante profite à tout le monde, yachts de luxe comme frêles esquifs. Ce sont les fantasmes véhiculés par les élites technocratiques, et leurs porte-voix dans la presse et sur les plateaux de télévision. Mais aujourd’hui, nous expérimentons les conséquences toxiques de ces promesses fausses et extravagantes faites par les bénéficiaires de la mondialisation.
[…] Aujourd’hui, l’ère de la mondialisation promet une citoyenneté cosmopolite pour tous, mais n’en délivre dans les faits qu’à des élites. Beaucoup se sentent donc floués. Du coup, l’attrait du concept « peuple » est à nouveau fort. Les gens recherchent une estime de soi à travers un groupe défini par l’ethnicité, la religion, la race ou la culture. Et les politiques sont à nouveau obsédés par l’idée de recréer une unité idéologique ou culturelle du peuple, et exclure tous ceux qui ne devraient pas y appartenir. […].
Le journaliste du Point essaye de ramener un peu de rationalité et de montrer qu’il y a quand même des progrès, en rappelant qu’ «En 1981, 54 % de la population mondiale était dans l’extrême pauvreté. Aujourd’hui, c’est moins de 10 %, selon la Banque mondiale. Les gens vivent plus longtemps, les maladies infectieuses ont connu des chutes remarquables et, alors qu’en 1900 seuls 21 % de la population mondiale savaient lire, ils sont aujourd’hui 86 %. N’est-ce pas là des succès spectaculaires du progrès, du libéralisme et de la mondialisation tant vilipendés ?». Le point appelle à la rescousse Steven Pinker qui a montré que nous vivons l’époque la moins violente et la plus tolérante de l’histoire, grâce à l’essor de la raison, du commerce, du cosmopolitisme et de la féminisation…et que j’avais évoqué lors du mot du jour du 19 décembre 2016 : « dix raisons de se réjouir de l’avenir » »
Ces arguments n’entament pas le pessimisme de Pankaj Misrah :
« Des pays comme l’Inde et la Chine ne pouvaient que se refaire une santé après ce qu’ils ont connu avec l’impérialisme occidental et la guerre civile. Et qu’est-ce que la croissance chinoise, à travers un capitalisme d’État, a à voir avec le libéralisme occidental ? De toute façon, il y a quelque chose de fallacieux dans ces succès quantifiables et ce progrès irréversible que vous présentez. Est-ce qu’une longue vie signifie qu’elle est obligatoirement meilleure et plus gratifiante ? Les taux de mortalité ont baissé, et ceux de l’alphabétisation sont en hausse, mais quid du chômage, du déracinement, de la dépossession et de la dégradation environnementale ? Une personne qui quitte son village pour aller travailler dans une métropole sort de la pauvreté selon les statisticiens, mais quelles mesures avons-nous pour évaluer sa vie dans des villes où la pollution est importante et les loyers élevés, tandis que les conditions dans les bidonvilles sont extrêmement brutales ? Ne soyons pas aveuglés par les statistiques et les graphiques. Au XIXe siècle, alors qu’il y avait très peu d’économistes et de journalistes pour faire œuvre de propagandistes, les romanciers ont décrit ce qu’ont vraiment coûté l’industrialisation et l’urbanisation. Cela vaut toujours la peine de lire Dickens et Zola pour comprendre ce qu’actuellement beaucoup de personnes vivent en Inde et en Chine dans leur marche au progrès. […]
L’idéologie de l’élite, les bénéfices de la mondialisation sont les mieux défendus depuis les verts campus de l’Ivy League, comme Harvard où travaille Monsieur Pinker. Des gens comme lui vous enrobent ça de statistiques nombreuses et impressionnantes, mais si vous regardez de plus près, l’analyse est très mince. Les dernières décennies semblent plus pacifiques essentiellement parce que les Européens ont arrêté de s’entretuer à large échelle en 1945. Mais les génocides, les nettoyages ethniques ou les guerres qui détruisent des millions de vies comme en Irak ou au Vietnam ne sont guère éloignés dans le passé. Et la probabilité que cela se produise à nouveau n’a jamais été aussi grande après l’arrivée à la Maison-Blanche de racistes et de suprématistes blancs. Je ne sais pas comment on peut croire à la vision rose d’un progrès constant de l’humanité, défendue par Steven Pinker, alors même qu’un « troll » sur Twitter a accès à l’arme nucléaire…[…]
Le projet moderne de l’individualisme, tel qu’il a été défini au XVIIIe siècle, est le projet utopique le plus radical de l’histoire. »
Il n’y a qu’une lueur d’espoir dans son développement quand il évoque le pape François.
« […] nous ferons très certainement un pas en avant en reconnaissant que la foi dans le progrès n’est nullement différente de la foi dans un dieu. Les deux nécessitent une soumission plutôt qu’un questionnement intellectuel. Par ailleurs, d’aucune façon je ne fais référence à une religion quand je salue le pape François. Je souligne simplement sa compassion pour les faibles et le fait de ne pas voir la vie comme une compétition sans fin pour un statut social ou la richesse, mais plutôt de s’ouvrir à la confiance et la solidarité. De telles aspirations sont l’objet de la dérision des élites technocratiques, alors même qu’une majorité frustrée et en colère succombe à la haine vomie par les démagogues… »
Nous avons compris que la mondialisation est la fin de la rente de l’occident. Les inégalités entre pays ont globalement diminué mais les inégalités à l’intérieur des pays occidentaux ont augmenté. D’où ce concept de guerre civile totale à l’intérieur des pays, mais dans tous les pays.
Je pense cependant que cet auteur est un peu trop pessimiste.

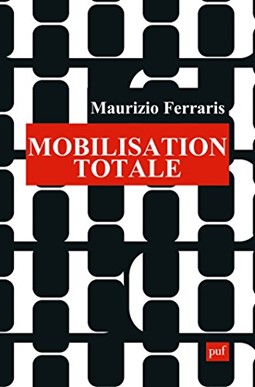


 Les soldes d’hiver 2016 ont été lancées le 6 janvier dernier.
Les soldes d’hiver 2016 ont été lancées le 6 janvier dernier.