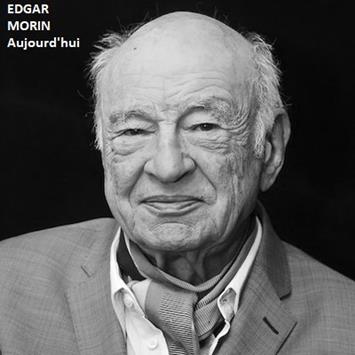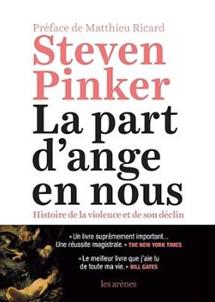«Mai-68 : La brèche n’est pas refermée»
Edgar Morin.
Il y a les mentors de Mai 68, hier nous évoquions Jean-Paul Sartre. <Le Nouvel Obs> cite Herbert Marcuse (1898 -1979), sociologue marxiste, américain d’origine allemande qui dénonçait tant le bloc occidental que l’URSS. Je garde de lui cette phrase qui m’avait marqué quand j’étais jeune, « ce qui est pornographique ce n’est pas une femme qui montre son pubis mais le fait de mettre dans les vitrines des biens que des gens qui passent ne peuvent pas acheter. En 1964, il écrit « L’Homme unidimensionnel » (One Dimensional Man) qui paraît en France en 1968 et devient un peu l’incarnation théorique de la nouvelle révolte étudiante. En 1968, il voyage en Europe, et tient de multiples conférences et discussions avec les étudiants. (source Wikipedia).
Il y a aussi Louis Althusser. En 1968, Louis Althusser (1918-1990) est le gourou de la rue d’Ulm, et une figure majeure de la pensée marxiste mais flirtant avec la dépression avant de sombrer dans la folie.
L’article du nouvel obs cite aussi le philosophe et sociologue Henri Lefebvre (1901-1991) qui contrairement aux deux précédents m’était complétement inconnu. L’hebdomadaire ajoute : « Métro, boulot, dodo. – Le mot n’est pas de lui, mais ce slogan repris par les étudiants de 68 pourrait suffire à résumer le travail critique engagé Henri Lefebvre, inspirateur aujourd’hui un peu oublié de la révolte de Mai.
Mais selon cet article, ou plutôt ma compréhension de l’article, il semblerait que le plus grand inspirateur de Mai 68 soit Guy Debord, (1931-1994). Auteur en 1967 de «la Société du spectacle » que le nouvel obs décrit ainsi :
« Dans une nuée de formules ciselées, parfois poétiques, souvent obscures, il y critique tant la bureaucratie soviétique que le capitalisme occidental, englués selon lui dans la même illusion : le « spectacle ». Celui-ci ne saurait se résumer à l’extension tentaculaire de la publicité ou des médias de masse ; Debord le définit comme « le règne autocratique de l’économie marchande ayant accédé à un statut de souveraineté irresponsable, et l’ensemble des nouvelles techniques de gouvernement qui accompagnent ce règne ».
Il fonde « l’Internationale situationniste » :
« qui se donne pour but ultime de mettre fin à la séparation entre l’art et la vie. Pour s’en dégager, il propose dès 1957 de « construire des situations », c’est-à-dire « un ensemble d’impressions déterminant la qualité d’un moment ». Il s’agit d' »entraîner le spectateur à l’activité », aux prémices d’une révolution qui bousculera les vies rabougries, passives et aliénées auxquelles condamne la réalité « spectaculaire » – le modèle politique des « situs » se rapproche du conseillisme, de l’autogestion. »
<Une conférence à la Bibliothèque nationale de France approfondissant ce concept de société du spectacle>
 Et puis il y avait Edgar Morin « Témoin enthousiaste de Mai 1968 ». En 1968 Edgar Morin avait 46 ans et ressemblait à cette photo..
Et puis il y avait Edgar Morin « Témoin enthousiaste de Mai 1968 ». En 1968 Edgar Morin avait 46 ans et ressemblait à cette photo..
il analysait et décryptait à chaud dans des articles du Monde les évènements. A partir de ces articles il a écrit avec Claude Lefort et Cornelius Castoriadis « Mai 68, La Brèche » chez Fayard.
Ouvrage enrichi en 1988 par une nouvelle édition suivie de «Vingt ans après », éd. Complexe. 50 ans après l’Obs a réinterrogé Edgar Morin qui a désormais 96 ans. Le titre de l’article est « La brèche n’est pas refermée »
C’est cet article, publié le 23 mars 2018, que je partage aujourd’hui avec vous.
Lorsque les évènement de mai se sont déclenchés, il n’était pas totalement décontenancé car il avait détecté l’émergence d’une nouvelle classe d’âge adolescente :
« J’avais en tout cas diagnostiqué dès la fin des années 1950 qu’une nouvelle classe, la classe d’âge adolescente, s’était constituée après-guerre. Venue s’intercaler entre le cocon de l’enfance et le moment de l’insertion dans l’âge adulte, elle a acquis ses rites, son vocabulaire, son habillement, ses lieux de rassemblement, sa musique, et a développé des aspirations propres : alors que la civilisation des Trente Glorieuses prétendait apporter le bien-être par le confort matériel, les adolescents ressentaient la vacuité de cette promesse. Ils étaient à la recherche d’une forme d’authenticité personnelle, rêvaient de fraternité, de vie communautaire et en même temps d’autonomie individuelle.
Et ce décalage, ce malaise, qui ont pris corps sur grand écran avec les personnages incarnés par James Dean et Marlon Brando au milieu des années 1950, ont engendré des formes de rébellion. Il ne faut pas oublier que, le 22 juin 1963, lors du grand concert organisé place de la Nation par le magazine « Salut les copains », qui avait drainé une foule immense d’adolescents venus communier avec leurs idoles dont Johnny Hallyday, l’exaltation de la fête a suscité des débordements, grilles d’arbre arrachées, voitures renversées. »
Le phénomène « yéyé », ainsi que je l’ai baptisé dans un article que j’ai écrit pour « le Monde » après ce rassemblement alors inédit de 200.000 jeunes, révélait une soudaine violence. Derrière les vedettes plus ou moins canalisées dans le show-business que promouvait Daniel Filipacchi, le créateur de « Salut les copains », les banlieues ont vu proliférer les groupes de rock des « blousons noirs » en révolte. ».
Lorsque le journaliste s’insurge en disant cette évidence : « Mais ce ne sont pas les blousons noirs qui ont fait Mai-68… ». Edgar Morin réplique :
« Evidemment non. A partir de 1965, la classe adolescente s’est constitué une intelligentsia chez les étudiants, et d’abord à l’université de Berkeley, en Californie, où de jeunes contestataires ont théorisé et exprimé clairement leurs aspirations à une autre vie, en rupture avec celle, « unidimensionnelle » – pour citer leur mentor, Marcuse –, des adultes.
Or, début 68, par une sorte de contagion due à la mondialisation de l’information, des révoltes étudiantes ont éclaté dans des pays aux systèmes politiques et sociaux aussi différents que les Etats-Unis, le Mexique, l’Egypte ou la Pologne. Le point commun entre tous ces mouvements, c’était le rejet de l’autorité du monde adulte, qu’elle soit professorale, familiale, gouvernementale, institutionnelle, dictatoriale. Et j’ai compris que la France serait la prochaine sur la liste lorsque, en mars 1968, le philosophe et sociologue Henri Lefebvre, qui était alors professeur à Nanterre, m’a demandé d’assurer quelques cours à sa place.
En arrivant sur le campus, je n’avais aucune idée de l’agitation qui y régnait depuis quelques semaines ; quand j’ai voulu commencer mon cours, des étudiants présents dans l’amphi se sont mis à crier « Grève ! ». J’ai proposé de voter pour ou contre la tenue du cours, et le « pour » l’a emporté. Deux mécontents ont alors scandé : « Morin, flic ! » J’avais donc identifié des signes avant-coureurs. Pour autant, je n’avais nullement imaginé la tournure qu’allaient prendre les événements en France. »
Il parle aussi qu’au milieu de toutes les révoltes étudiantes dans le monde en 68, il y a une exception française car c’est la seule qui ait débordé l’université pour investir tous les champs de la société et provoquer une crise politique majeure.
« Mai-68 est un événement complexe, mélange de nécessité – le contexte universitaire international – et de hasard. Dans ce pays à l’économie florissante qu’est la France des années 1960, où l’ordre gaulliste semble avoir étouffé le débat politique, se produit un phénomène assez imprévisible de contagion en chaîne, de Nanterre au Quartier latin, puis du Quartier latin aux universités de province, des étudiants aux artistes et intellectuels, enfin de ces milieux privilégiés aux masses populaires.
Plusieurs facteurs ont joué. En France, les étudiants étaient moins isolés dans la société que ne l’étaient leurs homologues étrangers. L’influence des intellectuels était chez nous bien plus forte. Surtout, un événement décisif se produit début mai à la Sorbonne, lorsque cette révolte née dans un esprit principalement libertaire, l’esprit du Mouvement du 22 Mars de Nanterre animé par le génial petit stratège qu’était Dany Cohn-Bendit, est ralliée par des groupuscules trotskistes et maoïstes.
Les militants politisés disent alors aux étudiants : « Vos aspirations, votre quête de liberté, de fraternité, nous allons les réaliser par notre révolution. » Dès lors, les étudiants révoltés font des appels pressants à la classe supposée révolutionnaire qu’est la classe ouvrière. Et, malgré les réticences des dirigeants syndicalistes et communistes, le mouvement parvient à sortir de l’université pour s’agréger les revendications sociales et politiques de millions de Français, qui vont faire grève dans les usines puis dans les bureaux.
Dans cet effet boule de neige, l’imaginaire joue un rôle essentiel. En passant des manifestations, des slogans et des affiches aux barricades, on passe du jeu, de la kermesse, à l’affrontement violent. Alors se réveille une mémoire historique, celle des insurrections du passé, y compris le soulèvement relativement récent de Paris en août 1944. On réactive la tradition insurrectionnelle de la France, qui a toujours mêlé les âges et les conditions sociales. »
Et puis il répond directement à la « révolution introuvable » de Raymond Aron :
« Après la fin des événements, l’idée que Mai-68 aurait été une insurrection ratée a été propagée aussi bien par la droite, qui se vantait de l’avoir empêchée, que par l’extrême gauche, qui a voulu y voir une répétition générale de la révolution à venir. Or penser Mai-68 comme un épisode révolutionnaire classique, c’est passer à côté de sa vérité.
Avec mes amis Cornelius Castoriadis et Claude Lefort, dans un livre que nous avons publié quelques semaines après les événements (1), nous avons au contraire avancé l’idée que Mai-68 avait été une brèche sous la ligne de flottaison de l’ordre social, par laquelle se sont engouffrées des valeurs, des aspirations, des idées nouvelles, appelées à transformer en profondeur notre civilisation. Avec Mai, rien ne change et tout change. L’ordre politique, social, économique est rétabli dès le mois de juin, mais un processus s’est enclenché qui va bouleverser l’esprit du temps et les sensibilités.
La première traînée de Mai-68, la plus visible, c’est la montée en puissance de ce qu’on a appelé le gauchisme, qui a tenu une place essentielle au sein de la jeunesse intellectuelle de la première moitié des années 1970. Ces militants trotskistes d’une part, maoïstes de l’autre, étaient alternativement excités et modérés par une partie de l’intelligentsia française, derrière Jean-Paul Sartre et Maurice Clavel.
A la différence de l’Allemagne et de l’Italie, il n’y a pas eu en France de minorité qui se soit lancée dans le terrorisme, mais des jeunes maoïstes sont par exemple allés en usine découvrir la condition ouvrière et propager la bonne parole. Reste qu’en 1977 le marxisme-léninisme connaît chez nous un collapsus brutal, lorsque l’épisode grotesque de la Bande des Quatre ternit le mythe maoïste, que le régime idéalisé de Hô Chi Minh au Vietnam révèle son visage dictatorial, que le message des dissidents soviétiques commence enfin à se faire entendre.
Dès lors, on a pu mieux mesurer l’importance de dynamiques sociales plus profondes, et durables, qui se sont enclenchées autour de 68 : l’émancipation des femmes, l’émergence d’une culture de la différence – celle des homosexuels ou, sur un tout autre plan, celle des néo-régionalistes –, le goût de l’expérience, individuelle ou communautaire, l’émergence aussi d’une conscience écologique, la mise en question du progrès scientifique.
Toutes ces dynamiques, filles de Mai, ont eu tendance à transformer l’euphorie de la civilisation du bien-être en problématisation. La presse féminine, qui vendait du bonheur, s’est mise à poser le problème du vieillissement, de l’abandon. Au cinéma, la fin des films n’a plus été systématiquement heureuse. L’air du temps a changé : on a vu une poussée conjointe du désir et de l’inquiétude, le doute critique a succédé à la croyance majoritaire dans le progrès technique et social des années 1950 et 1960, les malaises croissants ont cherché ou trouvé leurs remèdes dans l’antipsychiatrie, le yogisme, le bouddhisme zen…
Cette évolution des mentalités, conjuguée aux effets du choc pétrolier de 1973, a fini par détruire la tranquille assurance des officiels de la pensée et de la politique, qui croyaient qu’après 1945 la meilleure des sociétés possibles s’était enfin installée, et qu’elle ne pouvait que progresser dans ses bienfaits. »
Edgar Morin parle aussi de ce que Mai 68 lui a apporté personnellement :
« Est-ce que vous aussi, en tant que penseur et en tant qu’homme, avez été changé par Mai-68?
Ces événements m’ont marqué, indéniablement. Sur le moment, en observant les manifestations, j’ai été témoin d’un instant unique. D’un seul coup, dans les rues, les gens qui ne se connaissaient pas se sont mis à se parler. C’était une extase de l’histoire, comme j’en ai vécu deux autres, en juin 36 puis, surtout, à la Libération de Paris.
Même s’ils n’ont duré qu’un instant, même s’ils n’ont pas été suivis de tous les effets attendus, ces moments ont existé. Et le souvenir de l’extase, de la communion, reste bien vivant en moi. D’autant que j’ai eu la chance de regoûter à cette atmosphère l’année suivante en Californie, quand j’ai été invité à travailler plusieurs mois au Salk Institute for Biological Studies de San Diego. La Californie vivait alors les derniers mois d’une floraison magnifique, un Mai-68 qui a duré quatre ans, de 1967 à 1970. La fête ne s’arrêtait jamais. La vie et les idées se mêlaient. J’ai fréquenté des intellectuels dont j’ai appris beaucoup de choses, tout en passant avec eux des soirées à danser et à fumer de la marijuana.
J’ai écrit, alors : « A 48 ans, j’apprends à vivre », ce qui m’a évidemment valu des moqueries. Mais de fait, c’est à ce moment-là que je me suis autorisé à prendre la parole dans mes écrits, à exprimer des opinions et des interrogations personnelles – j’ai alors osé publier « le Vif du sujet », une longue méditation rédigée des années plus tôt, puis un Journal de Californie où je mêlais de même idées et expériences personnelles. Et cette ambiance, ces échanges incessants, ont aussi profondément influencé ma réflexion : c’est en Californie que je me suis définitivement convaincu de la nécessité de décloisonner les disciplines, de relier les savoirs pour penser la complexité. »
Et aujourd’hui à 96 ans Edgar Morin arrive à la conclusion que j’ai mis en exergue de ce mot du jour : « Cette brèche ne s’est pas refermée » :
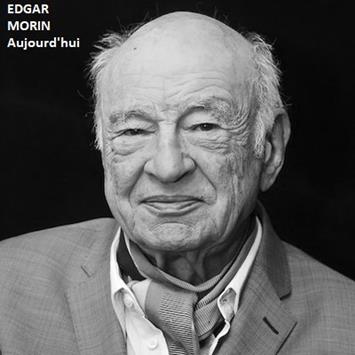 [La brèche est] toujours plus béante. Le problème civilisationnel mis en évidence par Mai-68 s’est aggravé, s’est durci : le rejet d’une civilisation qui prétend apporter aux hommes le bien-être, mais ne parvient pas à combler leurs aspirations profondes, est au cœur de nos difficultés contemporaines, collectives et individuelles. Consacré par la chute du communisme puis la mondialisation, le dogme néolibéral apparu dans les années 1970 a beau se présenter comme une réalité incontournable, sans alternative, c’est en fait la nouvelle idéologie, qui masque sous le calcul les vraies réalités humaines, qui impose à nos vies ses contraintes économiques et chronométriques.
[La brèche est] toujours plus béante. Le problème civilisationnel mis en évidence par Mai-68 s’est aggravé, s’est durci : le rejet d’une civilisation qui prétend apporter aux hommes le bien-être, mais ne parvient pas à combler leurs aspirations profondes, est au cœur de nos difficultés contemporaines, collectives et individuelles. Consacré par la chute du communisme puis la mondialisation, le dogme néolibéral apparu dans les années 1970 a beau se présenter comme une réalité incontournable, sans alternative, c’est en fait la nouvelle idéologie, qui masque sous le calcul les vraies réalités humaines, qui impose à nos vies ses contraintes économiques et chronométriques.
Nous avons besoin d’autre chose. Nous résistons chacun à notre façon : dans nos amitiés, nos amours parfois clandestines, nos jeux, nos « bonnes bouffes », nos danses, nous essayons d’arracher des bouts de poésie, cette poésie qui s’affichait sur les murs en Mai-68. N’oublions pas le sens de ces graffitis, « Sous les pavés, la plage », « Jouir sans entraves » : ils expriment l’aspiration à vivre poétiquement, c’est-à-dire dans la ferveur, l’intensité, la communion, loin de la vie sociale de plus en plus prosaïsée du monde adulte.
[…]
Au cours du dernier demi-siècle, les conquêtes des individualismes ont en effet contribué à dégrader les solidarités de nos sociétés. Au fur et à mesure que s’accroissait leur autonomie, les individus se sont retrouvés toujours plus compartimentés, isolés. C’est le grand défi actuel pour notre civilisation : tout en préservant l’autonomie individuelle, elle doit trouver un moyen d’insuffler un renouveau communautaire. Cela ne passera ni par une révolution marxiste-léniniste ni même sans doute par une explosion généralisée comme celle de 68.
Mais ce besoin révolutionnant renaîtra nécessairement suivant d’autres modalités. Il me semble d’ailleurs voir poindre, depuis quelques années, un phénomène qui répond en partie à ce besoin : l’essor des mouvements associatifs prônant des formes nouvelles de solidarité est une façon de retrouver les aspirations exprimées par Mai-68.
Je pense aux ZAD, à Nuit debout, aux associations anticorruption, à celles qui réclament la taxation des transactions financières, mais aussi aux écoquartiers, à l’agroécologie, à l’économie sociale et solidaire… Les milliers d’initiatives pour le mieux-vivre qui se multiplient en France et dans le monde, ce nouveau bouillonnement que ne voient ni les administrations ni les partis, c’est le regain de 68 sous de nouvelles formes et dans de nouvelles conditions. »
J’ai cité la quasi l’intégralité de cet article, car je n’ai rien trouvé de plus intelligent, pour l’instant, sur ce que signifiait Mai 1968 et sur ce qui reste aujourd’hui de cette aspiration à d’autres projets et d’autres valeurs.
Et en 1968, le 23 mai était un jeudi et plus précisément le Jeudi de l’Ascension. Philippe Sollers, devant les écrivains occupant la Société des gens de lettres, proclame: «Toute révolution ne peut être que marxiste-léniniste.»
La CGT approuve la décision d’interdiction de séjour prise à l’encontre de Cohn-Bendit. Les étudiants allemands prévoient de se réunir à Sarrebruck avec l’intéressé, et les Français à Strasbourg pour organiser le retour en force de Cohn-Bendit par le pont de l’Europe entre Kehl et Strasbourg.
A 21h30, des barricades se lèvent sur le boulevard Saint-Michel, grilles d’arbres, bancs arrachés, panneaux de signalisation, palissades, détritus, cette fois, il ne s’agit pas de tenir les barrages mais d’y mettre le feu pour retarder l’avancée des policiers. Des flammes montent de la chaussée jusqu’aux premiers étages, le dernier appel au calme d’Alain Geismar se perd en fumée. On abat des arbres, les forces de l’ordre mettront trois heures pour reprendre le boulevard.
<1074>
 Et il a été invité à l’émission la Grande Table du 3 décembre 2018 : « « Gilets jaunes » : quelles réponses à quelles questions ? »
Et il a été invité à l’émission la Grande Table du 3 décembre 2018 : « « Gilets jaunes » : quelles réponses à quelles questions ? »