L’invité des matins de France Culture du 4 décembre 2018 pour essayer expliquer la situation actuelle de la France était Jean Garrigues, professeur d’histoire contemporaine. Et son propos le plus marquant fut celui-ci :
« C’est une crise de la représentation démocratique dans tous les pays occidentaux »
Dans <L’Esprit Public d’Emily Aubry de ce dimanche>, un des invités, François Xavier Bellamy a eu le même constat :
« Une crise très profonde de la représentation politique »
<L’émission Du grain à moudre du 4 décembre> avait invité Dominique Rousseau, professeur de droit constitutionnel à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, ancien membre du Conseil Supérieur de la Magistrature de 2002 à 2006 et auteur du livre « Radicaliser la démocratie : proposition pour une refondation » paru aux Editions du Seuil en 2015
Et Dominique Rousseau a encore souligné cette crise-là : la crise de la représentation démocratique. Et pour illustrer son propos il a même fait appel au grand révolutionnaire Sieyès :
« La crise que l’on connaît c’est l’épuisement d’une forme représentative de la démocratie. Toutes les formes représentatives de la démocratie. Sieyès disait « Le peuple ne peut vouloir, ne peut agir et ne peut parler que par ses représentants ». On vivait là-dessus depuis 1789. Ce n’est plus le cas. Le Peuple dit, nous voulons parler par nous-même, en dehors de la parole des représentants. »
Quand on cite un glorieux ancien, je m’efforce toujours d’aller vérifier. Sieyès a tenu ces propos lors d’un Discours tenu le 7 septembre 1789 devant l’Assemblée Nationale constituante. La question abordée était celle du véto du Roi. La citation de Dominique Rousseau est extraite du paragraphe suivant :
« Les citoyens qui se nomment des représentants renoncent et doivent renoncer à faire eux-mêmes la loi ; ils n’ont pas de volonté particulière à imposer. S’ils dictaient des volontés, la France ne serait plus cet État représentatif ; ce serait un État démocratique. Le peuple, je le répète, dans un pays qui n’est pas une démocratie (et la France ne saurait l’être), le peuple ne peut parler, ne peut agir que par ses représentants. »
Toujours se méfier des citations. Bien sûr cette phrase est prononcée au tout début de la révolution. Le pouvoir est encore partagé entre l’Assemblée et le Roi. Le Roi qui était entré sans sa royauté par la croyance d’un Roi de droit divin !
Toujours est-il que dans ce paragraphe Sieyès oppose clairement le principe représentatif et la démocratie. Il ajoute aussi cette phrase énigmatique : « La France ne saurait être une démocratie. » Pourquoi ? Peut-être parce qu’elle est trop vaste pour pratiquer la démocratie directe qui semble donc, si l’on comprend bien l’idée de Sieyès, la seule vraie forme de la démocratie.
Mais Sieyès est surtout connu pour une autre phrase beaucoup plus célèbre
« Qu’est-ce que le Tiers-État ? Tout.
Qu’a-t-il été jusqu’à présent dans l’ordre politique ? Rien.
Que demande-t-il ? À y devenir quelque chose. »
Cette phrase se situe dans l’introduction de « Qu’est-ce que le Tiers-État ? », un pamphlet publié par l’abbé Sieyès en janvier 1789 en prélude à la convocation des États généraux. Sieyes y présente et critique la situation du moment, et indique les réformes souhaitables, notamment que le vote de chaque ordre se fasse proportionnellement à sa représentativité réelle dans la nation (évidemment favorable au Tiers-État, qui représente près de 98 % des Français). Il donne les prémices de l’avènement d’une assemblée nationale constituante.
Cela me semble assez proche de l’esprit exprimé par celles et ceux que nous appelons « les gilets jaunes » qui ne sont certainement pas 98% des français mais sont une part très importante de la population et une part qui est devenu assez invisible dans les institutions et les médias selon l’expression de Pierre Rosanvallon.
D’ailleurs Dominique Rousseau cite aussi Rosanvallon et cette explication de la révolte :
« Les « gilets jaunes » sont les forces vives de la nation, pour reprendre les mots de De Gaulle. C’est eux qui font vivre le pays. Et ils sont, comme disait Rosanvallon, invisible. Ou du moins ils l’étaient jusqu’à présent parce qu’on parlait en leurs noms. Les « gilets jaunes » sont tout dans le pays car c’est eux qui font le boulot. Ils ne sont rien dans les institutions. »
Pierre Rosanvallon qui avait écrit en 1998 un livre « Le peuple introuvable : histoire de la représentation démocratique en France» dans lequel il a souligné que si la démocratie a proclamé la souveraineté du peuple, mais que ce qui est advenu c’est une société d’individus. Et ainsi s’il peut être envisageable de représenter un peuple, il est compliqué de vouloir représenter une collection d’individus.
Une collection d’individus…
Lorsque Emmanuel Macron a été élu, nous étions dans cette crise de la représentation. Les partis politiques de gouvernement étaient rejetés. A ce rejet s’est ajouté un concours de circonstance qui a permis à ce jeune homme brillant et intégré dans la mondialisation d’être élu.
Il n’aura donc pas fallu longtemps pour que le mouvement que le jeune homme a créé et qui devait incarner la nouveauté, le nouveau monde, se trouve, à son tour, dans la tourmente et le rejet.
Mais la représentation est aussi normalement incarné par les corps intermédiaires que sont les syndicats et les médias qui eux aussi font l’objet de la plus grande méfiance du grand nombre.
En outre, cette crise des syndicats qui étaient déjà fragiles en raison du nombre très restreint d’adhérents a encore été accentuée par le jeune Président qui n’a pas souhaité les intégrer dans le processus de décision, persuadé qu’il connaissait le chemin à suivre par sa seule intelligence et son savoir.
Le mouvement actuel ne tient aussi aucun compte de ces corps intermédiaires.
La crise de la représentation est révélée par les faiblesses même du mouvement des gilets jaunes incapable de désigner des représentants ou après les avoir désignés, les récuse. Certains porte-paroles ont même expliqué qu’ils étaient menacés physiquement s’ils acceptaient de se rendre à des réunions de négociation avec les autorités politiques.
Une collection d’individus…
Mais, je crois surtout qu’il ne faut pas se polariser sur la France et la personnalité de Macron qui joue certes un rôle dans ces évènements mais qui n’est pas central.
Car comme le dit Jean Garrigues : « C’est une crise de la représentation démocratique dans toutes les démocraties occidentales ».
Toutes…
Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés
Comment a été élu Donald Trump ?
Il s’est emparé du Parti Républicain à la hussarde contre la volonté de tous les dirigeants du Parti. D’ailleurs, lors des primaires il en vaincu plus de 10 qui étaient des représentants éminents, anciens et expérimentés du Parti. Puis il a vaincu la représentante du Parti Démocrate.
Plus récemment, un autre énergumène a profité de la crise de la représentation et du discrédit des Partis Politiques et notamment du Parti des travailleurs de Lula pour s’emparer du pouvoir. Il s’agit de Jair Bolsonaro.
Et l’Italie ? Les élites économiques et politiques avaient cru trouver leur champion en Matteo Renzi. Aujourd’hui c’est un leader d’extrême droite qui est au pouvoir, du moins qui monopolise la parole du pouvoir : Matteo Salvini.
C’est très inquiétant parce que l’Italie est un laboratoire qui fait office de précurseur et réalise les choses avant les autres.
Ils ont été les premiers à se débarrasser des grands Partis : la Démocratie chrétienne, le Parti communiste italien, le Parti socialiste. Puis c’est un milliardaire, spécialiste des médias bien avant Trump qui s’est emparé du pouvoir exécutif. Puis le « cercle de la raison » a vu émerger et soutenu Matteo Renzi, comme elle l’a fait pour Macron. Et c’est l’extrême droite qui est venu et on ne voit pas bien ce qui va venir après.
Dans le monde, les partis qui continuent à pouvoir prétendre à un soutien relativement solide des électeurs qui votent (je suis prudent et ne parle pas de peuple) sont des partis qui se sont donnés à un homme fort et autoritaire : Erdogan en Turquie, Orban en Hongrie, Poutine en Russie.
Des leaders qui font la part belle au nationalisme et à la xénophobie ou au moins insiste sur le danger extérieur pour renforcer leur pouvoir à l’intérieur.
La Grande Bretagne, le pays qui a inventé la démocratie moderne est aussi dans la tourmente.
L’Allemagne qui n’a pas inventé la démocratie, malgré ses grands philosophes, est aussi en difficulté du point de vue des partis de la représentation politique.
Alors il en est certain qui rêve à une démocratie directe plus active, notamment grâce aux outils numériques et modernes.
Peut-on vraiment croire à cette évolution ?
Certainement pas si on continue à rester des collections d’individus, des collections de consommateurs.
Seuls des citoyens, attachés à la chose publique peuvent faire fonctionner des institutions et une démocratie.
Mais la démocratie porte en elle l’aspiration à l’égalité des citoyens. Égalité politique qui peut accepter une certaine dose d’inégalité économique mais pas l’inégalité qui aujourd’hui se développe et fait diverger toujours davantage le destin des hommes, dans nos civilisations occidentales. Or le jeune Président avait pour ambition de faire entrer davantage la France dans la mondialisation et donc d’augmenter encore les inégalités entre français alors que jusqu’à présent notre système social malade et fragile continuait à nous préserver des dérives anglo-saxonnes.
Alors bien sûr quand on veut taxer le carburant de gens qui n’ont pas de marges de manœuvres financières… Pour qui le carburant est nécessaire pour aller travailler et bien plus que cela nécessaire pour avoir encore des espaces de liberté
Aurélie Filipetti dans l’émission l’Esprit Public citée en début d’article a eu cette belle phrase : « Tous leurs désirs nécessitent du carburant », pour retrouver un ami, emmener les enfants au sport, pour aller consommer etc..
Alors c’est compliqué, indécent serait plus juste, de leur demander de porter la charge de la transition écologique quand ces gens entendent que l’ex PDG de Nissan, Carlos Ghosn, faisait le tour du monde en avion plusieurs fois par semaine. On parle de l’avion personnel de cet homme. A-t-il payé cet avion ? Et même le kérosène, le carburant non taxé des avions, cet homme riche le payait-il de ses deniers propres ?
Bien sûr que non.
Vous savez bien que personne n’a jamais serré la main d’une personne morale, je veux dire d’une entreprise, mais à la fin c’est toujours elle qui paie la note. Pour des gens comme Carlos Ghosn.
Je suis persuadé que le principal problème de la crise de la représentation démocratique provient de la trahison et de la sécession de la plus grande partie des élites qui ne sentent plus de destin commun avec les gens simples. Ils veulent vivre dans un monde aseptisé de luxe où ils ne rencontrent les gens modestes que lorsqu’ils sont à leur service.
<1162>

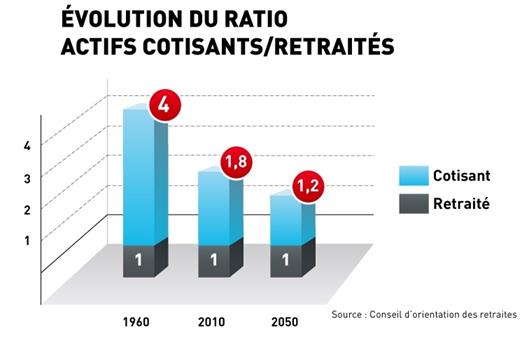

 AU XXème siècle on a construit des cathédrales non matérielles mais sociales pour L’Humanité, comme la Sécurité Sociale, pour « en finir avec la souffrance et les angoisses du lendemain » selon les mots d’
AU XXème siècle on a construit des cathédrales non matérielles mais sociales pour L’Humanité, comme la Sécurité Sociale, pour « en finir avec la souffrance et les angoisses du lendemain » selon les mots d’