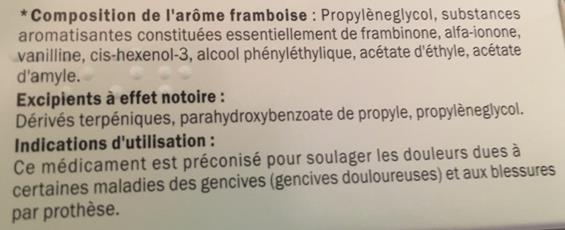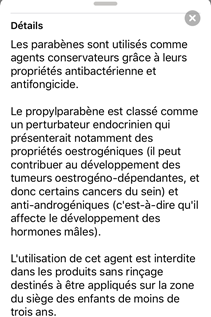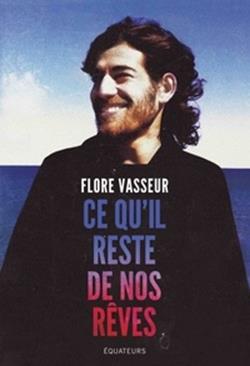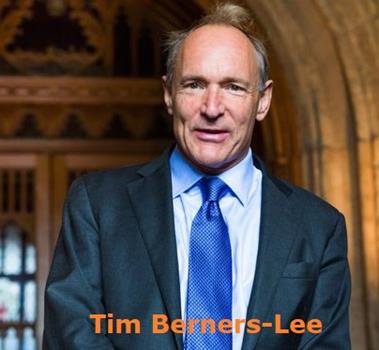« Une immersion dans l’art et la musique »
Exposition consacrée à Gustav Klimt et d’autres viennois à l’atelier des lumières
Ce week-end nous étions à Paris pour assister à la Philharmonie de Paris à une interprétation d’anthologie de la 3ème Symphonie de Mahler par le Boston Symphony Orchestra sous la direction de son chef Andris Nelsons.
Et dimanche matin, nous en avons profité pour aller à l’exposition Klimt, plus précisément l’exposition immersive et interactive sur l’œuvre de Gustav Klimt.
Je pourrai bien sûr analyser et décrire le fabuleux concert auquel nous avons assisté Annie, Florence et moi. Mais ce concert est terminé, il s’agit d’un moment passé et auquel vous n’aurez jamais accès, puisque la machine à remonter le temps n’a pas encore été inventé.
 En revanche, l’exposition à laquelle nous sommes allés est toujours ouverte. Et même, en raison de son succès, a été prolongé de fin novembre jusqu’au 6 janvier 2019.
En revanche, l’exposition à laquelle nous sommes allés est toujours ouverte. Et même, en raison de son succès, a été prolongé de fin novembre jusqu’au 6 janvier 2019.
Cette exposition, c’est d’abord un lieu : « L’atelier des lumières » qui se situe dans le 11ème arrondissement de Paris, 38 rue Saint Maur.
Il s’agit d’une ancienne fonderie de 3300 m² qui a été reconverti en espace culture numérique située dans le XIe arrondissement de Paris
Son nom était « La fonderie du Chemin-Vert » car située près de la rue du Chemin Vert. Elle avait été fondée en 1835 pour répondre aux besoins de la marine et du chemin de fer pour des pièces en fonte de grande qualité. L’usine occupait alors un terrain de 3 126 m2 et employait 60 personnes. L’usine produisait des moulages de toutes pièces en fonte de fer sur plans et sur modèles jusqu’à 10 000 kg.
L’affaire fait faillite et en 1935, la société est dissoute, 100 ans après sa création. Le terrain et les immeubles sont vendus aux actuels propriétaires et abritera une entreprise spécialisée dans la fabrication et la vente de machines-outils.
Ce lieu a été investi par le même groupe de créateur et d’artistes, « Culturespace » qui avait déjà créé « Les carrières de lumières aux Baux de Provence. »
J’avais aussi eu la chance avec Annie, grâce à Marcel et Josiane, de visiter ce lieu naturel d’une beauté majestueuse situé aux Baux de Provence. Dans ce cas aussi, c’était au lendemain de la Première Guerre Mondiale, que le déclin de la pierre de construction s’était amorcé et que de nouveaux matériaux de construction faisant leur apparition, l’acier, le béton. les carrières de pierre allaient perdre leur destin industriel.
C’est dans les années 1960 que Jean Cocteau, envouté par la beauté des lieux décide d’y tourner « Le Testament d’Orphée ».
Et c’est, dans ce lieu des carrières de Baux de Provence, qu’en 2012 un groupe d’artistes : Gianfranco Iannuzzi, Renato Gatto et Massimiliano Siccardi, sous le nom de Culturespaces vont créer un concept novateur AMIEX® (Art & Music Immersive Experience).
Des esprits retors et blasés diront qu’il s’agit d’un banal son et lumière se basant sur des œuvres picturales accompagnées de musique.
Oui c’est cela, mais c’est aussi très beau et permet d’entrer dans l’art avec des moyens modernes et numériques.
Tout cela est expliqué sur <Le site de l’Atelier des Lumières>.
Voici une vue de cet espace vierge de toute projection.

Et voici ce que cela donne avec les projections des tableaux de Klimt. Vous n’avez évidemment pas le son.
Mais vous pourrez en avoir un aperçu sur cette <Page consacrée à l’exposition Klimt>

Culturespaces a voulu pour l’ouverture de l’Atelier des Lumières présenter un parcours immersif autour des représentants majeurs de la scène artistique viennoise avec au centre Gustav Klimt, mais aussi Egon Schiele et Friedensreich Hundertwasser. Leurs œuvres s’animent en musique sur l’immense espace de projection de l’ancienne fonderie.

Annie et moi avons aimé et nous ne sommes pas les seuls :
Culture Box présente : <L’Atelier des Lumières, nouveau lieu d’exposition à Paris, ouvre avec Klimt> :
« A l’aide de 140 vidéoprojecteurs et au son des valses et autres musiques de la Vienne de la fin XIXe siècle, les œuvres du peintre autrichien s’animent et habillent les 3.300 m² de surface de projection de ce nouveau lieu baptisé Atelier des Lumières, situé dans le XIe arrondissement. C’est « la plus grande installation numérique de ce type dans le monde », assure Bruno Monnier, le président de Culturespaces, la société privée en charge du lieu qui ouvre au public ce vendredi avec cette première exposition.
Pendant les 35 minutes de projection, le sol et les murs de cette ancienne fonderie se couvrent des œuvres, permettant aux visiteurs de voyager dans la Sécession viennoise, ce courant artistique autrichien dont Gustav Klimt est la figure de proue.
[…]. La bande-son venue tout droit de l’époque de Klimt contribue à l’immersion : Strauss, Chopin, Mahler… »
Le Parisien déclare : <A l’Atelier des Lumières : plein les yeux avec Klimt> :
« C’est à voir. Ça en jette, mais on ne trouve pas les mots. Certains parlent du « premier musée numérique ». Faux, un musée conserve des « vraies » œuvres en permanence. Ou à la limite, il en existe un au Japon, qui propose des reproductions de peintures dans leur cadre, sur un écran plasma. Rien de tel ici. Le contenu des projections Klimt dans ce nouvel espace, l’Atelier des Lumières, qui ouvre vendredi dans une ancienne fonderie du XIe arrondissement à Paris, tiendrait dans un disque dur. Culturespaces, la société très sérieuse qui le gère, parle plus raisonnablement de « premier centre d’art numérique » dans la capitale.
On entre dans le noir pour une projection de 40 minutes, et si l’on veut, deux autres expositions « immersives » plus courtes. D’abord Klimt *, le grand peintre de la Sécession Viennoise au début du XXe siècle, inventeur de formes nouvelles, de nus étranges couverts d’or, de femmes aussi attirantes et inquiétantes que dans un film de David Lynch.
Au sol, aux plafonds, aux murs, les couleurs explosent »
Et ce même journal précise :
« C’est de la culture plaisir. Et même à Paris, comme le souligne Bruno Monnier, patron de Culturespaces, « les musées ne touchent que 50 % de la population au grand maximum. Beaucoup de gens n’osent pas en pousser la porte. Peut-être que ceux qui ont peur d’y aller seront moins intimidés par un espace comme celui-ci ».
Soyons clairs : ce n’est pas une expo, aucun tableau n’est cadré comme au musée. Un ballet plutôt, plus de 3000 images mises en mouvement par 140 vidéoprojecteurs laser. La salle des miroirs, où la projection se poursuit sous vos pieds, sur l’eau d’un ancien bassin de la fonderie, à l’infini, offre un léger vertige.
[…] Car si l’on vient à l’Atelier des Lumières pour Klimt, on a été soufflé par le show donné dans la petite salle par le collectif Poetic_Ai, qui utilise l’intelligence artificielle dans un processus de création visuelle, à travers un algorithme qui compose une œuvre digitale et contemplative. Un noir et blanc sidérant, une musique plein les oreilles, une expérience vraiment spéciale. »
Et même le site de « Côté Maison » parle de cet évènement avec enthousiasme : <L’Atelier des Lumières, lieu d’exposition monumental> :
« Entre prouesse technologique et histoire de l’art revisitée, l’Atelier des Lumières démultiplie les émotions. Dans une ancienne fonderie du XIXe siècle, le premier centre d’art numérique à Paris est né. Chaque exposition est une aventure sensorielle unique. […]
Sous la réalisation de Gianfranco Iannuzzi, Renato Gatto et Massimiliano Siccardi, avec la collaboration musicale de Luca Longobardi, dès les premières notes la technologie s’efface. L’aventure sensorielle se teinte d’émotion esthétique. Un exercice du regard inédit accompagne l’histoire de l’art d’une nouvelle soif d’apprendre.. »
C’est bien mon ressenti, dans cet espace dans lequel on peut se déplacer et rester aussi longtemps qu’on souhaite, la technologie s’efface et la beauté s’impose.
Il y a des avis divergents
L’essayiste et romancière Cécile Guilbert a produit un article très critique dans le journal La Croix : <La guerre à mort de la culture contre l’art> :
« puisque seule l’approbation de tout a droit de cité dans cette inlassable zone d’activité frénétique qu’est aujourd’hui « la culture », cette industrie appliquée aux Beaux-Arts, ce bazar mondial que le génial polémiste viennois Karl Kraus définissait déjà en son temps comme « le mal rapporté au système des valeurs esthétiques ». […]
Regarder, c’est toujours penser. […]
D’où mon interrogation sur la prolifération contemporaine croissante d’« installations », de « dispositifs », d’« événements » culturels à propos desquels même le mot exposition ne convient plus tant ils semblent n’avoir pour finalité que de nous en mettre justement « plein la vue », c’est-à-dire – CQFD – nous dissuader de penser. Démesure et monumentalité des formats, des lieux d’expos, des coûts et des prix, n’est-ce pas là d’ailleurs le propre d’un certain art dit contemporain, entreprise d’intimidation et de terreur habile à compenser l’anéantissement des facultés sensibles par l’ironie de ses gros jouets pour milliardaires ?
[…] débauche techniciste et pillage des peintres du passé forment une doublette d’enfer pour vider l’art de tout contenu et de tout sens. […]
Car si le surgissement de toute œuvre d’art digne de ce nom s’avère un événement – celui de sa présence, de son aura –, sa mise en scène événementielle en configure à coup sûr le tombeau. Or c’est précisément ce à quoi n’a jamais pensé Culturespaces, entreprise issue d’Havas et filiale d’Engie (ex-Lyonnaise des eaux devenue GDF-Suez), à savoir l’entrepreneur privé d’ingénierie culturelle à l’origine de ce « barnum Klimt » et dont le « business model » est si prometteur qu’il opère déjà dans une dizaine de monuments et de musées français tandis qu’un système de franchises est prévu à l’étranger…
Système rentable, système parfait, croissance et dividendes garantis, mais aussi honte et désolation éprouvées au spectacle sans cesse amplifié de l’étouffement de l’art par la culture, au nom de la culture comme bras armé de l’économie politique dont se constate l’essor planétaire toujours plus meurtrier. »
Attaque brillante, qui a du contenu et dont certains arguments me touchent…. l’étouffement de l’art par la culture.
Le <Billet culturel de Mathilde Serrell> sur France Culture qui reprend ces arguments de Cécile Guilbert et en ajoute même un autre :
« Souligner qu’afin de toucher un public familial, les nus les plus provocateurs d’Egon Schiele ne figurent pas dans la sélection. »
nuance quand même le propos sous forme de question :
« Mais l’objectif annoncé est de s’adresser en plus des 50% de la population que peuvent toucher les musées, aux 25% de gens qui n’y vont jamais. Freinés par la barrière de l’établissement culturel. On aurait donc avec ce format de diffusion numérique une sorte d’expérience collective d’art qui ne serait pas une exposition mais un divertissement culturel. Et alors ? Pourquoi pas ? »
A vous de voir.
Mais même une invitation comme celle-ci : « J’ai vu un truc super, vous devriez aller le voir aussi » renferme en elle, de la complexité et des questionnements.
<1111>