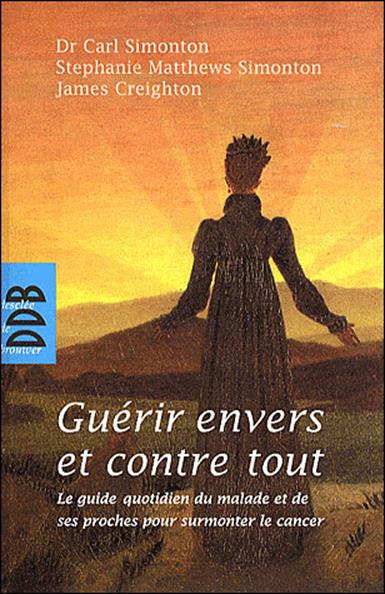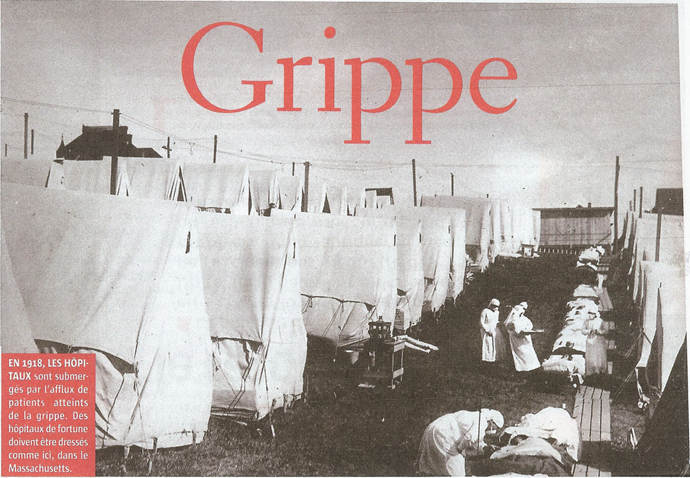Parallèlement au livre de Simonton, je lis aussi le premier livre de David Servan-Schreiber : « Anticancer ».
C’est un livre qui avait aussi renouvelé l’approche de cette maladie, beaucoup de conseils notamment alimentaires sont donnés, ainsi que des explications sur la manière dont elle se déclare et se développe.
Mais ce qui me fascine, avant tout, dans cet ouvrage, c’est l’humanisme qui s’en dégage.
David Servan Schreiber se décrit, avant, comme un jeune chercheur en neuroscience, ambitieux essayant de trouver des réponses grâce à la technologie la plus moderne, se désintéressant beaucoup des patients, peu enclin à des réflexions humanistes, tellement obnubilés par la réussite de ses recherches qu’il était prêt à sacrifier sa vie personnelle et sentimentale.
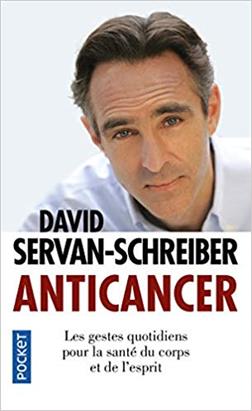 Et puis il y a après, après la découverte de son cancer.
Et puis il y a après, après la découverte de son cancer.
Et dans son chapitre 5 « Annoncer la nouvelle », il raconte une histoire et exprime aussi toute l’élévation spirituelle que lui a apporté et fait comprendre ce qui lui arrivait.
Et je voudrais partager le début de ce chapitre.
Souvent quand sait qu’une personne qu’on aime ou simplement qu’on apprécie est touchée par une maladie incurable ou très grave, on ne sait pas comment réagir, on ne sait pas quoi dire, on voudrait aider mais le comment ne nous apparait pas. Quelquefois on est tellement mal qu’on peut aller jusqu’à fuir la présence de cette personne.
En toute simplicité, David Servan Schreiber répond à cette angoisse et peur : « reste simplement là » :
« La maladie peut être une traversée terriblement solitaire. Quand un danger plane sur une troupe de singes, déclenchant leur anxiété, leur réflexe est de se coller les uns aux autres et de s’épouiller mutuellement avec fébrilité. Cela ne réduit pas le danger, mais cela réduit la solitude.
Nos valeurs occidentales, avec leur culte des résultats concrets, nous font souvent perdre de vue le besoin profond, animal, d’une simple présence face au danger et à l’incertitude. La présence, douce, constante, sûre, est souvent le plus beau cadeau que puissent-nous faire nos proches, mais peu d’entre eux en savent la valeur.
J’avais un très bon ami, médecin à Pittsburgh comme moi, avec qui nous aimions débattre sans fin et refaire le monde. Je suis allé un matin dans son bureau pour lui annoncer la nouvelle de mon cancer. Il a pâli pendant que je lui parlais, mais il n’a pas montré d’émotion. Obéissant à son réflexe de médecin, il voulait m’aider avec quelque chose de concret, une décision, un plan d’action. Mais j’avais déjà les cancérologues, il n’avait rien à apporter de plus sur ce plan. Cherchant à tout prix à me donner une aide concrète, il a maladroitement abrégé la rencontre après m’avoir prodigué plusieurs conseils pratiques, mais sans avoir su me faire sentir qu’il était touché par ce qui m’arrivait.
Quand nous avons reparlé plus tard de cette conversation, il m’a expliqué un peu embarrassé : « Je ne savais pas quoi dire d’autre. »
Peut-être ne s’agissait-il pas de « dire ».
Parfois ce sont les circonstances qui nous forcent à redécouvrir le pouvoir de la présence. Le docteur David Spiegel raconte l’histoire d’une de ses patientes, chef d’entreprise, mariée à un chef d’entreprise. Tous deux étaient des bourreaux de travail et avaient l’habitude de contrôler par le menu tout ce qu’ils faisaient. Ils discutaient beaucoup des traitements qu’elle recevait, mais très peu de ce qu’ils vivaient au fond d’eux-mêmes. Un jour, elle était tellement épuisée après une séance de chimiothérapie qu’elle s’était effondrée sur la moquette du salon et n’avait pas pu se relever. Elle avait fondu en larmes pour la première fois. Son mari se souvient : « Tout ce que je lui disais pour essayer de la rassurer ne faisait qu’aggraver la situation. Je ne savais plus quoi faire, alors j’ai fini par me mettre à côté d’elle par terre et à pleurer aussi. Je me sentais terriblement nul parce que je ne pouvais rien faire pour qu’elle se sente mieux. Mais c’est précisément quand j’ai cessé de vouloir résoudre le problème que j’ai pu l’aider à se sentir mieux. »
« Dans notre culture du contrôle et de l’action, la présence toute simple a beaucoup perdu de sa valeur. Face au danger, à la souffrance, nous entendons une voix intérieure nous houspiller : « Ne reste pas là comme ça. Fais quelque chose ! » Mais dans certaines situations, nous aimerions pouvoir dire à ceux que nous aimons : « Arrête de vouloir à tout prix « faire quelque chose ». Reste simplement là ! »
Certains savent trouver les mots que nous avons le plus besoin d’entendre. J’ai demandé à une patiente qui avait beaucoup souffert pendant le long et difficile traitement de son cancer du sein ce qui l’avait le plus aidée à tenir moralement. Mish y a réfléchi plusieurs jours avant de me répondre par email :
« Au début de ma maladie, mon mari m’a donné une carte que j’ai épinglée devant moi au bureau. Je la relisais souvent. Sur la carte, il avait écrit : « Ouvre cette carte et tiens-la contre toi…
Maintenant, serre fort. »
A l’intérieur, il avait tracé ces mots : « Tu es mon tout – ma joie du matin, ma rêverie sexy, chaleureuse et rieuse du milieu de la matinée, mon invitée fantôme à déjeuner, mon anticipation croissante du milieu de l’après-midi, ma douce joie quand je te retrouve le soir, mon sous-chef de cuisine, ma partenaire de jeu, mon amante, mon tout »
Puis la carte continuait : « tout va bien se passer. »
Il avait écrit en dessous : « et je serai là, à tes côtés, toujours.»
Je t’aime.
PJ.
Il a été là à chaque pas. Sa carte a tellement compté pour moi.
Elle m’a soutenue tout au long de ce que j’ai vécu.
Puisque vous vouliez savoir…
Mish »
Voilà…simplement … l’essentiel….
<1222>