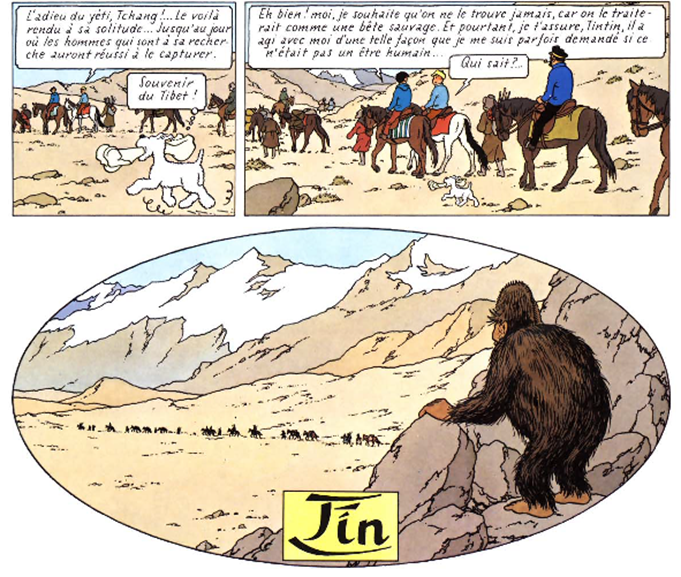la terre et l’âme de ce peuple qui m’a tant donné »
Un soir de juin, Annie est rentrée à la maison et m’a dit, il faut qu’on regarde quelque chose sur internet…
Alors nous avons regardé une vidéo.
La vidéo d’un discours de remerciement, de gratitude.
Celui qui faisait ce discours était Léonard Cohen.
J’ai eu envie de partager avec vous, après Maria Callas, ce récit, ce discours d’un autre musicien, d’un poète, d’un artiste qui nous a quitté il y a moins d’un an, le 7 novembre 2016.
Ce discours avait pour raison d’être une récompense : le Prix Prince des Asturies dans la catégorie Littérature.
Le Prince des Asturies est dans la monarchie espagnole le titre que porte l’héritier du trône.
Le prix Prince des Asturies est le plus prestigieux prix espagnol, délivré par une Fondation espagnole et récompensant des travaux d’envergure internationale dans huit catégories : arts, sports, sciences sociales, communication et humanités, concorde, coopération internationale, recherche scientifique et technique et lettres.
Et, le 21 octobre 2011, Léonard Cohen monta à la tribune et de sa voix grave et profonde prononça un discours et révéla un secret de sa vie, secret pour lequel il remercia la terre d’Espagne.
Voici la fin de ce discours :
« J’ai une guitare Condé, qui a été fabriquée en Espagne dans le formidable atelier du 7 de la rue Gravina [à Madrid]. Un superbe instrument, que j’ai acheté il y a plus de quarante ans. Je l’ai sorti de son étui, l’ai soulevé – il paraissait empli d’hélium tellement il était léger. Je l’ai porté à mon visage, que j’ai approché de la rosace superbement dessinée, et j’ai humé le parfum du bois vivant. Vous savez que le bois ne meurt jamais.
J’ai humé le parfum du cèdre, aussi frais qu’au premier jour, le jour où j’avais acheté cette guitare.
Et une voix a alors semblé me dire : « Tu es un vieil homme et tu n’as pas dit merci, tu n’as pas rendu ta gratitude à la terre d’où ce parfum a levé. » Je suis donc venu ce soir pour remercier la terre et l’âme de ce peuple qui m’a tant donné.
Car aussi vrai qu’une carte d’identité ne fait pas un homme, une notation financière ne fait pas un pays.
Vous connaissez le lien profond et confraternel qui m’associe au poète Federico García Lorca. Quand j’étais jeune homme, adolescent, je désirais ardemment trouver une voix. J’ai étudié les poètes anglais, je connaissais bien leurs œuvres, j’ai copié leurs styles ; mais je n’ai pas pu trouver de voix. Ce n’est qu’en lisant les œuvres de Lorca que – même par le biais d’une traduction – j’ai compris qu’il y avait là une voix. Non pas que je l’ai copiée ; je n’aurais pas osé. Mais Lorca m’a donné la permission de trouver une voix, de la localiser, c’est-à-dire de localiser un moi – un moi qui ne soit pas figé, qui lutte pour sa propre existence.
En prenant de l’âge, j’ai compris que cette voix portait des instructions.
Quelles étaient-elles ? Ces instructions disaient de ne jamais se lamenter avec désinvolture.
Et qu’à exprimer la grande et inévitable défaite qui nous attend tous, autant le faire dans les strictes limites de la dignité et de la beauté.
J’avais donc une voix ; mais je n’avais pas d’instrument. Je n’avais pas de chanson.
Je vais maintenant vous raconter très brièvement comment j’ai trouvé ma chanson.
J’étais un guitariste quelconque. Je ne connaissais que quelques accords. Avec mes amis de l’université, j’aimais m’asseoir et boire en chantant des folk songs et les chansons populaires du moment ; mais jamais au grand jamais je ne me serais considéré comme un musicien ou un chanteur.
Un jour, au début des années 60, j’étais en visite chez ma mère, à Montréal. Sa maison se trouvait le long d’un parc qui comprenait un court de tennis ; beaucoup de gens s’y pressaient, pour regarder les beaux jeunes joueurs qui pratiquaient leur sport. Je suis allé traîner dans ce parc que je connaissais depuis mon enfance. Il y avait là un jeune homme qui jouait de la guitare. C’était une guitare flamenco, et il était entouré par deux ou trois filles et garçons qui l’écoutaient. J’ai adoré sa façon de jouer, j’étais captivé. C’était ainsi que je voulais jouer ; et c’était ainsi, je le savais, que je ne serais jamais capable de jouer.
Pendant un moment, je suis resté assis au côté des autres auditeurs. Et quand vint un silence, un silence adéquat, j’ai demandé à ce garçon s’il voulait bien me donner des leçons de guitare. Il était originaire d’Espagne, et nous ne pouvions lui et moi communiquer que dans un mauvais français – il ne parlait pas anglais. Il a accepté de me donner des cours. J’ai montré la maison de ma mère, que nous pouvions voir depuis le court de tennis, et nous avons convenu d’un rendez-vous et d’un tarif.
Le lendemain, il s’est présenté chez ma mère et m’a dit : « Joue moi quelque chose ». J’ai essayé de jouer quelque chose, et il a ajouté : « Tu ne sais pas jouer, n’est-ce pas ? » « Non », ai-je répondu, « je ne sais pas. » « D’abord », a-t-il dit, « laisse-moi accorder ta guitare. Elle sonne complètement faux. » Il a donc pris la guitare et l’a accordée. « Ce n’est pas une mauvaise guitare », a-t-il dit. Ce n’était pas la Conde, mais ce n’était pas une mauvaise guitare. Il me l’a rendue. « Et maintenant, joue ».
Je ne pouvais pas mieux jouer.
Il m’a dit : « Laisse-moi te montrer quelques accords. » Il a saisi la guitare, et de cette guitare a jailli un son que je n’avais jamais entendu auparavant. Puis il a joué une suite d’accords avec un trémolo, avant de me dire : « A toi, maintenant ». « C’est hors de question », ai-je répondu, « j’en suis incapable. » « Laisse-moi poser tes doigts sur les frettes. » Une fois que ce fut fait, il a répété : « Maintenant, maintenant, joue. »
Ce fut un désastre. « Je reviendrai demain », me dit-il.
Il revint le lendemain, posa mes mains sur la guitare, et plaça la guitare sur mes genoux de la manière la plus appropriée. Je rejouai à nouveau les mêmes accords – une progression de six accords, sur laquelle reposent beaucoup de chansons de flamenco.
Ce jour-là, je fus un peu meilleur.
Au troisième jour, il y eut une amélioration – un semblant d’amélioration. Mais maintenant, je connaissais les accords. Et je savais que, même si je ne pouvais pas coordonner mes doigts avec mon pouce, de façon à produire le trémolo correctement, je connaissais les accords ; je les connaissais très, très bien.
Le jour suivant, le jeune homme ne vint pas. Il ne vint pas. J’avais le numéro de téléphone de sa pension à Montréal. J’ai appelé pour savoir pourquoi il avait manqué notre rendez-vous.
On m’a répondu qu’il avait mis fin à ses jours. Qu’il s’était suicidé.
Je ne connaissais rien de cet homme. Je ne savais pas de quelle région d’Espagne il était originaire. Je ne savais pas pourquoi il était venu à Montréal. Je ne savais pas pourquoi il avait séjourné là-bas, pourquoi il était apparu vers ce court de tennis. Je ne savais pas pourquoi il s’était donné la mort.
J’étais profondément affligé, bien sûr. Mais je vais divulguer maintenant quelque chose dont je n’ai jamais parlé en public. Ce sont ces six accords, ce sont ces motifs de guitare qui ont fourni la base de toutes mes chansons et de toute ma musique. Vous comprendrez dès lors dans quelles proportions s’exprime la gratitude que j’éprouve pour ce pays.
Tout ce que vous avez trouvé digne de vos faveurs dans mon travail provient d’ici.
Tout, tout ce que vous avez trouvé digne de vos faveurs dans mes chansons et ma poésie, a été inspiré par cette terre.
Je vous remercie donc infiniment pour la chaleureuse hospitalité dont vous avez fait preuve à l’endroit de mon œuvre ; car elle est vraiment la vôtre, et vous m’avez permis d’apposer ma signature au bas de la page. »
Si vous voulez entendre ce discours, en anglais, avec la belle voix de Léonard Cohen : <Discours de Léonard Cohen de 2011>
J’ai repris la traduction que propose <ce site>
Gracias à la vida de nous avoir donné Maria Callas.
Gracias à la vida de nous avoir donné Léonard Cohen
Et Gracias à la vida qui a rendu possible qu’un mystérieux espagnol ait su, en 3 jours, avant de quitter cette terre, permettre à Léonard Cohen de trouver son instrument.
<Leonard cohen Bird On The Wire>
 Comme l’oiseau sur le fil
Comme l’oiseau sur le fil
Comme l’ivrogne dans une église
J’ai tenté d’être libre à ma façon
Comme le ver au bout du fil
Comme le chevalier d’un ancien livre
J’ai gardé pour toi ma chanson
Si vous voulez lire les paroles et la traduction intégrale <Bird on the wire>
Et si vous voulez comprendre pourquoi Léonard Cohen est éternel, il faut écouter ces quatre enfants russes chanter Halleluyah, comme l’ont fait 14 millions d’internautes avant vous.