«Le mob football anglais et la soule française»
Ancêtres du football
Après l’antiquité des grecs et des romains nous en arrivons au moyen-âge. (Page 51 à 58 du livre « Le Dieu football – Ses origines – ses rites – ses symboles »)
Et nous allons nous intéresser à l’Angleterre et à la France.
En introduisant ce sujet deux caractéristiques communes me frappent :
- D’abord ces jeux sont d’une grande violence ;
- Ensuite, les autorités religieuses et seigneuriales ont tenté de les interdire.
Commençons par l’Angleterre :
Le jeu de ballon commença à se répandre en Angleterre sous le nom générique de « mob football » (« football du peuple »).
Au XI e siècle, il s’appelait à l’origine « fute balle » , « foote balle » ou encore « foeth-ball » , ou simplement « football » . […]
 Il existait, bien sûr, plusieurs variantes de ces jeux de ballon.
Il existait, bien sûr, plusieurs variantes de ces jeux de ballon.
La première, appelée hurling at goal (« lancer au but »), était pratiquée sur des terrains de taille réduite par des équipes de 30 à 50 footballeurs.
L’objectif était de « dribbler » ( dribble veut dire « pousser » en anglais) la balle de cuir vers le but adverse.
La seconde variante, hurling in the country (« lancer dans la campagne »), était réellement une bataille sanglante dans les champs entre deux villages.Elle était pratiquée lors des fêtes, en particulier en juin pour célébrer le retour de l’été et surtout du soleil.
La partie s’arrêtait lorsqu’une des deux équipes avait transporté la balle dans le camp ennemi par tous les moyens nécessaires.
L’auteur prétend que la première description du football en Angleterre aurait été faite par Sir Fitz Stephen (1174-1183). Il existait à Londres un festival annuel appelé Shrove Tuesday (l’équivalent de mardi gras). Et lors de cette fête :
« Après déjeuner tous les jeunes de la cité sortaient dans les champs pour participer aux jeux de balle.
Les élèves de chaque école avaient leur propre balle ; les ouvriers des ateliers portaient aussi leur balle.
Les citoyens âgés, les pères et les riches arrivaient à cheval pour regarder leurs cadets s’affronter, et pour revivre leur propre jeunesse par procuration : on pouvait voir leur passion s’extérioriser tandis qu’ils regardaient le spectacle ; ils étaient captivés par les ébats des adolescents insouciants.»
Philippe Villemus continue sa description :
« L’Angleterre se prenait de passion pour les jeux chaotiques de Shrove qui réunissaient les villages et les villes des environs de Londres.
Les masses compactes de joueurs des deux équipes se disputaient avec acharnement le ballon en vessie de porc pour le porter aux marqueurs situés aux extrémités de la ville. […]
Des versions plus civilisées de ce jeu, quoique toujours très rudes, étaient jouées dans les écoles aristocratiques.
Il est fait référence, dans l’histoire du collège d’Eton, en 1519, à des élèves frappant des ballons pleins de foin.
Eton développa une version du football appelée field game (« jeu de terrain »), codifiée au milieu du XIX e siècle, intermédiaire entre le rugby et le football. Toujours pratiqué, le field game a évolué séparément des autres sports. »
Il semble qu’au début, ces différents jeux de balle n’étaient pas du goût des aristocrates mais étaient réservés au peuple.
Dans Le Roi Lear , Shakespeare fait dire à un des personnages, en parlant de Oswald : « You, base football player ». (« Toi, vil footballeur »). »
Mais ce qui semble évident c’est que ces jeux étaient brutaux et en outre étaient de nature à déclencher des émeutes. C’est probablement pour ces raisons que des interdictions vont se multiplier, Philippe Villemus en cite plusieurs :
En 1314, le maire de Londres :
« En raison des grands désordres causés dans la cité par des rageries de grosse pelote de pee dans les prés du peuple, et que cela peut faire naître beaucoup de maux que Dieu condamne, nous condamnons et interdisons au nom du roi, sous peine d’emprisonnement, qu’à l’avenir ce jeu soit pratiqué dans la cité.» L’interdiction s’étala du XIII e siècle jusqu’à 1617.
En 1365, le roi Édouard III:
« Aux Shérifs de Londres.
Ordre de faire proclamer que tout homme sain de corps de ladite cité lors des jours de fête, quand il en a le loisir, doit utiliser dans ses sports des arcs et des flèches ou des frondes et des arbalètes.
Il leur est interdit, sous peine d’emprisonnement, de se mêler à des lancers de pierre, troncs d’arbres, poids, à des jeux de balle à la main ou au pied, ou autre vains jeux sans utilité, comme le peuple du royaume, noble et simple, a utilisé jusqu’ici ledit art dans leurs sports quand avec l’aide de Dieu va au-devant de l’honneur du royaume et l’avantage du roi dans ses actions de guerre. »
En 1388, le roi Richard II :
« Domestiques et travailleurs doivent avoir des arcs et des flèches et s’en servir les dimanches et jours de fête et abandonner tous les jeux de balle que ce soit à la main comme à pied.»
Et enfin un livre est cité : « L’anatomie des abus » de Stubbs en 1583 :
« L’un de ces passe-temps diaboliques usités même le dimanche, jeu sanguinaire et meurtrier plutôt que sport amical.
Ne cherche-t-on pas à écraser le nez de son adversaire sur une pierre ? Ce ne sont que jambes rompues et yeux arrachés.
Nul ne s’en tire sans blessures et celui qui en a causé le plus est le roi du jeu. »
Et il est à noter, à cette autre époque où la religion était très présente :
« Pendant près de 300 ans, le football fut interdit le dimanche. »
Aujourd’hui rien ne saurait priver les anglais du football le dimanche. Autre temps, autres mœurs !
Mais aucune interdiction, aucune prohibition ne parvint à arrêter cette passion des britanniques pour le jeu de ballon. Et l’auteur ose cette explication qui semble pleine de bon sens :
« Sa popularité devait dépasser les interdictions, les édits et les sommations qui en prohibaient la pratique, puisqu’il fallait les renouveler sans cesse. »
Pour faire la transition, Philippe Villemus pose que Le football britannique du Moyen âge ressemblait à s’y méprendre à la « soule médiévale française ».
L’auteur parle de soule médiévale française pour immédiatement préciser que : « La soule se développa au Moyen Âge, aussi bien dans les îles britanniques qu’en France. En Irlande, la soule proviendrait d’un vieux rite solaire celtique.  Ce rite celtique trouve des affinités avec d’autres rites primitifs dans lesquels un disque ou un objet globulaire symbolisent le soleil, source de vie. »
Ce rite celtique trouve des affinités avec d’autres rites primitifs dans lesquels un disque ou un objet globulaire symbolisent le soleil, source de vie. »
Pour rester dans la continuité des mots du jour précédents qui pour le premier opposait le Tsu chu chinois et le Kemari japonais, et celui d’hier qui opposait un jeu grec et un jeu romain, je trouve plaisant et commode d’opposer, aujourd’hui, un jeu anglais et un jeu français.
Mais il semble que la situation médiévale était plus compliquée et que les régions, les royaumes n’étaient pas étanches et que des coutumes passaient aisément de l’un à l’autre.
« La soule est un dérivé de l’ haspartum introduit par les légions romaines.
À l’époque gallo-romaine, on l’appelait ludos-soularum .
Le mot a deux origines possibles : soit sol (soleil), soit soles (sandales).
Pour certains, soule vient du latin solea qui veut dire pied.
Cela laisserait à penser que ce jeu, d’où aussi le mot « football », se pratiquait plutôt avec les pieds.
Le choulet , ou ballon, était une balle en cuir bourrée de son ou de foin, ou une vessie de bœuf gonflée d’air ; la balle était aussi en bois ou en osier.
La soule est mentionnée dans un édit de Philippe V le Long, en 1319.
La soule , ou choule ou cholle , est le prédécesseur à la fois du rugby, du football, du football américain et du football gaélique. »
Alfred Wahl a écrit un autre livre chez Gallimard consacré au football : « la balle au pied ».
Dans celui-ci on peut lire :
« Dans l’Europe médiévale, les jeux de balle avaient un caractère populaire et rude. Ils étaient pratiqués, conformément à la tradition, sans règles écrites. À l’intérieur de ce modèle, il existait d’innombrables variantes. […]
L’organisation de la soule était informelle. Les pratiques souples, non fondées sur des règles écrites et légitimées d’après la seule coutume, évoluaient lentement.
Le nombre de participants n’était pas fixé, ni la durée du jeu, ni même les limites précises de l’espace. »
Philippe Villemus continue :
« Le football et le rugby se disputent les origines de la soule, qui était plus un combat furieux qu’un jeu divertissant. Le coup d’envoi de la partie était donné devant l’église du village.
On présentait, au coup d’envoi, le ballon au soleil ou on le jetait en l’air vers l’astre solaire, comme pour l’invoquer ou rechercher sa bénédiction.
Ensuite, tous les coups étaient permis ou presque.
Les joueurs se jetaient les uns sur les autres, se mordaient, se cognaient dessus, se donnaient des coups de pieds, en hurlant et courant dans tous les sens.
Le but du jeu était de porter la balle dans un endroit précis. »
Et il cite encore Alfred Wahl :
« Les interdictions prononcées par les autorités attestent la brutalité d’un jeu dont les acteurs laissaient des éclopés sur le terrain et quelquefois des morts.»
Ce que confirme Philippe Villemus :
« Les rencontres étaient extrêmement violentes, et l’on conserve des lettres de rémission du XIV e siècle accordant le pardon à des maladroits qui avaient fendu la tête d’un adversaire au lieu de frapper le ballon ! Il faut dire que parfois on utilisait, pour s’emparer du ballon, de bâtons recourbés à l’image de notre moderne hockey ! Comme en Angleterre, Philippe le Bel, en 1292, Philippe V, en 1319, et Charles V en 1369, interdirent le jeu de soule par décret. »
Mais dans un monde de brutes, il y eut quand même une exception en Ecosse :
« À Inveresk, en Écosse, on a retrouvé les traces d’un jeu de balle pratiqué par les femmes, cette fois. C’est un des seuls témoignages connus du Moyen Âge qui permettait aux femmes de pratiquer ce jeu.
Une des deux équipes était constituée de femmes mariées, l’autre de célibataires. Il s’agit sans doute d’un rite lié à la fécondité et ayant pour but de conjurer la stérilité. Le football féminin est donc beaucoup plus ancien qu’on ne le croit. »
Les nobles jouaient rarement à la soule, mais nous apprenons que le roi Henri II y joua avec Ronsard : « Le Roi ne faisait partie où Ronsard ne fut toujours appelé de son côté.»
Et un poème de Ronsard contient ces vers :
« Faire d’un pied léger et broyer les sablons, Et bondir par les prés et l’enflure des ballons. Ore un ballon poussé vers une verte place.»
Les amours de Marie, XVI e siècle
Malgré les nombreuses interdictions :
« La fièvre du football se développa, aussi bien dans le peuple que chez les nobles et les clercs.
À Sens, on joua même au ballon dans une église.
À Auxerre, on sait que jusqu’au XVII e siècle, on jouait un jeu de ballon dans la cathédrale.
Les chanoines et les choristes s’y livraient un farouche combat pour la conquête du ballon. »
Rabelais, dans Gargantua , au chapitre XXIII, évoque aussi la soule :
« Se desportaient es près et joueaient à la balle, à la paume, à la pile trigone, galamment s’exerçant les corps comme ils avaient les âmes auparavant exercé.».
Tous ces jeux de ballon qu’on présente comme les ancêtres du football, dans des ouvrages consacrées au football, sont autant les ancêtres du rugby que du football et ressemble davantage à ce que j’appellerais de la bagarre.
<1092>
 Je n’ai lu qu’une fois explicitement, dans un article français, la réalité qui se cachait derrière cette expression « un petit démon ». Peut-être que la biographie anglaise, non traduite en français, de Meryle Secrest : « Leonard Bernstein, a life » est plus explicite, mais dans la biographie française qui fait autorité, celle de Renaud Machart chez « Actes Sud » le sujet est abordé de manière très elliptique dans un petit paragraphe à la page 17 d’un ouvrage qui en comporte plus de 200 :
Je n’ai lu qu’une fois explicitement, dans un article français, la réalité qui se cachait derrière cette expression « un petit démon ». Peut-être que la biographie anglaise, non traduite en français, de Meryle Secrest : « Leonard Bernstein, a life » est plus explicite, mais dans la biographie française qui fait autorité, celle de Renaud Machart chez « Actes Sud » le sujet est abordé de manière très elliptique dans un petit paragraphe à la page 17 d’un ouvrage qui en comporte plus de 200 :
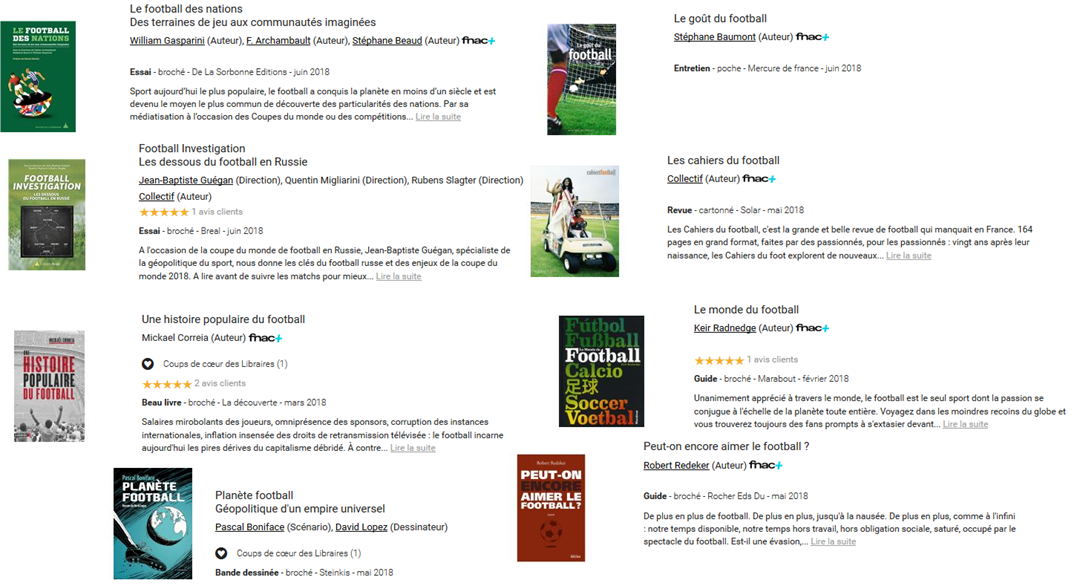
 règles écrites sur le football.
règles écrites sur le football. jeu. Un boulet fut tiré par les soldats, mais il rata son but, tombant loin de l’église sans faire de dégâts, sous les huées de la foule.
jeu. Un boulet fut tiré par les soldats, mais il rata son but, tombant loin de l’église sans faire de dégâts, sous les huées de la foule.

 Ce rite celtique trouve des affinités avec d’autres rites primitifs dans lesquels un disque ou un objet globulaire symbolisent le soleil, source de vie. »
Ce rite celtique trouve des affinités avec d’autres rites primitifs dans lesquels un disque ou un objet globulaire symbolisent le soleil, source de vie. »
 « Roule la balle, le monde roule. On soupçonne le soleil d’être un ballon de feu, qui travaille le jour et fait des rebonds la nuit dans le ciel, pendant que la lune travaille, bien que la science ait des doutes à ce sujet. En revanche, il est prouvé, et de façon tout à fait certaine, que le monde tourne autour de la balle qui tourne : la finale du Mondial 94 fut regardée par plus de deux milliards de personnes, le public le plus nombreux de tous ceux qui se sont réunis tout au long de l’histoire de la planète. La passion la mieux partagée : nombre des adorateurs du ballon rond jouent avec lui dans les stades ou les terrains vagues, et un bien plus grand nombre encore prennent place à l’orchestre, devant le téléviseur, pour assister, en se rongeant les ongles, au spectacle offert par vingt-deux messieurs en short qui poursuivent la balle et lui prouvent leur amour en lui donnant des coups de pied.
« Roule la balle, le monde roule. On soupçonne le soleil d’être un ballon de feu, qui travaille le jour et fait des rebonds la nuit dans le ciel, pendant que la lune travaille, bien que la science ait des doutes à ce sujet. En revanche, il est prouvé, et de façon tout à fait certaine, que le monde tourne autour de la balle qui tourne : la finale du Mondial 94 fut regardée par plus de deux milliards de personnes, le public le plus nombreux de tous ceux qui se sont réunis tout au long de l’histoire de la planète. La passion la mieux partagée : nombre des adorateurs du ballon rond jouent avec lui dans les stades ou les terrains vagues, et un bien plus grand nombre encore prennent place à l’orchestre, devant le téléviseur, pour assister, en se rongeant les ongles, au spectacle offert par vingt-deux messieurs en short qui poursuivent la balle et lui prouvent leur amour en lui donnant des coups de pied.