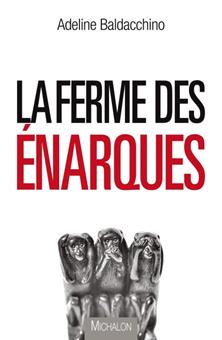« Les contradictions sociales du capitalisme contemporain »
Nancy Fraser, 38ème conférence Marc Bloch
Depuis lundi les mots du jour tournent autour de l’économie, des affaires, du profit et de l’argent qui corrompt.
Hier nous parlions du « consensus de Washington » qui selon les spécialistes a imposé le néo-libéralisme au monde par l’action du FMI et de la banque mondiale, en imposant des solutions dogmatiques aux pays endettés. Parallèlement la financiarisation de l’Économie a progressé.
 Aujourd’hui je vous invite à une réflexion d’une autre consistance. Elle est l’œuvre d’une grande intellectuelle américaine, Nancy Fraser née en 1947. Elle est philosophe, enseigne la science politique et la philosophie à la New School de New York. C’est aussi une féministe affirmée, ce qui n’est pas pour me déplaire. Elle a été invitée par l’École des Hautes Études en Sciences Sociales à participer, le 14 juin 2016, à la 38ème conférence Marc Bloch.
Aujourd’hui je vous invite à une réflexion d’une autre consistance. Elle est l’œuvre d’une grande intellectuelle américaine, Nancy Fraser née en 1947. Elle est philosophe, enseigne la science politique et la philosophie à la New School de New York. C’est aussi une féministe affirmée, ce qui n’est pas pour me déplaire. Elle a été invitée par l’École des Hautes Études en Sciences Sociales à participer, le 14 juin 2016, à la 38ème conférence Marc Bloch.
Vous trouverez le discours de cette conférence <ICI>, je vous invite à le lire, vous apprendrez beaucoup.
Je vais essayer de vous en dire quelques mots, à ma manière, et d’instiller une saine curiosité.
On pourrait décrire ce dont nous avons parlé depuis lundi comme d’une pièce de théâtre qu’on voit se jouer devant nous. Beaucoup en parle, les journalistes, les économistes, les politiques. Mais il existe en coulisse des choses essentielles qui se passent. Si ces choses n’existaient pas, la pièce de théâtre ne pourrait se jouer. Sur scène, nous sommes dans le monde des échanges marchands, dans la recherche du profit, dans la vie économique telle qu’on la raconte dans les livres et les écoles de commerce. Dans ce monde, la partie mâle de l’humanité reste largement prédominante. Nancy Fraser ne parle pas de théâtre, c’est une invention personnelle pour présenter sa réflexion.
Dans les coulisses se trouve le monde du « Care » selon le terme utilisé par Nancy Fraser, du «prendre soin » si on parle français, mais Nancy Fraser utilise le concept de « Reproduction sociale ».
Nancy Fraser évoque :
« les « pressions qui, de nos jours s’exercent, de toutes parts, sur toute une série de capacités sociales essentielles, à savoir la mise au monde et l’éducation des enfants, la sollicitude envers amis et membres de la famille, la tenue des foyers et des communautés sociales, ainsi que, plus généralement, la pérennisation des liens sociaux. Historiquement, ce travail de « reproduction sociale », comme j’entends le nommer, a été assigné aux femmes, bien que les hommes s’en soient aussi toujours en partie chargés. Etant à la fois affectif et matériel, souvent non rémunéré, c’est un travail indispensable à la société. Sans cela, il ne pourrait y avoir ni culture, ni économie, ni organisation politique. Toute société qui fragilise systématiquement la reproduction sociale ne peut perdurer longtemps. Et pourtant, c’est aujourd’hui précisément ce qu’est en train de faire une nouvelle forme de société capitaliste »
Nancy Fraser inscrit cette réflexion dans 3 étapes historiques :
La première phase est celui du capitalisme libéral et concurrentiel au XIXe siècle. Le temps où massivement l’exode rural a poussé les pauvres vers les villes et les centres industriels. Dans un premier temps, les femmes et les enfants dès leur plus jeune âge étaient mobilisés pour le travail productif, pour des salaires de misère, dans un univers de pauvreté et de misère sociale incommensurable. Mais les combats sociaux ainsi que la pensée humaniste venant de la bourgeoisie ont abouti à des lois qui ont réglementé le travail des enfants et aussi des femmes.
« Le second régime est celui du capitalisme géré par l’État du XXe siècle. Fondé sur la production industrielle à grande échelle et le consumérisme domestique dans son centre, soutenu par la poursuite de l’expropriation coloniale et post-‐coloniale dans sa périphérie, ce régime a internalisé la reproduction sociale à travers l’engagement de l’État et des entreprises dans la protection sociale. Faisant évoluer le modèle victorien des sphères séparées, ce régime promut ce qui de prime abord pouvait sembler plus moderne : l’idéal d’un « revenu familial », » c’est-à-dire qu’un seul salaire devait permettre de faire vivre une famille. C’était bien évidemment celui de l’homme de sorte que la femme puisse s’occuper de la reproduction sociale. »
Elle ajoute cependant : « même si, encore une fois, un nombre relativement limité de familles pouvaient l’atteindre. ». Cette seconde étape se caractérise par l’émergence et la consolidation de l’Etat providence ou l’Etat social.
Et puis nous arrivons à notre époque :
« Le troisième régime est celui du capitalisme financiarisé et globalisé de notre époque. Les activités de production manufacturière sont délocalisées dans les régions à bas coûts salariaux ; les femmes ont été intégrées à la main-‐d’œuvre salariée ; enfin, le désengagement de l’État et des entreprises de la protection sociale est encouragé. Il y a bien externalisation des activités de care vers les familles et les communautés, mais dans le même temps leurs capacités à les mettre en œuvre ont été atrophiées. Dans un contexte d’inégalités croissantes, il en résulte une organisation duale de la reproduction sociale : marchandisée pour ceux qui peuvent payer, « familiarisée » pour ceux qui ne le peuvent pas – l’ensemble se retrouvant enjolivé par l’idéal encore plus moderne de la « famille à deux revenus » »
Nancy Fraser, à travers ce regard décalé de la « reproduction sociale » examine l’ensemble des questions économiques. Elle explique ainsi la dette :
« Le principal moteur de cette évolution du capitalisme, et le trait caractéristique du régime actuel, est la dette. La dette est l’instrument par lequel les institutions financières mondialisées font pression sur les États pour réaliser des coupes claires dans la dépense sociale, pour imposer l’austérité et plus généralement pour agir de concert avec les investisseurs afin d’extraire de la valeur des populations sans défense. A mesure que les emplois de service mal payés et précaires remplacent le travail industriel protégé par la négociation syndicale, les salaires tombent en dessous des coûts socialement incompressibles de la reproduction ; dans cette « économies des petits boulots », le maintien des dépenses de consommation impose d’accroître la dette des consommateurs, celle-‐ci augmentant donc de manière exponentielle. En d’autres termes, c’est de plus en plus à travers la dette qu’aujourd’hui le capital se nourrit du travail, discipline les États, transfère la richesse depuis la périphérie vers le centre et, tel une sangsue, extrait de la valeur des foyers, des familles, des communautés et de la nature.
Il en résulte une exacerbation de la contradiction intrinsèque au capitalisme entre production économique et reproduction sociale »
Nous entendons nos élites politiques et économiques parler d’adaptation, de compétitivité, d’auto entrepreneuriat, de travail du dimanche, ou même de ce nouveau concept de slasheurs qui serait l’avenir des emplois. Jamais, ils ne nous expliquent quel projet de société impliquent ces évolutions.
Quand Nancy Fraser analyse ces évolutions pour leurs conséquences dans la reproduction sociale, elle explique :
« Non content de diminuer l’investissement de l’État tout en intégrant les femmes dans le travail salarié, le capitalisme financiarisé a aussi réduit les salaires réels, ce qui oblige les membres du foyer à augmenter le nombre de leurs heures travaillées, et ce qui les pousse à une course effrénée pour se décharger sur d’autres des activités de care. Pour combler ces « déficits de care », ce régime emploie dans les pays plus riches des travailleurs migrants qu’on fait venir des pays plus pauvres. Sans surprise, ce sont les femmes racialisées et/ou issues du monde rural pauvre qui prennent en charge le travail reproductif et de soin qui était auparavant assuré par les femmes plus privilégiées. Mais pour ce faire, les immigrés doivent transférer leurs propres responsabilités familiales à des travailleurs de care encore plus pauvres qui doivent, à leur tour, faire de même, et ainsi de suite dans des « chaînes de care mondialisé » aux ramifications toujours plus étendues. »
Et si on regarde du côté des femmes les plus dynamiques de l’économie moderne, totalement intégrées dans la high tech et ayant la volonté de concilier leur carrière professionnelle et leur épanouissement familial, Nancy Fraser raconte deux exemples américains :
« Le premier est la popularité croissante de la « congélation d’ovules », une procédure coûtant normalement 10 000 $ mais qui est offerte à leurs employées femmes hautement qualifiées par des entreprises de l’informatique comme un des avantages négociés dans leur contrat. Désireuses d’attirer et de garder ces employées, des firmes comme Apple ou Facebook les gratifient ainsi d’une forte incitation à décaler leur grossesse. En substance le message est le suivant : « attendez d’avoir 40, 50 ans, voire 60 ans, pour avoir des enfants ; consacrez‐nous vos années les plus productives, les années où vous avez le plus d’énergie»
Un second développement aux États-‐Unis est tout autant symptomatique de la contradiction entre production et reproduction : la prolifération d’appareils mécaniques high-‐tech et très coûteux pour tirer le lait maternel. Eh bien oui : voilà la solution qu’on adopte dans un pays où il y a un taux d’emploi élevé des femmes, où il n’y a pas de congé maternité ou parental rémunéré obligatoire, et où l’on est amoureux de la technologie. C’est aussi un pays où l’allaitement est de rigueur, mais cela n’a plus rien à voir avec ce que c’était par le passé que d’allaiter son enfant. On ne fait plus téter le sein à son enfant, on « allaite » désormais en tirant son lait mécaniquement et en faisant des stocks pour que la nounou puisse ensuite donner le biberon au bébé. Dans le contexte actuel de pénurie chronique de temps, les appareils à double coque, fonctionnant en « kit mains libres », sont ceux qui sont le plus recherché car ils permettent de tirer le lait des deux seins en même temps, tout en conduisant sa voiture sur la voie rapide, en route pour le travail.
Au vu de ces pressions actuelles, est-‐il surprenant que les luttes autour de la reproduction sociale aient éclaté ces dernières années ? Les féministes du Nord disent souvent que le cœur de leurs revendications se trouve dans « l’équilibre entre la famille et le travail » »
Pour finir je cite sa conclusion :
« Plus précisément, j’ai voulu expliquer que les racines de la crise actuelle du care sont à chercher dans la contradiction sociale intrinsèque au capitalisme, ou, mieux, dans la forme exacerbée que cette contradiction revêt aujourd’hui dans le contexte du capitalisme financiarisé. Si cette interprétation est correcte, cette crise ne sera pas alors résolue en bricolant la politique sociale. La solution à cette crise ne pourra se faire qu’en empruntant le chemin d’une profonde restructuration de l’ordre social actuel Ce qui est nécessaire, avant tout, c’est de mettre un terme à la soumission de «la reproduction» à «la production» que le capitalisme prédateur a réalisée Par voie de conséquence, il faut réinventer cette distinction et ré-‐imaginer l’ordre de genre. Reste à voir si l’issue de ce processus pourra encore être compatible avec le capitalisme »
Nancy Fraser donne des clés pour que nous puissions réfléchir et nous demander dans quelle société voulons-nous vivre ? Et de manière plus immédiate, quelle société implique les choix économiques qui nous sont vendus comme ceux de la modernité.
<J’ai découvert l’existence de cette conférence grâce à l’émission « la suite dans les idées » où Nancy Fraser était invitée>
<769>