« Réflexions sur la question antisémite »
Delphine Horvilleur
Mais d’où vient cette haine des juifs ?
Juste à la sortie de la dernière guerre, en 1946, après le génocide, Jean-Paul Sartre publia un essai « Réflexions sur la question juive ».
Ce livre se trouve en bonne place dans ma bibliothèque, au même titre que « Réflexions sur les questions juives » d’Annie Kriegel ou encore « Sémites et antisémites » de Bernard Lewis.
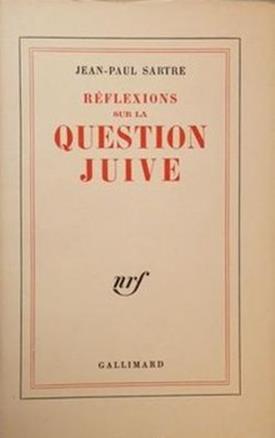 « Réflexions sur la question juive » de Sartre commence ainsi :
« Réflexions sur la question juive » de Sartre commence ainsi :
«Si un homme attribue tout ou partie des malheurs du pays et de ses propres malheurs à la présence d’éléments juifs dans la communauté, s’il propose de remédier à cet état de choses en privant les juifs de certains de leurs droits ou en les écartant de certaines fonctions économiques et sociales ou en les expulsant du territoire ou en les exterminant tous, on dit qu’il a des opinions antisémites. Ce mot d’opinion fait rêver…
C’est celui qu’emploie la maîtresse de maison pour mettre fin à une discussion qui risque de s’envenimer. Il suggère que tous les avis sont équivalents, il rassure et donne aux pensées une physionomie inoffensive en les assimilant à des goûts.
Tous les goûts sont dans la nature, toutes les opinions sont permises ; des goûts, des couleurs, des opinions il ne faut pas discuter.
Au nom des institutions démocratiques, au nom de la liberté d’opinion, l’antisémite réclame le droit de prêcher partout la croisade anti-juive. »
Pour Jean-Paul Sartre, c’est l’antisémite qui fait le juif, c’est le regard d’autrui qui fait du Juif, un Juif. Selon Sartre, pour mettre un terme à l’antisémitisme ce n’était pas le Juif qu’il fallait changer mais l’antisémite. Sartre estimait qu’il y a un antisémitisme latent même chez les esprits qui se veulent ouverts.
Cette thèse a été souvent décriée comme le rapporte cet article de Mediapart <Réflexions sur les Réflexions sur la Question Juive de Sartre> parce que
« Réflexions sur la Question Juive » est un essai publié en 1946 par Jean-Paul Sartre qui a souvent été décrié dans des milieux juifs parce que ceux-ci et manquait de profondeur. »
Pourtant la lecture de Raymond Aron m’avait conforté dans cette thèse de son ancien condisciple de l’Ecole Normale Supérieure de la rue d’Ulm.
En 1928, Aron est reçu premier à l’agrégation de philosophie. Et il se rend à partir de 1930 en Allemagne où il étudie un an à l’université de Cologne, puis de 1931 à 1933 à Berlin, où il est pensionnaire de l’Institut français et fréquente l’université de Berlin. Il observe alors la montée du totalitarisme nazi.
Dans son livre : « Le spectateur engagé » il raconte (page 34) :
« Quand je suis arrivé en Allemagne, j’étais juif et je le savais mais, si j’ose dire, je le savais très peu. Ma conscience de ma judéité, comme on dit maintenant, était extraordinairement faible. Je n’avais jamais été, dans une synagogue ou presque. […] en dehors du nationalisme qui était partagé par d’autres partis, [le nazisme] était singularisé par l’excès de l’antisémitisme, de telle sorte qu’à partir de cette année-là, 1930, je me suis toujours présenté d’abord comme juif. »
Il a aussi raconté un autre épisode vécu en Allemagne à cette époque. Il faut savoir qu’il était blond aux yeux bleus et ne correspondait pas à l’image que ce faisait beaucoup des pseudo-caractéristiques physiques des juifs. Il était logé par une femme allemande qui était très influencé par les discours nazis. Et un jour qu’elle avait encore dit tout le mal qu’elle pensait des juifs, Raymond Aron lui demanda si elle était vraiment sûre que les juifs étaient si terribles qu’elle les décrivait. Et elle lui répondit : qu’il était un brave garçon et qu’il ne les connaissait pas et ne pouvait donc pas s’imaginer de quoi « ils » étaient capable. Si l’époque n’avait pas été aussi tragique, cette histoire pourrait être drôle.
C’est en référence au livre de Sartre que la rabbin libérale Delphine Horvilleur a nommé son dernier livre sur la haine des juifs : <Réflexions sur la question antisémite>
Je trouve Delphine Horvilleur, l’une des trois femmes rabbins de France, absolument remarquable pour son ouverture d’esprit à l’égard des autres pensées et religions, pour son ouverture aussi sur les questions de sexualité sans tabou, de la féminité. Elle interroge les religions et la sienne sur ces sujets.
Elle a notamment écrit avec l’islamologue Rachid Benzine un livre de dialogue : « Il y a mille et une façons d’être juif ou musulman »
Rachid Benzine est l’auteur du livre « Nour, pourquoi n’ai-je rien vu venir ? », dont j’avais tiré une phrase plusieurs fois répétée et inspirante :
« Le contraire de la connaissance, ce n’est pas l’ignorance mais les certitudes.»
Il avait également écrit en 1998 avec le père Christian Delorme, dans le cadre d’un dialogue islamo-catholique aux Minguettes, dans la banlieue de Lyon, un livre : Nous avons tant de choses à nous dire,
Delphine Horvilleur et Rachid Benzine présentent ainsi leur livre commun :
« Nous avons tous deux compris que la Bible et le Coran n’étaient pas étrangers l’un à l’autre. Et tous deux nous revendiquons la liberté de la recherche et de la parole religieuses : une liberté responsable, qui prend en charge les questions et affronte les conflits.
Or, de nos jours, partout des fondamentalismes et des mouvements identitaires se prévalent de traditions anciennes qu’ils croient pouvoir faire remonter aux origines de leur foi.
Nous en sommes convaincus : être « héritier » ne consiste pas à mettre ce qui a été reçu dans un coffre fermé à clé, mais à le faire fructifier. Cela ne consiste pas à reproduire à l’identique ce qui a été reçu, mais à le renouveler.
Nous espérons que notre parole libre et résolument fraternelle fera surgir beaucoup d’autres paroles libres et fraternelles ! »
Pour parler de <Réflexions sur la question antisémite>, Delphine Horvilleur avait été invitée par Alexandra Bensaid sur France Inter <vendredi 4 janvier 2019>
Dans cette émission, elle a dit fort justement que
« L’antisémitisme n’est pas le problème des juifs mais d’une nation. […] le marqueur d’une nation en faillite, comme le rôle du canari dans la mine »
On sait, en effet, qu’avant les techniques modernes capables de détecter la présence de gaz, les mineurs avaient recours au canari sensible aux émanations de gaz. Lorsque le canari s’agitait ou mourait, le mineur savait qu’il fallait remonter rapidement vers la surface !
« PHILOSOPHIE MAGAZINE » explique que pour Delphine Horvilleur
Il n’y a pas de question juive, il n’y a qu’une question antisémite. Elle reprend quelque peu la réflexion de Jean-Paul Sartre que c’est le regard de l’autre qui fabrique le Juif. Mais son point de vue essentiel n’est pas d’approfondir la manière dont l’antisémite « fait » le Juif, mais plutôt de s’intéresser à savoir comment le Juif voit l’antisémite, comment la conscience juive vit avec ce qui veut sa perte. Il s’agit donc plutôt de « réflexions juives sur la question antisémite » conclut le magazine.
Delphine Horvilleur distingue, selon moi avec beaucoup de pertinence le racisme et l’antisémitisme.
« Le racisme est un mépris, l’antisémitisme est une jalousie, le premier s’exprime de haut, le second d’en bas ou de côté, l’un est un rejet du barbare, l’autre une « rivalité familiale ». La différence de couleur de peau ou de culture est vue comme « quelque chose en moins », que l’autre n’a pas pour être « comme nous » ; au Juif, on reproche au contraire d’avoir « quelque chose en plus », sans doute usurpé, qu’il accaparerait en en lésant le monde commun. Même pauvre, discriminé, victime du pire, il est encore « trop » : « littéralement, il m’excède »
Par la haine des Juifs, l’antisémite leur reproche tout et son contraire et échappe à toute logique.
Delphine Horvilleur écrit qu’« il est peut-être vain et immoral de lui chercher des modalités explicatives, ou d’analyser le raisonnement de ses agents. Inutile, à moins d’interroger ce que le haineux exècre exactement à travers le Juif, et de quoi sa détestation est le nom ».
Quand on se rappelle des perversions politiques du XXème siècle, on se souvient qu’on reprochait aux juifs d’avoir amené le communisme et les communistes accusaient les juifs de soutenir les banques et les puissances de l’argent. Les régimes soviétiques ont aussi persécutés les juifs.
Et je cite encore Philosophie magazine :
« La haine du Juif s’accroche à la permanence de plusieurs thèmes. Retenons-en un, qui tient à cœur à la première rabbin femme de France : la misogynie. Que ce soit par la métaphore de l’ulcère (le trou) ou celle de la coupure (la circoncision), par lesquelles il est décrit, le Juif représente le féminin qui angoisse la virilité des hommes. »
Et elle fait le tour des héros juifs face aux fantasmes de puissance :
- Jacob, le doux, l’imberbe, est préféré à Esaü, le fort, le poilu, pour conduire le peuple d’Israël ;
- les héros juifs sont boiteux (Jacob),
- aveugles (Isaac),
- bègues (Moïse),
- stériles (Abraham).
Elle a raison, cette galerie des héros juifs est une collection d’anti-héros auxquel il manque toujours quelque chose. Ils ne sont jamais des symboles de virilité.
« LE MONDE DES RELIGIONS » approfondit l’explication psychanalytique ainsi qu’une montée de haine venue de minorités contre une autre minorité : <Le juif renvoie l’antisémite à sa peur de la castration>
Et l’autre piste que suit la rabbin est celle de la menace que fantasme l’antisémite que « les juifs » empêchent un groupe, une nation d’être un tout homogène.
Dès lors, ce que hait l’antisémite est ce « pas-tout » qui empêche le groupe, ou la nation, ou l’Empire, de faire bloc, de se penser comme total, Un, pur. L’antisémitisme est la logique mortifère selon laquelle «pour que le monde soit en paix, il faudrait se débarrasser de ce qui divise, et que le juif incarne». C’est la crainte que le Tout (religion universelle, nation) auquel les antisémites veulent appartenir soit menacé dans son intégrité. C’est une angoisse identitaire dont rien n’indique qu’elle ait cessé d’être actuelle.
Le journal « LIBERATION » a également consacré une interview à Delphine Horvilleur sur son livre : «L’antisémitisme n’est jamais une haine isolée, mais le premier symptôme d’un effondrement à venir»
J’en tire les extraits suivants :
Quand avez-vous commencé à vous intéresser à l’antisémitisme ?
« L’antisémitisme hantait mon histoire familiale mais j’ai longtemps pensé que ma génération en serait protégée. En mai 1990, il y a une bascule au moment de la profanation du cimetière de Carpentras. Je repense souvent à la manifestation nationale que Carpentras a suscitée. Près de trente ans plus tard, lorsque des stèles juives sont profanées, comme ce fut le cas il y a moins d’un mois près de Strasbourg, personne ou presque ne le mentionne. Quelque chose d’absolument anormal est aujourd’hui tombée dans la banalité. Mon besoin d’écrire sur l’antisémitisme est lié à son regain, mais pas uniquement. Penser le judaïsme pousse nécessairement à s’interroger sur les origines de la haine antijuive à travers l’histoire, même si je ne crois pas – et c’est pour cela qu’il m’importait de détourner le titre de l’essai de Jean-Paul Sartre – que ce soit l’antisémite qui fasse le juif. »
Quel est le ressort de ce regain ?
« L’antisémitisme n’est jamais une haine isolée, mais le premier symptôme d’un effondrement à venir. Il est bien souvent la première exposition d’une faille plus large, mais il est rarement interprété comme annonciateur au moment où il frappe. Les attentats de novembre 2015 suivent de quelques mois la prise d’otages à l’Hyper Cacher de Vincennes et de quelques années la tuerie à l’école juive de Toulouse. Mais, évidemment, en 2012, personne ne peut le formuler ainsi. Depuis cette date, une question me hante : pourquoi, lorsque furent assassinés des enfants dans une école, la France n’était-elle pas dans la rue ? Etait-elle anesthésiée, aveuglée ou indifférente ? Cet attentat donne alors lieu à des 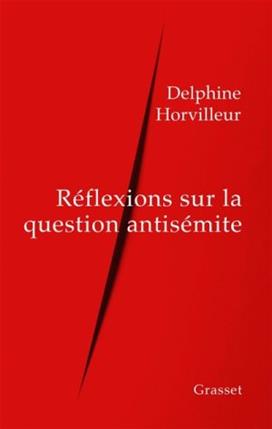 discours incroyablement déplacés : on évoquait l’importation supposée du conflit moyen-oriental ou des «tensions intercommunautaires» pour masquer l’horreur. L’absence de réaction collective reste une énigme insurmontable. »
discours incroyablement déplacés : on évoquait l’importation supposée du conflit moyen-oriental ou des «tensions intercommunautaires» pour masquer l’horreur. L’absence de réaction collective reste une énigme insurmontable. »
En quoi l’antisémitisme est-il différent du racisme ?
« On entretient une confusion en associant racisme et antisémitisme et à moins d’entrer dans une compétition victimaire, il ne s’agit pas de dire que l’un est plus grave que l’autre. Le racisme est souvent affaire de complexe de supériorité : je posséderais quelque chose qu’un autre n’a pas ou moins que moi. L’antisémitisme, au contraire, se construit sur une forme d’infériorité ressentie. On reproche aux juifs d’être plus ou d’avoir plus. Le juif est toujours accusé d’avoir un peu trop de pouvoir, ou bien d’être trop proche du pouvoir – on l’a entendu ici et là dans des slogans antisémites scandés en marge des manifestations des gilets jaunes. On soupçonne les juifs d’avoir un peu trop le contrôle, l’argent, la force et la baraka. Il y a toujours l’idée que le juif est là où je devrais être, qu’il a ce que je devrais avoir, qu’il est ce que je pourrais devenir. Peu importe que cela soit un fantasme. Peu importe qu’on puisse démontrer qu’il y a des juifs pauvres, qui n’ont ni influence ni pouvoir. Rien ne pourra ébranler cette conviction délirante, qui permet à certains de colmater les fêlures de leur existence. Dans tous les discours antisémites à travers les siècles, le juif représente la porosité ou la coupure qui empêche de se sentir en complétude. Quand un groupe ou une nation se perçoit en faillite, l’antisémitisme est l’énoncé le plus classique de sa tentative de reconstruction. C’est une consolidation identitaire qui se fait sur le dos d’un autre. »
Mais n’existe-t-il pas un communautarisme juif tout aussi clos sur lui-même ?
« Le communautarisme touche aujourd’hui tout le monde, et les juifs n’y échappent pas. La menace qui pèse sur un groupe dont les lieux de culte et les écoles doivent être protégés n’est pas de nature à inviter à ce que les portes s’ouvrent. Toutefois, il importe de ne pas renverser les responsabilités : ce repli n’est pas la cause de l’antisémitisme. De façon troublante, ce sont lors des moments dans l’Histoire où les juifs ont été les plus assimilés que l’antisémitisme a été le plus virulent. Ce fut le cas en Allemagne au début du siècle dernier. »
Il s’agit d’un article assez long écrit par la journaliste de Libération, Anne Diatkine et qui aborde de manière approfondie les questions sur l’identité juive tout en affirmant qu’elle est difficile à cerner.
Pour écrire ce mot du jour, je me suis encore inspiré des articles suivants :
De Médiapart : «L’antisémite à travers les siècles est toujours un intégriste»
L’Obs : « Qu’est-ce que l’antisémitisme »
<1198>

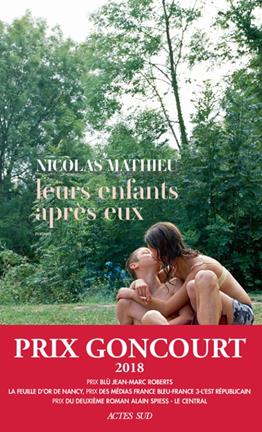


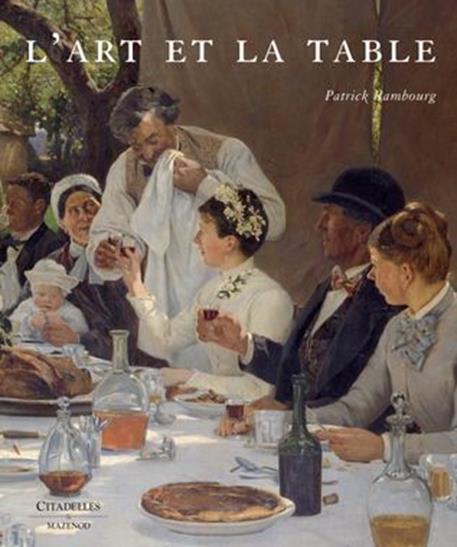
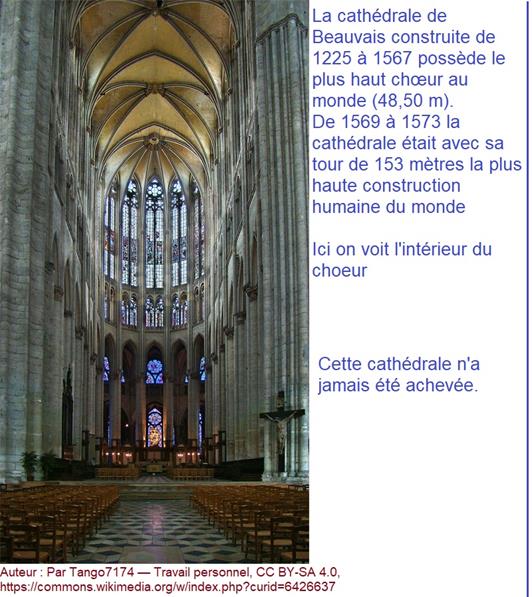




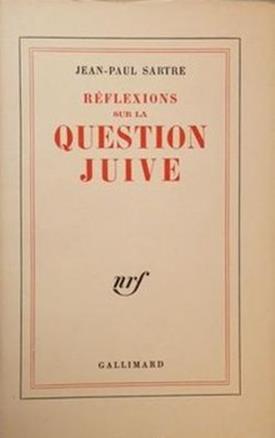

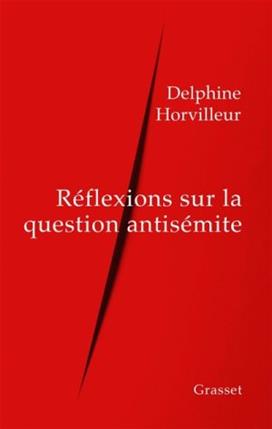 discours incroyablement déplacés : on évoquait l’importation supposée du conflit moyen-oriental ou des «tensions intercommunautaires» pour masquer l’horreur. L’absence de réaction collective reste une énigme insurmontable. »
discours incroyablement déplacés : on évoquait l’importation supposée du conflit moyen-oriental ou des «tensions intercommunautaires» pour masquer l’horreur. L’absence de réaction collective reste une énigme insurmontable. »