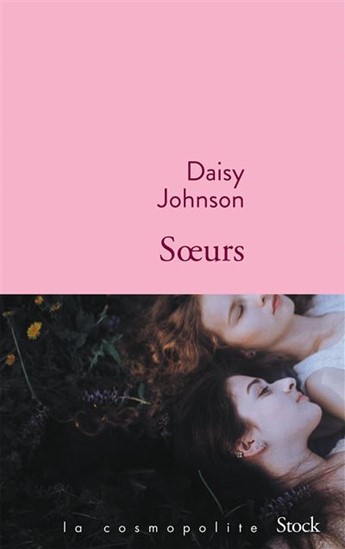« Soeurs. »
Daisy Johnson
J’écoutais la radio, en me promenant. A la fin de son émission, le journaliste a parlé avec enthousiasme d’un livre qu’il fallait lire, qui était palpitant, haletant, un chef d’œuvre !
Ce n’était pas de la publicité, c’était une opinion éclairée.
Dans la continuité de ma promenade, je suis entré dans la librairie Decitre, place Bellecour à Lyon et j’ai acheté « Sœurs » de Daisy Johnson.
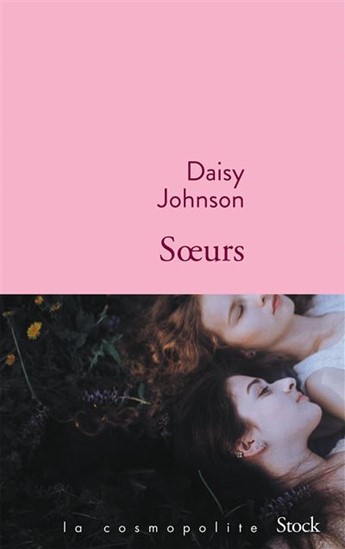 Il y a des moments dans lesquels on passe rapidement de l’information à l’action.
Il y a des moments dans lesquels on passe rapidement de l’information à l’action.
Je ne connaissais pas Daisy Johnson, j’avais compris selon l’émission de radio qu’elle était jeune et anglaise.
Sur le site de Stock qui l’édite, nous apprenons que Daisy Johnson est née en 1990. Elle a publié en 2016 un recueil de nouvelles, Fen, qui a été encensé par la critique outre-Manche. Son premier roman, « Tout ce qui nous submerge »(Stock, 2018), a été finaliste du Man Booker Prize 2017, faisant de Daisy Johnson la plus jeune finaliste dans l’histoire de ce prix. Elle vit à Oxford.
Quand vous naviguez sur le Web, vous tombez d’une critique étincelante à des louanges dithyrambiques.
Raphaëlle Liebaert, directrice littéraire de la collection qui a édité ce livre, précision nécessaire, parle de son coup de cœur de ce début d’année 2021 :
« Avec son nouveau roman, Daisy Johnson nous propulse au cœur de la relation fusionnelle entre deux sœurs adolescentes recluses dans une étrange maison sur la côte anglaise.
C’est brûlant, déchirant, palpitant et magistralement écrit. On pense à Laura Kasischke, à Daphné du Maurier, à Virgin Suicides. C’est un livre qui vous happe dès les premières pages et vous laisse ébloui – et sous le choc – lorsque vous le refermez. On comprend pourquoi la publication d’un livre de Daisy Johnson est un événement outre-Manche. Et pourquoi elle va être un événement en France ! »
Le journal « Elle » le place au rang de chef d’œuvre :
« Sœurs, encore un chef-d’œuvre de Daisy Johnson »
<Les Inrockuptibles évoque un roman ensorcelant et un délicieux roman gothique.
Dans le <Figaro> Eric Neuhoff parle de deux étranges adolescentes mais considère :
« qu’avec son deuxième roman, la jeune romancière britannique se propulse parmi les auteurs avec lesquels il va falloir compter. »
<Le journal du dimanche> évoque une méditation poétique et gothique sur l’amour fraternel et la place de l’enfant au sein d’une famille et ajoute :
« Le deuxième roman de Daisy Johnson nous entraîne vers cette contrée mystérieuse de l’adolescence où chaque émotion semble plus intense et chaque promesse, un pacte à la vie à la mort. Immergé dans le corps et les pensées de [la narratrice], le lecteur partage les craintes et les doutes de ces sœurs mi-anges, mi-démons. Un engrenage qui paraît obéir aux fabuleux sortilèges qui sont la marque des grands écrivains. »
Ce <journal belge> utilise le terme « fascinant » pour ce livre et décrit le travail de Daisy Johnson :
« Pour son second roman, Daisy Johnson, 31 ans à peine, use de toutes les libertés de l’écriture avec une inventivité jubilatoire. […] Il y a du Lewis Carroll et du Dickens dans son style si particulier, mélange de fantasmagorie, de peinture sensible de la nature et de réalisme social. Elle restitue à merveille la souplesse de l’imaginaire des enfants qui d’un bouton de porte font un visage ou imaginent des êtres minuscules dans un creux du mur. Elle n’a pas oublié non plus le plaisir du lecteur à entrer dans un univers mouvant, à avancer à tâtons, à faire le plein de sensations pour se glisser dans le décor ou la peau d’un personnage. »
Et <Les Echos> ne sont pas moins élogieux :
« La jeune écrivaine anglaise Daisy Johnson signe un second roman noir d’encre sur les démons de la sororité et les affres de l’adolescence, en s’inspirant des grands romans gothiques. Un tour de force poétique et littéraire, doublé d’une fascinante intrigue à suspense. […] Le pouvoir d’évocation de l’écrivaine, son génie de la construction, son style flamboyant incroyablement maîtrisé font le reste… Comme les romans gothiques d’antan, il offre une catharsis poétique et horrifique, crevant en beauté l’abcès de la tristesse du monde.
Mais cet article dit aussi :
« La dernière partie du livre, où tout bascule, est glaçante comme un tombeau. »
Alors, je ne vais pas spoiler comme on dit maintenant. Juste planter le décor.
C’est l’histoire de deux sœurs l’ainée Septembre et de 11 mois sa cadette Juillet. Leur mère s’appelle Sheela, elle écrit et dessine des livres pour enfant dans lesquels elle met en scène ses filles.
Le père est mort. On apprend au fil des pages que c’était un homme peu recommandable et violent « chez qui la haine ressemblait tant à l’amour »
Le début du livre nous présente la mère qui emmène précipitamment ses filles loin d’Oxford, où ils habitent car il s’est passé un incident au lycée et elles fuient.
La maison qu’ils vont rejoindre dans le nord, sur la lande du Yorkshire est délabrée et sans clé. C’est une maison, proche de la maison hantée et qui a une histoire, le père y est né et Septembre aussi.
Au fur à mesure, on comprend la relation morbide de domination qu’exerce Septembre sur sa sœur dans laquelle se côtoient protection et sadisme. Cette relation exclusive les éloigne de tous les autres jeunes de leur âge.
Plusieurs fois dans le roman on trouve le premier vers du poème qui se trouve avant le récit :
« Ma sœur est un trou noir »
Juillet est la narratrice, c’est elle qui raconte le récit par touche successive.
Le roman va se dérouler dans cette maison, dans un quasi huis clos. Murée dans sa dépression, la mère s’enferme dans la chambre du haut et laisse apparemment ses filles se débrouiller seules.
L’histoire avance dans l’angoisse et le dévoilement ambigüe de la vérité du récit.
Juillet écrit :
« Si les esprits sont des maisons qui comportent plusieurs pièces, dans ce cas, je vis à la cave. Tout y est sombre et silencieux. Parfois, je perçois un mouvement au-dessus de ma tête, l’eau qui coule dans les tuyaux ou quelque chose qui digère lentement. »
Toute sa vie, Juillet, aura vécu ainsi, dans l’antichambre de sa sœur, attendant d’être autorisée à penser par et pour elle-même.
A la page 169 du livre qui en compte 211 elle pose la bonne question :
« Je me suis demandé, c’était plus fort que moi, comment ça se serait passé s’il n’y avait eu que moi, si j’étais née la première et si Septembre n’était pas née du tout. Peut être que j’aurais eu des amis »
Mais elle ne poursuivra pas, et ne se libérera pas de l’emprise de sa sœur.
J’aime qu’un livre, comme une œuvre d’un autre art me fasse du bien, me nourrisse, me donne à réfléchir, m’apprenne des leçons de vie.
Mais pour cela il faut, même dans les récits les plus sombres, une étincelle de lumière, un peu de poésie ou de beauté. Toutes choses qui nous rattachent à la vie, la rende désirable.
Je me souviens encore avec émotion de la lecture que j’ai partagée lors d’un mot du jour « The God of Small Things » d’Arundhati Roy. L’histoire était terrible, injuste et tragique. Mais il y avait cette étincelle de vie, ces instants d’oubli, des moments de grâce.
Rien de tel dans « Sœurs », a l’instar d’un trou noir qui ne laisse échapper aucune lumière. D’ailleurs c’est par un trou noir que Juillet désigne sa sœur.
Un jour un musicien qui jouait avec mon frère et qui n’avait pas du tout apprécié une œuvre contemporaine qu’il avait dû jouer, en rencontrant le compositeur a eu cette formule :
« Maître cela a dû vous faire du bien quand cette œuvre est enfin sortie de votre tête.»
Je pense que cela a dû faire un bien fou quand cette histoire de folie, de chaos, de désagrégation, de mort est sortie de la tête de Daisy Johnson.
Je ne suis pas sûr qu’elle vous fasse du bien si elle rentre dans la vôtre.
Pour ma part je réponds : « Non » et je finirai par ce poème d’Eluard que j’ai déjà cité le 4 mai 2017 :
« La nuit n’est jamais complète
Il y a toujours puisque je le dis
Puisque je l’affirme
Au bout du chagrin
une fenêtre ouverte
Une fenêtre éclairée
Il y a toujours un rêve qui veille
Désir à combler faim à satisfaire
Un cœur généreux
Une main tendue une main ouverte
Des yeux attentifs
Une vie la vie à se partager.»
<1536>
 Un jour un professeur a amené des ballons à l’école. Et, il a demandé aux enfants de les gonfler puis que chacun écrive son nom sur un ballon.
Un jour un professeur a amené des ballons à l’école. Et, il a demandé aux enfants de les gonfler puis que chacun écrive son nom sur un ballon.