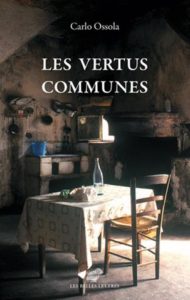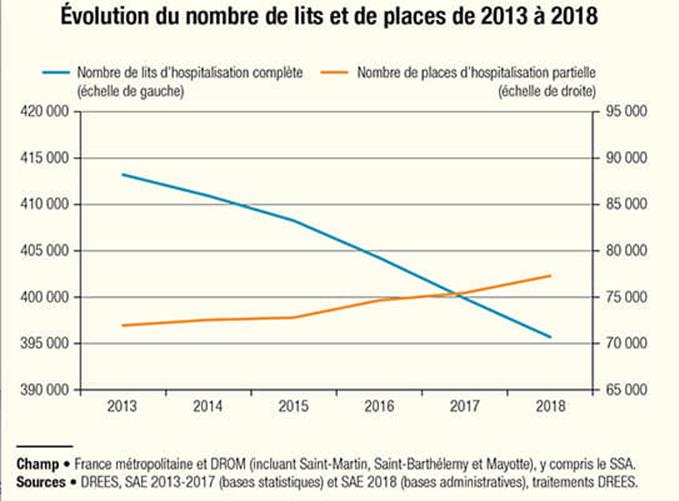Tout le monde n’est pas égal devant ce confinement qui nous est imposé et qu’heureusement, le plus grand nombre accepte.
 Il en est qui sont en confinement mais aussi en télétravail avec des responsables qui ne comprennent rien au temps présent et qui les harcèlent par des demandes de rendez vous vidéo répétitifs et trop longs. A cela s’ajoute peut être des enfants à occuper, à enseigner, à nourrir…
Il en est qui sont en confinement mais aussi en télétravail avec des responsables qui ne comprennent rien au temps présent et qui les harcèlent par des demandes de rendez vous vidéo répétitifs et trop longs. A cela s’ajoute peut être des enfants à occuper, à enseigner, à nourrir…
Il se peut aussi que des tensions apparaissent entre les occupants du lieu de confinement.
Et lorsque le chat commence à grimper aux rideaux le comble de la patience est dépassée.
Il en est aussi qui sont dans des lieux de confinement trop étroits pour le nombre de présents, c’est alors très difficile.
Mais pour d’autres qui sont davantage sans occupation précise, le risque est rapidement d’être totalement dépassé par l’ensemble des activités proposées par de nombreuses personnes
Marianne nous a fait parvenir une <petite vidéo> dans laquelle un homme confiné, cherche à trouver avec un ami, un moment pendant lequel ils pourront échanger plus longuement. Il s’aperçoit rapidement qu’il n’a plus aucun créneau disponible, tant son emploi du temps du confinement est rempli.
Surtout ne pas s’ennuyer !
Pas un moment de vide ! Un moment sans divertissement.
Le Point a publié un entretien, le 29 mars, avec Odile Chabrillac qui est psychologue et naturopathe : <Tuer l’ennui, quelle drôle d’idée ! >
L’article recommence par un rappel des Pensées de Pascal :
« Rien n’est plus insupportable à l’homme que d’être dans un plein repos, relevait Pascal, sans passion, sans affaire, sans divertissement, sans application. Il sent alors son néant, son abandon, son insuffisance, sa dépendance, son impuissance, son vide. Incontinent, il sortira du fond de son âme l’ennui, la noirceur, la tristesse, le chagrin, le dépit, le désespoir. »
Odile Chabrillac a publié un <Petit Éloge de l’ennui> (Éditions Jouvence, 2011).
Elle explique d’abord « l’ennui » :
« L’ennui est un sentiment extrêmement désagréable auquel on résiste, presque physiquement. Il y a quelque chose en nous qui a très peur de cet espace de vacuité parce qu’il nous fait penser à la dépression, à la mort. Alors, on met en place des stratégies d’évitement, de divertissement – au sens pascalien du terme –, on s’agite tous azimuts pour ne surtout pas en arriver là.
Or, précisément, c’est au moment où on lâche, où on assume le rien, qu’on va aller puiser au cœur de soi, et qu’on va pouvoir le transformer. Ennuyons-nous !
C’est dans cet espace vide laissé par l’ennui que se trouvent l’essence, la sève, le potentiel de joie, de créativité, d’invention. C’est la différence entre le vide vide et le vide plein. Mais évidemment, avant d’en arriver là, il est nécessaire de passer par cette phase très mélancolique, quasi dépressive, cette phase qui nous rappelle irrémédiablement les dimanches après-midi de notre enfance, lorsqu’on n’avait personne avec qui jouer et que l’on passait des heures à attendre que quelque chose se passe, que les adultes sortent de table ou prennent notre désœuvrement en compte. Ces après-midi d’enfance où le temps semblait s’étirer indéfiniment… »
Alors bien sûr, il ne s’agit pas d’un après-midi de l’enfance, mais d’une période de confinement longue dont nous ignorons pour l’instant la sortie :
« L’absence de perspective vient en effet majorer le désagrément intérieur. Non seulement on se retrouve dans une situation qu’on n’a pas l’habitude de gérer, mais surtout on ne sait pas pour combien de temps. C’est comme une maladie : il faut s’en remettre à plus grand que soi, ce qui, on le sait, n’est pas le fort des humains, qui ont tendance à vouloir tout contrôler. On se doute bien que la période engendrera de grandes transformations, autant du point de vue collectif que personnel. Mais que d’incertitudes à l’arrivée ! Cela rajoute beaucoup d’angoisse à l’ennui. C’est comme rouler avec le frein à main au plancher, c’est coûteux en énergie. Comme après tout traumatisme, notre cerveau est en train de se reconfigurer. Il se réinitialise en quelque sorte. Je pense que c’est pour cela que chacun se sent étonnamment épuisé en se couchant le soir. Certains de mes patients me décrivent une fatigue complètement disproportionnée par rapport à leur baisse d’activité. C’est bien que le cerveau est en train de turbiner. Il doute, angoisse, cherche des dérivatifs, de quoi remplir le vide, ne se satisfait pas, recommence, puis abandonne. Lessivé. »
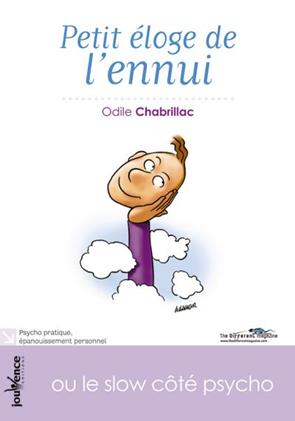 Mais nous sommes sollicités de toute part pour ne pas nous ennuyer, remplir le silence, remplir l’attente, de dizaines de choses à faire, partager, lire, regarder, agir.
Mais nous sommes sollicités de toute part pour ne pas nous ennuyer, remplir le silence, remplir l’attente, de dizaines de choses à faire, partager, lire, regarder, agir.
D’ailleurs lire, pendant cette période n’est pas si simple : « Pourquoi je n’arrive pas à lire de roman pendant le confinement. »
« Dès lors qu’on se rend compte que les distractions sont paradoxalement trop nombreuses, qu’on ne sait plus où donner de la tête, c’est qu’on est sur la bonne voie. On peut s’adonner plusieurs jours d’affilée à la compulsion visuelle, se noyer dans les écrans et se nourrir d’images, mais cela ne peut pas tenir sur la durée. Le jour où, lassé, on éteint la télévision ou on supprime la vidéo que l’on vient de recevoir sans y avoir jeté un œil, là, le vide devient intéressant. Angoissant, je suis tout à fait lucide là-dessus, voire fragilisant pour certaines personnes – il faut une structure psychique forte pour résister – mais c’est là que l’imagination va s’épanouir. »
Accepter le rien, grandir dans le retour sur soi.
Le mot du jour du <3 octobre 2019> donnait la parole au docteur Richard Béliveau « Malheureusement, pour beaucoup de gens, la seule fois dans leur vie où ils seront face à eux-mêmes, c’est au moment de mourir. »
« Affectivement, émotionnellement, cet enfermement peut en effet s’avérer très difficile à vivre. Je connais plein de gens qui n’auront jamais passé autant de temps avec leur femme, leur mari, leur famille, leurs enfants. C’est une bombe atomique en puissance ! Je pense qu’on est en train de vivre une véritable initiation collective. C’est mon interprétation, mais le monde occidental est aujourd’hui confronté de plein fouet à son plus grand tabou : la mort. Pour la regarder collectivement droit dans les yeux, il faut l’expérimenter chacun symboliquement, en acceptant le rien. Cela permet l’invention, on dirait, de nouveaux rituels collectifs. C’est assez fascinant à analyser. »
L’ennui qui devrait aussi permettre de se rendre compte que l’on peut vivre avec moins :
« C’est l’une de ses grandes vertus, en effet. On va réaliser que le vide, le silence, le fait de ne rien prévoir, n’est pas mortel. Mieux encore, que le renoncement, le dépouillement, a du bon. […] Ne vous inquiétez pas, les gens se mettent la pression au début, rangent tous leurs placards, font du tri, se mettent à lire Proust, mais ça ne peut pas tenir sur la durée. À partir de maintenant, nous allons entrer dans une phase de lâcher-prise et de renoncement. Certains en sortiront peut-être des œuvres de génie [qu’ils écriront comme les invite D’Ormesson] d’autres non. L’important, c’est la transformation collective que nous allons observer à l’arrivée. Mais en attendant, il faut traverser ! »
Un autre article du Point revient sur ce rejet de l’occupation à tout prix : <Michel Richard – Arrêtez avec vos conseils de lecture, de musique ou de visite !>.
Michel Richard écrit : « Nous croulons sous leurs propositions pour occuper notre vie recluse. Ils nous gavent et ne comprennent pas que le temps nous manque. »
Nous avons compris : Ennuyons nous !
<1383>