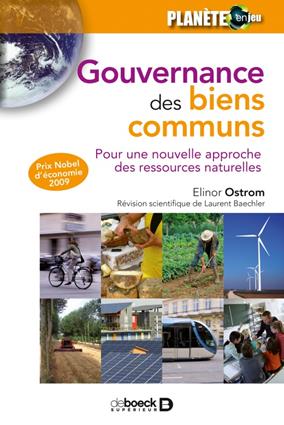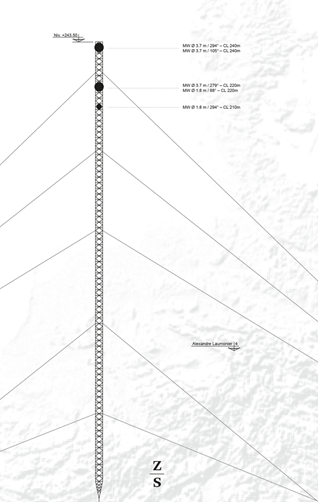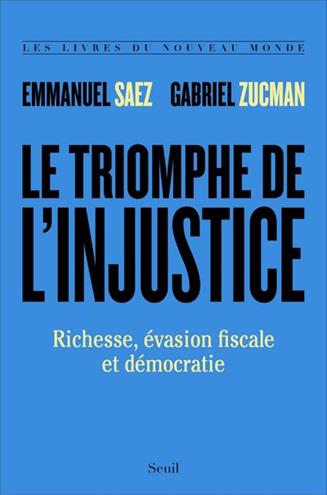« Avec cette pandémie, la fragilité de notre système nous explose à la figure »
Gaël Giraud
Gaël Giraud est un économiste remarquable et singulier.
 C’est d’abord un esprit extraordinairement brillant, selon les critères français :
C’est d’abord un esprit extraordinairement brillant, selon les critères français :
Après être passé par le lycée Henri IV (Paris), il intègre la rue d’Ulm : l’École Normale Supérieure. Ensuite comme école d’application il choisit l’École Nationale de la Statistique et de l’Administration Economique (ENSAE). Puis à la suite de deux années de service civil au Tchad (1995-1997), il soutient sa thèse de doctorat en mathématiques appliquées (à l’économie) au Laboratoire d’économétrie de l’École Polytechnique et à l’Université Paris-Panthéon-Sorbonne.
Après cela il aurait pu entrer dans une des grandes entreprises françaises pour gagner beaucoup d’argent.
Lui devint prêtre catholique et jésuite.
C’est un humaniste qui regarde notre société avec recul, hauteur et intelligence du cœur.
Deux mots du jour lui ont été consacrés, tous les deux en 2014, tous les deux consacrés au monde bancaire.
D’abord pour fustiger les relations coupables entre l’Etat et le monde bancaire et l’incapacité du gouvernement français sous la présidence Hollande de réaliser ce que ce dernier avait promis, c’est à dire la séparation des activités spéculatives et de la banque de dépôt, au sein du système bancaire : «La collusion entre la haute finance publique et la haute finance privée aujourd’hui, paralyse notre société.»
Ensuite, il avait réagi à l’amende colossale que les Etats-Unis avaient infligé à BNP Paribas, s’étonnant que l’UE soit incapable de faire la même chose à l’égard des banques américaines qui ont joué un rôle délétère au sein de l’Union européenne : « les autorités européennes, grecques, italiennes… pourraient sanctionner Goldman Sachs pour avoir truqué les comptes publics grecs qui ont permis à Athènes d’entrer dans la Zone euro, et JP Morgan pour avoir vendu des prêts toxiques en Italie. »
Dans l’article de Marianne que j’avais cité dans le premier mot du jour, il définissait ainsi sa vie :
« D’abord, je partage la même soupe avec mes compagnons le soir, quoi que je pense du secteur bancaire par ailleurs. Cela permet de penser librement. Ensuite, la vie de partage communautaire est une expérience essentielle des biens communs, au sens de l’économiste Elinor Ostrom : aujourd’hui, nos sociétés redécouvrent les biens communs via Vélib’, Vélo’v, le covoiturage, l’économie de fonctionnalité, etc., et cet apprentissage me paraît décisif pour la transition énergétique. Il induit une transformation radicale de notre rapport à la propriété privée. Eh bien, la vie religieuse occidentale pratique tout cela depuis quinze siècles au moins ! »
Je l’ai d’abord vu et entendu dans l’émission de Frédéric Taddei : « Interdit d’interdire » consacrée aux conséquences économiques de la pandémie.
Je regarde, en effet, l’émission « Interdit d’interdire » sur la télévision d’influence de Poutine « Russia Today » en raison de la qualité des échanges que peut réaliser Frédéric Taddei avec ses invités. Pour le reste je me méfie des informations que je peux trouver sur cette chaîne, tout en ne les rejetant pas systématiquement. Ce n’est ni blanc, ni noir, c’est gris !
Cette émission donnait en première partie la parole à Paul Jorion qui a déjà fait l’objet de mot du jour et qui est certes intéressant mais beaucoup moins didactique et précis que Gaël Giraud.
L’intervention de Gaël Giraud commence à 25:45, et je vous invite à la regarder, elle se trouve derrière ce lien : <Conséquences économiques de l’épidémie>
Après cette émission j’ai trouvé un article du 20 mars de l’OBS qui interviewait Gaël Giraud : « Avec cette pandémie, la fragilité de notre système nous explose à la figure »
Dans cet article, il souligne d’abord la singularité de cette crise :
« Elle est unique. Contrairement au krach boursier de 1929 et à la crise des subprimes de 2008, elle touche d’abord et en son cœur l’économie réelle. L’appareil productif est mis à l’arrêt, les chaînes de valeurs mondiales ralentissent ou sont interrompues, le travail est « en grève » involontaire. Ce n’est pas seulement une crise keynésienne d’insuffisance de la demande, c’est aussi une crise d’offre.»
Et il montre ainsi la vulnérabilité et la fragilité de notre système :
«La pandémie marque l’entrée dans une époque nouvelle, traversée de risques liés au réchauffement climatique et amplifiés par un capitalisme financiarisé qui nous rend extrêmement vulnérables à la finitude du monde.
Tout le monde ne peut pas travailler depuis chez soi. Or nous avons collectivement construit un système dans lequel certains aliments, par exemple, font deux fois le tour de la planète avant d’arriver dans notre assiette. Pour maximiser le profit à court terme, nous avons bâti des chaînes d’approvisionnement à flux tendus selon le principe du « juste-à-temps ». Ces flux sont extrêmement fragiles car il suffit que, le long de la chaîne, une seule société soit à l’arrêt parce que ses salariés sont malades ou refusent de risquer leur vie au travail, pour que la chaîne s’interrompe. Certaines métropoles pourraient en faire la cruelle expérience dans les jours ou les semaines qui viennent avec l’approvisionnement alimentaire.
Un système dans lequel la volatilité des marchés financiers est extrême parce qu’en dépit des avertissements répétés depuis plus de dix ans, nous n’avons mis aucun frein sérieux aux bulles et aux paniques boursières. Dans lequel, pour suivre des dogmes néolibéraux sans fondement scientifique, nous avons sous-doté l’hôpital et privatisé des services publics. Tout cela, nous le savons depuis des années. Aujourd’hui, cette fragilité nous explose à la figure. »
Il montre aussi comment notre système économique et la position dominante d’homo sapiens explique la force et la propagation du virus :
« La destruction écologique à laquelle se livre notre économie extractiviste depuis plus d’un siècle partage avec cette pandémie une racine commune : nous sommes devenus l’espèce dominante de l’ensemble du vivant sur Terre. Nous sommes donc capables de briser les chaînes trophiques de tous les autres animaux (et c’est bien ce que nous faisons, des poissons jusqu’aux oiseaux) mais nous sommes aussi le meilleur véhicule pour les pathogènes. En termes d’évolution biologique, il est beaucoup plus « efficace » pour un virus de parasiter l’humain que le renne arctique, déjà en voie de disparition à cause du réchauffement. Et ce sera de plus en plus le cas à mesure que les dérèglements écologiques vont décimer les autres espèces vivantes. »
Et il revient sur les marchés qu’il a étudiés depuis de nombres années et qui ont conduit à la financiarisation du monde :
« Les marchés financiers, sur lesquels nous tentons de faire reposer notre prospérité depuis plusieurs décennies, n’ont aucunement vu venir la pandémie. Pourtant, celle-ci n’est nullement un cygne noir, elle était parfaitement prévisible : l’OMS avait prévenu que les marchés d’animaux sauvages en Chine présentaient des risques épidémiologiques majeurs. Allons-nous continuer d’entretenir la fiction que les marchés financiers sont la boussole suprême de nos sociétés ?
En outre, depuis trente ans, la globalisation marchande s’est construite sur l’abondance des énergies fossiles, et en particulier du pétrole. Ces énergies réchauffent massivement la planète. Elles ont aussi permis d’étendre les chaînes de production, de rendre négligeable le prix du transport, de délocaliser dans des pays à bas coût, la Chine en premier lieu. Le pétrole est l’ingrédient essentiel grâce auquel Covid-19 s’est transporté en trois mois de Chine en Europe là où le Sras de 2002 avait mis un an. Aujourd’hui, la mise à l’arrêt de l’économie réelle fait chuter le cours de l’or noir. Cette chute a non seulement des effets sur les compagnies pétrolières, mais aussi sur le secteur financier. Énormément d’actifs financiers sont appuyés sur les énergies fossiles.
La fin de la globalisation marchande va sans doute provoquer une réduction massive de l’usage du pétrole pour le transport de marchandises et donc un effondrement de la valeur de certains de ces actifs. Cela ajoute à la panique d’institutions financières assises sur des montagnes de dettes privées (et non publiques) qui ne peuvent être remboursées qu’au prix d’une poursuite de la croissance du PIB. Or, 2020 sera sans doute une année de récession pour la plupart des pays. Beaucoup d’investisseurs ont compris qu’ils risquaient de devenir rapidement insolvables.
[Il faut donc s’attendre] à un krach plus important que celui de 2008, sauf si les Etats réagissent fortement et très vite pour éviter les faillites en chaîne dans l’économie réelle. L’administration Trump a déjà annoncé un effort de près de 1 000 milliards de dollars pour les ménages et les entreprises. La BCE a annoncé un plan de 750 milliards de rachats de dettes. Ce sont les bons ordres de grandeur, mais tout dépendra de la façon dont est utilisé cet argent. Il faut le flécher massivement vers les PME et les ménages. Faire du « quantitative easing for people », ce que nous aurions dû faire déjà en 2009. Sinon, ces sommes, une fois de plus, serviront uniquement à sauver les banques.
Les pays qui oseront dépenser massivement pour leur économie réelle s’en sortiront mieux. Nous sommes « en guerre » ? Alors, il faut comprendre l’étendue des déficits publics auxquels nous devons consentir : le déficit public des Etats-Unis, rapporté au PIB fut de 12 % en 1942, 26 % en 1943, 21 % en 1944, 20 % en 1945. Pour ceux qui resteront attachés au dogme de l’austérité budgétaire (qui n’a pas de fondement économique), la récession qu’ils vont connaître risque de faire passer celle qui a suivi 2008 pour une promenade de santé. »
Il synthétise aussi les leçons de cette pandémie et trace des perspectives qui devraient guider nos gouvernants et nos nations. Il utilise notamment ce concept très fécond « des communs »
[Cette pandémie] nous contraint à comprendre qu’il n’y a pas de capitalisme viable sans un service public fort et à repenser de fond en comble notre manière de produire et de consommer.
Cette pandémie ne sera pas la dernière : le réchauffement climatique promet la multiplication des pandémies tropicales.
En 2016, la Banque Mondiale estimait, par exemple, que la seule résistance aux antimicrobiens pourrait provoquer une perte de 3 % du PIB mondial en 2050.
La déforestation, tout comme les marchés d’animaux sauvages à Wuhan, nous met au contact d’animaux dont les virus nous sont inconnus. Le dégel du pergélisol menace de diffuser des épidémies dangereuses : la grippe espagnole de 1918, l’anthrax… Les élevages intensifs, d’animaux stressés et homogènes, facilitent aussi la propagation des épidémies.
A brève échéance, il va falloir nationaliser des entreprises non viables et, peut-être certaines banques. Mais, très vite, nous devrons tirer les leçons de ce printemps : relocaliser la production, réguler la sphère financière, repenser les normes comptables pour valoriser la résilience de nos systèmes productifs, instaurer une taxe carbone et sanitaire aux frontières, lancer un plan de relance français et européen pour la réindustrialisation écologique, la rénovation thermique et la conversion massive vers les énergies renouvelables…
La pandémie nous invite à transformer radicalement notre mode de socialisation.
Aujourd’hui, le capitalisme connaît le coût de toute chose, mais la valeur de rien, pour reprendre la formule d’Oscar Wilde. Il nous faut comprendre que la véritable source de la valeur, ce sont nos relations humaines et avec notre environnement. A vouloir les privatiser, nous les détruisons et nous mettons à terre nos sociétés tout en supprimant des vies. Nous ne sommes pas des monades isolées, reliées entre elles uniquement par un système de prix abstrait, mais des êtres de chair en interdépendance avec d’autres et avec un territoire. Voilà ce que nous avons à réapprendre.
La santé de chacun concerne tous les autres. Même pour les privilégiés, la privatisation des systèmes de santé est irrationnelle : ils ne peuvent se séparer totalement des plus modestes, ne fût-ce que pour se faire livrer à manger. La 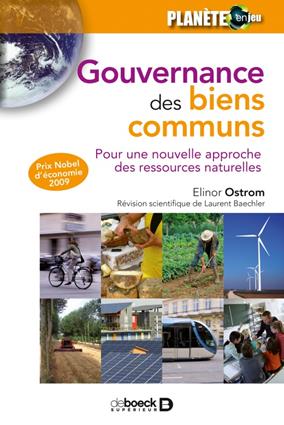 maladie les rattrapera donc toujours. La santé est un bien commun mondial et doit être gérée comme telle.
maladie les rattrapera donc toujours. La santé est un bien commun mondial et doit être gérée comme telle.
Les communs, remis à l’honneur notamment par l’économiste américaine Elinor Ostrom, ouvrent un espace tiers entre le marché et l’Etat, entre le privé et le public. Ils peuvent nous guider vers un monde plus résilient, à même d’encaisser des chocs comme cette pandémie.
La santé, par exemple, doit être traitée comme l’affaire de tous, avec des niveaux d’intervention stratifiés et articulés. Au niveau local, des communautés peuvent s’organiser pour réagir rapidement, en circonscrivant les clusters comme cela semble avoir été fait avec succès dans le Morbihan contre Covid-19 et, à l’inverse, comme cela n’a pas été fait en Lombardie. Au niveau étatique, il faut un service hospitalier public puissant. Au niveau international, il faut que les préconisations de l’OMS deviennent contraignantes. Rares sont les pays qui ont suivi les recommandations de l’OMS avant et pendant la crise. Nous écoutons plus volontiers les « conseils » du FMI… Le drame actuel montre que nous avons tort.
Ces derniers jours, nous avons vu des communs se constituer : des scientifiques qui, en dehors de tout cadre public ou privé, se sont spontanément coordonnés via l’initiative Opencovid19 pour mutualiser l’information sur les bonnes pratiques de dépistage du virus. La santé n’est qu’un exemple : l’environnement, l’éducation, la culture, la biodiversité sont des communs mondiaux. Il faut inventer des institutions qui permettent de les honorer, de reconnaître nos interdépendances et de rendre nos sociétés résilientes. Certaines existent déjà : Drugs for Neglected Disease Initiative (DNDi) est un magnifique exemple, créé par des médecins français il y a quinze ans, de réseau collaboratif tiers, où coopèrent le privé, le public et les ONG qui réussissent à faire ce que ni le secteur pharmaceutique privé, ni les États, ni la société civile n’arrivent à faire seuls. »
Et de manière plus immédiate, il nous montre ce que cette crise peut dévoiler :
« Elle nous délivre du narcissisme consumériste, du « je veux tout, tout de suite ». Elle nous ramène à l’essentiel, à ce qui compte « vraiment » : la qualité des relations humaines, la solidarité. Elle nous rappelle, aussi, à quel point la nature est importante à notre santé mentale et physique. Ceux qui vivent confinés dans un 15 m2 à Paris ou à Milan le savent déjà… Le rationnement qui s’installe sur certains produits nous rappelle la finitude des ressources. Bienvenue dans le monde fini ! Pendant des années, les milliards dépensés en marketing nous ont fait confondre la planète avec un supermarché géant où tout serait indéfiniment à notre disposition. Nous faisons brutalement l’expérience du manque »
Gaël Giraud est le contraire d’un naïf, il sait que des forces sont à l’œuvre pour aggraver le mal, utiliser cette crise pour surenchérir dans certaines voies délétères
« Je pense qu’un certain romantisme « collapsologique » va être vite tempéré par la vision de ce que signifie, dans la configuration actuelle, l’arrêt brutal de l’économie : le chômage, la ruine, les vies brisées, les morts, la souffrance au quotidien de ceux chez qui le virus laissera des traces à vie. Dans le sillage de l’encyclique « Laudato si » du Pape François, je préfère espérer que cette pandémie sera l’occasion de réorienter nos vies et nos institutions vers une sobriété heureuse et le respect de la finitude.
 Le moment est décisif : on peut craindre ce que Naomi Klein a baptisé la « stratégie du choc
Le moment est décisif : on peut craindre ce que Naomi Klein a baptisé la « stratégie du choc
». Il ne faut pas que, sous prétexte de soutenir les entreprises, certains gouvernements affaiblissent encore davantage le droit du travail. Ou qu’ils en profitent pour resserrer encore la surveillance policière des populations. Ou que le commerce en ligne finisse de tuer les magasins de proximité. Encore moins que les achats d’armes par certains gouvernements servent à contraindre les salariés modestes à risquer leur vie pour ne pas interrompre les chaînes d’approvisionnement des plus privilégiés. »
Si vous lisez des informations qui viennent de Chine, des États-Unis et du Canada vous constaterez qu’on parle partout de relance de l’économie, mais de relance dans l’économie carbonée et de diminuer les contraintes écologiques que les prises de conscience ont permis de mettre en œuvre, faiblement mettre en œuvre.
Le plus probable est que tout recommence comme avant et peut être même en pire en prétextant l’urgence du chômage et de la baisse du niveau de vie.
Dans sa conclusion il essaie une interrogation géopolitique :
« Ce que l’on peut dire, c’est que le coronavirus exacerbe le bras de fer entre la Chine et les Etats-Unis. La propagande chinoise s’efforce d’instaurer l’idée que le pays a su stopper la pandémie et semble vouloir faire bénéficier le reste du monde de son expérience. Pékin a surtout à se faire pardonner d’être à l’origine du problème : les services publics chinois ont dissimulé l’épidémie pendant plus d’un mois avant de prendre la mesure de sa gravité. Reste que cette pandémie peut devenir pour la Chine ce que fut la Seconde Guerre mondiale pour les Américains : le moment d’un basculement géopolitique et d’une prise de leadership mondial. Surtout si l’économie des Etats-Unis devait connaître une très dure récession.
Dans les pays occidentaux, on entend d’ailleurs une petite rengaine valorisant l’autoritarisme chinois. « Et si nos démocraties étaient mal armées ? Trop lentes ? Engluées dans les libertés individuelles ? » Cette antienne se fredonnait déjà avant la pandémie et me semble très dangereuse. La Chine est un pays totalitaire. La pandémie a-t-elle atteint le Xinjiang ? Sur le million de Ouïgours qui y vivent en camp de « rééducation », combien ont été touchés ? Combien survivront à la prochaine pandémie ?
Certains se demandent si, pour conserver leurs privilèges, ce ne serait pas le moment de basculer du laisser-faire vers l’autoritarisme (néolibéral).
Ce serait suicidaire. Comme l’écrivait déjà La Fontaine à propos de la peste : « Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. » Sacrifier l’âne innocent ne sert à rien et relève d’un paganisme médiéval. Il faut éviter la peste, c’est la seule attitude rationnelle pour tout le monde. »
Il y a comme toujours dans les réflexions qui ont du sens, plus de questions que de réponses.
L’avenir n’est pas écrit.
Nous ne pouvons certainement pas avec nos faibles moyens changer radicalement le monde. La tentation de la « tabula rasa » est d’ailleurs dangereuse, les expériences passées nous conduisent à beaucoup de prudence devant les doctrines qui nous promettent de tout reconstruire à partir d’une page blanche.
Je pense cependant que chacun de nous a un rôle, même minuscule, à jouer dans cette partition.
Pour ce faire il faut tenter de comprendre les forces qui sont à l’œuvre, se prémunir des solutions magiques et miraculeuses et accepter plus de sobriété comme nous y invitent les questions de Bruno Latour du mot du jour d’hier.
<1390>
 Claude Alphandéry est né le 27 novembre 1922 à Paris. Il s’engage dans des actions de résistance alors qu’il étudie au lycée du Parc à Lyon en automne 1941. Il assure notamment du transport de documents et des distributions de tracts.
Claude Alphandéry est né le 27 novembre 1922 à Paris. Il s’engage dans des actions de résistance alors qu’il étudie au lycée du Parc à Lyon en automne 1941. Il assure notamment du transport de documents et des distributions de tracts. Ils ont un Logo et l’Obs leur a consacré un article : « Des personnalités créent un… « Conseil national de la Nouvelle Résistance » » il y a aussi une vidéo accessible dans cet article dans laquelle divers intervenants explique la démarche.
Ils ont un Logo et l’Obs leur a consacré un article : « Des personnalités créent un… « Conseil national de la Nouvelle Résistance » » il y a aussi une vidéo accessible dans cet article dans laquelle divers intervenants explique la démarche.
 interdits à la culture en Europe. »
interdits à la culture en Europe. »