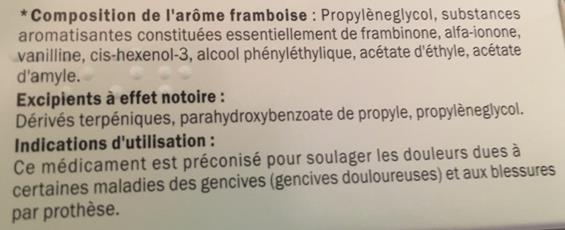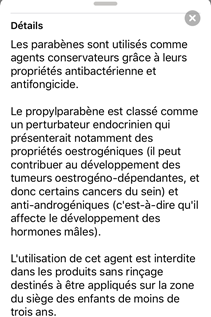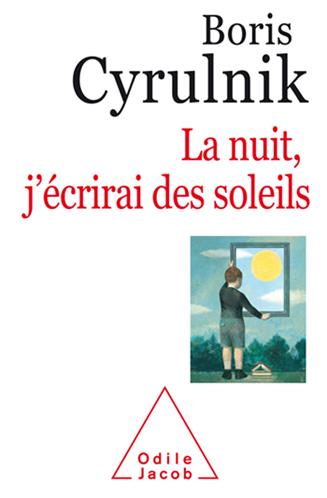Je termine aujourd’hui cette série sur les mots et expression d’aujourd’hui.
Il s’agissait de mots nouveaux qui viennent d’être inventés : « TikTok », « Méga-feux », « Flygskam » ou des expressions : « OK boomer »
Et puis il y avait aussi des mots qui ont une signification différente que celle attendue « Les sardines » ou des mots dont on retrouve la signification réelle comme « le consentement ».
Enfin des mots plus anciens mais qui ont une brûlante actualité « Populisme », « Hôpital public »
J’aurais pu parler d’« agribashing » de « Brexit » de « retraite » de « censure » et sur ce dernier mot il faut lire l’édito de Riss sur le site de Charlie Hebdo : « Les nouveaux visages de la censure »
Et puis « Féminicide » qui a été désigné comme le <mot de l’année> par le dictionnaire du Petit Robert. Ce terme qui <interroge la magistrature> et <le Droit> mais qui correspond à cette triste réalité de la violence que les hommes exercent à l’égard des femmes.
Mais je veux terminer par ce mot : « La vie ».
Je ne crois pas qu’il puisse exister un mot plus éternellement actuel que « la vie ».
Si je n’étais pas en vie je ne pourrais pas écrire, et si vous ne l’étiez pas vous ne pourriez pas lire. La vie est ce que nous avons de plus précieux.
La vie qui est relation comme l’écrit si bien Alain Damasio :
« Une puissance de vie !
C’est le volume de liens, de relations qu’un être est capable de tisser et d’entrelacer sans se porter atteinte. »
L’académicien François Cheng qui parle si bien de la beauté (regardez cette <vidéo> à partir de 21’10 qui est un replay de la Grande Librairie) et qui a rédigé « Cinq méditations sur la mort autrement dit sur la vie » a écrit :
« Disons dès à présent sans détour que je fais partie de ceux qui se situent résolument dans l’ordre de la vie. […] pour nous, le principe de vie est contenu dès le départ dans l’avènement de l’univers. Et l’esprit, qui porte ce principe, n’est pas un simple dérivé de la matière. Il participe de l’Origine, et par là de tout le processus d’apparition de la vie, qui nous frappe par sa stupéfiante complexité. Sensibles aux conditions tragiques de notre destin, nous laissons néanmoins la vie nous envahir de toute son insondable épaisseur, flux de promesses inconnues et d’indicibles sources d’émotion. »
Cinq méditations sur la mort, pages 16 & 17
Si un jeune, dans un moment de sérénité pendant lequel il n’aurait pas la tentation de me lancer « Ok boomer » mais plutôt de me demander : à ton âge, avec ce que tu as appris si tu n’avais qu’une phrase à me dire, laquelle serait-elle ?
 Je répondrai certainement
Je répondrai certainement
« N’oublie pas qu’il y a une vie avant la mort ! »
Qu’il y ait une vie après la mort, certains le croient, mais ce n’est pas sûr.
En revanche, avant la mort il y a une vie à vivre.
L’actualité du mot « vie » est aussi liée aux menaces qui pèsent sur la biodiversité. « La sixième extinction massive a déjà commencé ». La disparition des insectes est profondément préoccupante.
L’homme n’est pas seul sur terre. Sa vie, son équilibre dépendent aussi de la vie d’autres espèces.
Le médecin Marie François Xavier Bichat (1771-1802) a écrit dans son livre « Recherches physiologiques sur la vie et la mort » un aphorisme souvent repris :
« La vie est l’ensemble des fonctions qui résistent à la mort »
Jean d’Ormesson a nuancé cette définition :
« Ma définition à moi serait plutôt l’inverse : la vie, c’est ce qui meurt. La vie et la mort sont unies si étroitement qu’elles n’ont de sens que l’une par l’autre. »
La vie est aussi tout ce qui se passe entre la naissance et la mort.
Et cette vie n’est pas la même pour tous, ni en ce qui concerne la durée, la santé, la souffrance, le plaisir et la joie.
Et ainsi l’actualité du mot « La vie » vient aussi de la leçon inaugurale, le 16 janvier, de Didier Fassin au Collège de France sur « l’inégalité des vies ».
 Vous trouverez sa leçon inaugurale derrière <ce lien>
Vous trouverez sa leçon inaugurale derrière <ce lien>
Didier Fassin, né en 1955, est un anthropologue, sociologue et médecin français. Il est professeur de sciences sociales à Princeton et directeur d’études à l’École des hautes études en sciences sociales. Il a été élu au Collège de France pour occuper une chaire annuelle en 2020 consacrée à la santé publique. Il a travaillé sur les malades du sida, les demandeurs d’asile, l’humanitaire, la police, la justice, la prison, et sur « l’inégalité des vies ».
 Il a écrit un livre paru en 2018 qui pour titre « La vie » et sous-titre « Mode d’emploi critique ».
Il a écrit un livre paru en 2018 qui pour titre « La vie » et sous-titre « Mode d’emploi critique ».
Je l’ai d’abord entendu sur France Inter, le 17 janvier 2020, invité par Ali Baddou puis sur France Culture, le 18 janvier 2020, pour évoquer sa leçon inaugurale pour parler de ses recherches et de sa réflexion.
L’Obs a republié un grand entretien qu’il avait mené avec Didier Fassin lors de la sortie de son livre sur la « Vie »
Ces différents points d’entrée dans la réflexion et les études de Didier Fassin m’ont énormément intéressé.
Il arrive à réaliser cette performance de décliner avec naturel les statistiques et les études générales sur l’espérance de vie, la qualité de vie et les inégalités mais aussi de se mettre à hauteur d’homme pour illustrer la froideur des chiffres par l’émotion et la vérité de l’histoire de la vie d’êtres humains dont il raconte la réalité.
Il ne m’est pas possible de faire une synthèse de son propos mais je citerai un extrait de sa leçon inaugurale qui commence par l’espérance de vie :
« (…) Ce que nous nommons d’une expression aussi élégante que trompeuse « espérance de vie » n’est qu’une mesure abstraite résultant de la sommation de la probabilité de décéder aux différents âges et imaginant une génération fictive soumise aux conditions de mortalité de l’année considérée. Mais où donc est passée la vie ? Certes, l’espérance de vie nous informe sur un fait majeur : les disparités considérables de longévité existant dans nos sociétés – treize ans en France, quinze ans aux Etats-Unis, quand on compare les plus riches et les plus pauvres.
Mais ce qu’on peut dire de l’inégalité des vies tient-il dans cette seule mesure ? Deux illustrations suggèrent que cette quantification est nécessaire mais non suffisante. Elément troublant, en France, mais l’observation vaut pour d’autres pays occidentaux, quelle que soit leur catégorie socioprofessionnelle, les femmes ont une mortalité plus faible que les hommes. Ainsi les ouvrières vivent-elles plus longtemps que les hommes cadres, même si l’écart s’est réduit au cours des dernières décennies.
Ce fait, principalement lié à des différences de comportements à risque au regard de la santé, a souvent été décrit comme signant un privilège pour le sexe féminin. Or, d’une part, si les ouvrières ont une espérance de vie à 35 ans de deux années supérieure aux hommes cadres, leur espérance de vie sans incapacité est de sept ans inférieure, conséquence probable de conditions de travail défavorables ; l’avantage apparent est donc un artifice. D’autre part, et surtout, l’espérance de vie ne renseigne pas sur la qualité de vie, que ce soit en termes d’autonomie, d’émancipation, d’exposition au sexisme, et finalement de réalisation de soi ; nul besoin de souligner combien, sur ces différents plans, les femmes ont été et sont encore pénalisées dans un pays où elles n’ont obtenu que récemment le droit de voter et d’ouvrir un compte bancaire, l’accès à la contraception et à l’interruption volontaire de grossesse, l’autorité parentale conjointe et l’égalité des époux dans la gestion des biens de la famille, la reconnaissance des violences conjugales et du harcèlement sexuel.
Comme n’a cessé d’y insister Françoise Héritier [1933-2017], ce qu’elle appelle la « valence différentielle des sexes » est, dans toutes les sociétés humaines connues, le produit de hiérarchies qui opèrent dans l’univers symbolique autant que dans le monde social, le premier servant souvent de justification au second pour distribuer inégalement le pouvoir. Qu’en France, ou ailleurs, les femmes vivent plus longtemps que les hommes ne nous dit rien, par conséquent, de ce qu’est leur vie ou, plus précisément, ce que la société en fait.
Une réflexion en quelque sorte symétrique peut être développée pour ce qui est des hommes noirs aux Etats-Unis qui, eux, vivent moins longtemps que les hommes blancs. La mort d’hommes et d’adolescents afro-américains tués par des policiers, et notamment d’Eric Garner étouffé lors de son interpellation pour vente de cigarettes à la sauvette [le 17 juillet août 2014, à New York], de Michael Brown abattu de plusieurs balles alors qu’il marchait dans la rue [le 11 août 2014, à Ferguson], de Freddie Gray victime de fractures cervicales occasionnées par son arrestation à la suite d’un contrôle d’identité [le 15 avril 2015, à Baltimore], de l’enfant Tamir Rice tué sur un terrain de jeux alors qu’il portait à la ceinture un pistolet factice [à Cleveland, le 22 novembre 2014], et de bien d’autres, a révélé la fréquence de ces incidents mortels. »
Et il revient à la réflexion sur la vie que j’ai essayé d’esquisser au début de ce mot du jour mais en la confrontant à la réalité des inégalités :
« Il y a ainsi, d’un côté, la vie qui s’écoule avec un commencement et une fin, et de l’autre, la vie qui fait la singularité humaine parce qu’elle peut être racontée : vie biologique et vie biographique, en somme. L’espérance de vie mesure l’étendue de la première. L’histoire de vie relate la richesse de la seconde. L’inégalité des vies ne peut être appréhendée que dans la reconnaissance des deux. Elle doit à la fois les distinguer et les connecter. Les distinguer, car le paradoxe des femmes françaises montre qu’une vie longue ne suffit pas à garantir une vie bonne. Les connecter, car l’expérience des hommes afro-américains rappelle qu’une vie dévalorisée finit par produire une vie abîmée. »
Et il cite Bourdieu et parle de notre société économique et sociale :
« Comme Pierre Bourdieu, dont les livres m’ont fait découvrir les sciences sociales, l’a montré à propos de sa propre histoire : c’est en prenant la distance épistémologique nécessaire qu’on transforme une expérience en connaissance et qu’on fait d’une dette sociale une œuvre scientifique. La question de l’inégalité est présente dans toute la sienne, même s’il lui donne d’autres noms, reproduction et domination, force de l’habitus et lutte des classements. De cette inégalité, qui prend de multiples formes, à l’école et dans le travail, en termes de capital économique et de capital social, la plus profonde est celle devant la vie même. »
J’ai donc voulu terminer cette série de mots par la « vie » avec un regard d’abord philosophique et poétique pour ensuite, grâce à Didier Fassin, esquisser la réalité sociologique des inégalités devant la vie. Car la vie n’est pas la même si un enfant nait en Somalie ou en Allemagne, s’il nait dans une famille pauvre ou dans une famille riche, s’il nait dans une famille noire ou dans une famille blanche, s’il nait femme ou homme dans beaucoup de pays du monde.
Et sur ce point on comprend bien que les solutions ne sauraient être individuelles mais sont politiques au sens le plus noble de ce terme.
Je sais que beaucoup ne croit plus en la politique. C’est pourtant la seule solution, celle de ne pas s’occuper de son seul ego, de sa petite famille, de son petit jardin mais de s’intéresser plus globalement à la communauté des vivants.
Didier Fassin restreint son propos à homo sapiens. J’aimerais élargir cette vision et inclure dans la communauté des vivants, non seulement l’espèce humaine mais aussi les autres espèces et les végétaux qui sont « en vie ».
Je finirai pas un dessin qui pose une question :

<La Leçon inaugurale de Didier Fassin : l’inégalité des vies>
<1349>




 pprend comment manager une équipe, comment s’adapter à la transversalité de projet, afin de parvenir à une meilleure agilité. Des choses qui sont très étrangères à l’action de soigner. »
pprend comment manager une équipe, comment s’adapter à la transversalité de projet, afin de parvenir à une meilleure agilité. Des choses qui sont très étrangères à l’action de soigner. »