Il fallait donc lire « La Peste » puisque nous étions en confinement.
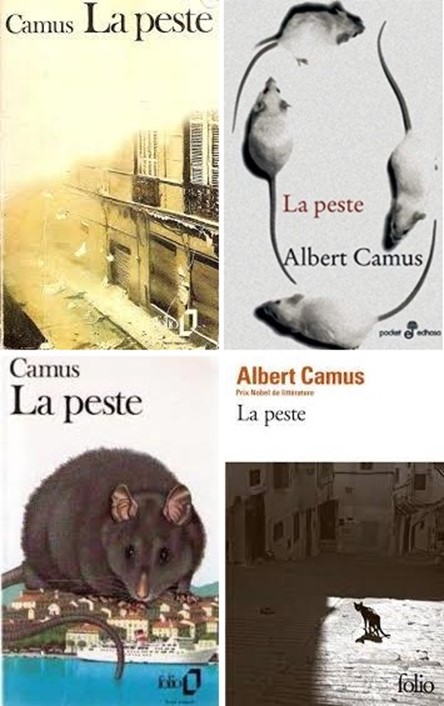 Alors j’ai lu « La Peste », ce roman qui décrit l’apparition de l’épidémie dans la ville d’Oran, la lente prise de conscience du danger, la fermeture des portes de la ville, le confinement, la lutte contre l’épidémie avec au premier plan le docteur Rieux courageux, rationnel, résistant au découragement et puis finalement la fin de l’épidémie qui se termine avec son cortège de morts qu’elle a emporté, la joie et l’allégresse des oranais devant la fin de l’épreuve et les portes de la ville qui s’ouvre.
Alors j’ai lu « La Peste », ce roman qui décrit l’apparition de l’épidémie dans la ville d’Oran, la lente prise de conscience du danger, la fermeture des portes de la ville, le confinement, la lutte contre l’épidémie avec au premier plan le docteur Rieux courageux, rationnel, résistant au découragement et puis finalement la fin de l’épidémie qui se termine avec son cortège de morts qu’elle a emporté, la joie et l’allégresse des oranais devant la fin de l’épreuve et les portes de la ville qui s’ouvre.
Et c’est ainsi que se termine « La Peste » :
« Du port obscur montèrent les premières fusées des réjouissances officielles. La ville les salua par une longue et sourde exclamation. Cottard, Tarrou, ceux et celle que Rieux avait aimés et perdus, tous, morts ou coupables, étaient oubliés. Le vieux avait raison, les hommes étaient toujours les mêmes. Mais c’était leur force et leur innocence et c’est ici que, par-dessus toute douleur, Rieux sentait qu’il les rejoignait. Au milieu des cris qui redoublaient de force et de durée, qui se répercutaient longuement jusqu’au pied de la terrasse, à mesure que les gerbes multicolores s’élevaient plus nombreuses dans le ciel, le docteur Rieux décida alors de rédiger le récit qui s’achève ici, pour ne pas être de ceux qui se taisent, pour témoigner en faveur de ces pestiférés, pour laisser du moins un souvenir de l’injustice et de la violence qui leur avaient été faites, et pour dire simplement ce qu’on apprend au milieu des fléaux, qu’il y a dans les hommes plus de choses à admirer que de choses à mépriser.
Mais il savait cependant que cette chronique ne pouvait pas être celle de la victoire définitive. Elle ne pouvait être que le témoignage de ce qu’il avait fallu accomplir et que, sans doute, devraient accomplir encore, contre la terreur et son arme inlassable, malgré leurs déchirements personnels, tous les hommes qui, ne pouvant être des saints et refusant d’admettre les fléaux, s’efforcent cependant d’être des médecins. Écoutant, en effet, les cris d’allégresse qui montaient de la ville, Rieux se souvenait que cette allégresse était toujours menacée. Car il savait ce que cette foule en joie ignorait, et qu’on peut lire dans les livres, que le bacille de la peste ne meurt ni ne disparaît jamais, qu’il peut rester pendant des dizaines d’années endormi dans les meubles et le linge, qu’il attend patiemment dans les chambres, les caves, les malles, les mouchoirs et les paperasses, et que, peut-être, le jour viendrait où, pour le malheur et l’enseignement des hommes, la peste réveillerait ses rats et les enverrait mourir dans une cité heureuse. »
Cette conclusion est si contrastée : la ville d’Oran exprime l’allégresse de la fin du fléau mais Rieux se souvient de toutes celles et de tous ceux qu’il a aimé et qu’il a perdu dans cette douloureuse épreuve.
Il porte cependant l’humanisme de Camus, sa croyance dans la solidarité possible entre les hommes pour des causes qui les dépassent. Et il affirme que finalement le positif l’emporte sur le négatif : « on apprend au milieu des fléaux, qu’il y a dans les hommes plus de choses à admirer que de choses à mépriser. »
Et qu’en face des épreuves, les hommes malgré leurs faiblesses font face : « tous les hommes qui, ne pouvant être des saints et refusant d’admettre les fléaux, s’efforcent cependant d’être des médecins. »
Mais il y a aussi l’avertissement que l’épidémie peut revenir, car il n’y a pas de victoire définitive.
C’est une chronique en temps de crise. Elle se lit avec intérêt et il est difficile de lâcher ce roman avant de l’avoir fini.
Nous suivons la quête du docteur Rieux dans son sacerdoce laïc du médecin qui soigne, qui perd beaucoup de combats contre la mort et qui continue à soigner sans jamais lâcher prise. Il cherche aussi à entraîner d’autres pour former une équipe qui peut lutter contre l’épidémie.
Mais la lecture, au temps du COVID, surprend quand même. On ne voit pas très bien comment Rieux et les autres soignants se protègent contre cette maladie si infectieuse, beaucoup plus létale que celle qui nous assaille aujourd’hui. Les théâtres, les restaurants et les bars, contrairement à l’Europe de la COVID 19, restent ouverts et les habitants de la ville s’y rendent en nombre.
Le sujet de la peste à Oran est totalement inventé par Camus, elle ne correspond à aucune réalité proche qui se rapprocherait d’une telle épidémie dans une ville.
Camus lui-même n’était pas convaincu par ce livre. Dans une lettre à son ami Louis Guilloux et que reproduit <L’Obs>, il écrit :
« 12 septembre 1946
Je suis bien coupable, mais les choses ne vont pas fort pour moi. […] Au bout du compte, j’ai fini « la Peste ». Mais j’ai l’idée que ce livre est totalement manqué, que j’ai péché par ambition et cet échec m’est très pénible. Je garde ça dans mon tiroir, comme quelque chose d’un peu dégoûtant. […] »
Son biographe Olivier Todd <dit> de même au détour d’une phrase dans laquelle il parle du conflit de Camus avec les Sartriens :
« Il y avait pourtant eu, dans Les Temps modernes, deux articles plus que laudatifs sur les héros de La Peste – livre que je n’aime guère. »
En réalité, Camus n’a pas fait le roman d’un problème sanitaire, de quelque chose qui ressemble à ce qui nous arrive.
Pierre Assouline dans un article de mai 2020 dans le mensuel « L’Histoire » : « La Peste » et le pangolin explique
« Avec la crise du coronavirus le livre de Camus est devenu un best-seller mondial. Donnant un tour inattendu au 60e anniversaire de la mort de l’écrivain.
On ne sait jamais ce qu’un anniversaire nous réserve. La coïncidence avec l’esprit du temps demeure une surprise. Elle peut changer du tout au tout le visage des cérémonies commémoratives, l’ampleur de leur impact et le souvenir que l’opinion en conservera. Ainsi du 60e anniversaire de la mort d’Albert Camus à 46 ans.
Il a démarré en fanfare dès le début de l’année (l’écrivain est mort un 4 janvier) avec la diffusion de deux remarquables documentaires : l’un de Georges-Marc Benamou, Les Vies d’Albert Camus (France 3), portrait intime, riche d’images inédites ; l’autre de Fabrice Gardel et Mathieu Weschler, Albert Camus, l’icône de la révolte (Public Sénat), lui aussi fécond en témoignages. […] les droits de traduction de L’Étranger ont été à ce jour cédés à une soixantaine de pays, mais encore parce que La Peste est, depuis quelques semaines, « le » livre qu’il faut désormais avoir lu si l’on veut comprendre le mal qui ronge l’Europe. Il est la meilleure vente de Gallimard depuis mars, suivi par Le Hussard sur le toit de Jean Giono. D’innombrables articles lui sont partout consacrés, tandis qu’en Espagne, notamment, les librairies étant fermées, on se dépêche de le publier pour la première fois en e-book.
Cette chronique d’une épidémie à Oran avait connu un grand succès à sa parution en 1947. Sauf qu’il ne reposait pas, comme aujourd’hui, sur un malentendu, puisque les lecteurs savaient parfaitement de quoi il retournait : une allégorie du nazisme, peste brune. Il ne lui fut pas moins reproché de diffuser une « morale de Croix-Rouge ».
<Wikipedia> rapporte, en outre, une polémique entre Roland Barthes et Albert Camus sur ce sujet :
En février 1955, Roland Barthes rédige un article sur La Peste où il qualifie la référence au contexte de la Seconde Guerre mondiale comme un « malentendu ».
Camus lui répond dans une lettre ouverte en ces termes :
« La Peste, dont j’ai voulu qu’elle se lise sur plusieurs portées, a cependant comme contenu évident la lutte de la résistance européenne contre le nazisme. La preuve en est que cet ennemi qui n’est pas nommé, tout le monde l’a reconnu, et dans tous les pays d’Europe. Ajoutons qu’un long passage de La Peste a été publié sous l’Occupation dans un recueil de Combat et que cette circonstance à elle seule justifierait la transposition que j’ai opérée. La Peste, dans un sens, est plus qu’une chronique de la résistance. Mais assurément, elle n’est pas moins. »
Ce livre ne parle donc pas de la lutte contre une maladie dont il faut se protéger, mais de la résistance à la « Peste brune » dont l’épidémie ne constitue qu’une allégorie.
Mais <France Culture> rappelle que ce roman a vu ses ventes s’envoler au fil de nos angoisses épidémiques.
Camus hésite sur le titre à donner à ce roman : « Les Séparés », « Les Prisonniers » sont envisagés puis abandonnés.
Sur cette page, vous trouverez aussi une analyse des manuscrits originaux de « La Peste » par Anaïs Dupuy-Olivier, conservatrice, responsable des manuscrits d’Albert Camus à la BnF :
« Camus a 25 ans quand germe en lui l’idée, sans doute inspirée par Antonin Artaud, d’écrire un roman autour d’une épidémie. À ce moment, il n’a pas encore écrit « L’Etranger » et l’Europe n’est pas encore envahie par les nazis. Camus, qui vit à Oran, en Algérie, se documente abondamment sur les grandes pestes de l’Histoire, et lit les romans incontournables des épidémies […]
 […] Pendant l’année 1941, il commence à mettre par écrit ses idées, des plans du roman qu’il barre au fur et à mesure, des listes de personnages, des bribes de phrases, des brouillons qui sont souvent très raturés, qui sont écrits, on le voit bien, avec beaucoup de rapidité, sans application, on voit bien que c’est une pensée en train de se faire. […]
[…] Pendant l’année 1941, il commence à mettre par écrit ses idées, des plans du roman qu’il barre au fur et à mesure, des listes de personnages, des bribes de phrases, des brouillons qui sont souvent très raturés, qui sont écrits, on le voit bien, avec beaucoup de rapidité, sans application, on voit bien que c’est une pensée en train de se faire. […]
Le débarquement allié en Afrique du Nord et l’entrée des Allemands en zone Sud l’empêchent de rentrer en Algérie, chez lui : « Comme des rats ! » s’exclame-t-il dans ses Carnets, et quelques pages plus loin, début 1943 : « Je veux exprimer au moyen de la peste l’étouffement dont nous avons tous souffert
Camus a 30 ans [1943] quand il termine une première version de ce qui est devenu La Peste. Il n’en est pas content. […] des multiples corrections [sont] visibles sur le manuscrit original de La Peste : « Albert Camus est revenu sur ce qu’il avait écrit : en annotant, en barrant des mots qui lui semblaient inadaptés, en ajoutant des notes en marge… » Pendant trois ans, il bûche sur une deuxième version : des personnages disparaissent, sept chapitres sont supprimés, dix ajoutés. Il passe d’une juxtaposition de points de vue à un narrateur unique, le Dr. Rieux, qui nous interroge sur le sens de l’existence. »
Et cet article de France Culture d’insister que
« Le roman d’une épidémie à Oran devient clairement une allégorie de la résistance au nazisme, « la peste brune ». Camus y énumère les réactions d’une collectivité face à un fléau : l’héroïsme du quotidien, la réinvention de l’amour, les profiteurs du marché noir, le désespoir, la lutte.»
Et comme cela a déjà été révélé, Camus n’est pas content de son roman qu’il donne pourtant à Gallimard pour une publication en juin 1947. Ce sera un énorme succès populaire. Il est sur le podium du titre le plus vendu des Editions Gallimard, la médaille d’or est toujours « Le Petit Prince », la médaille d’argent est déjà pour Camus avec « L’étranger »
Camus se dit… « déconcerté ».
Il s’exprimera ainsi à la RDF, en 1950 :
« Ceux de mes livres qui ont plu m’exprimaient mal et ne me ressemblaient pas. »
Un an avant sa mort, il reviendra dans un entretien pour la télévision française sur la solitude de l’écrivain avant la publication de son œuvre :
« Un écrivain travaille solitairement. Est jugé dans la solitude. Surtout se juge lui-même dans la solitude. Cela n’est pas bon, ni sain. »
Pour finir, j’ai cherché comme exergue, une de ses phrases que sait distiller Camus dans ses œuvres.
« Les Séparés » fut un des titres possibles. Il pouvait représenter toute la population d’Oran qui était séparée du reste du monde. Mais le docteur Rieux est aussi séparé de sa femme tout au long du roman. Elle part en début de roman se faire soigner à la montagne parce qu’elle est atteinte de tuberculose comme Camus. Elle ne reviendra pas.
Et puis, il y a le journaliste Rambert de Paris, qui est venu à Oran et qui s’y trouve malencontreusement au moment où les portes de la ville se ferment. Or, il vient d’entamer une histoire d’amour avec une femme à Paris. Il n’aura qu’un objectif c’est de quitter la ville par tous les moyens, forcément illégaux, pour rejoindre sa compagne. En attendant le moment propice, il aide le docteur Rieux. Et quand le plan de fuite peut enfin se réaliser, sa fascination pour le dévouement du docteur Rieux, un appel intérieur de son humanité, le font renoncer à rejoindre sa douce. Ils restent séparés et il continue à s’occuper des pestiférés d’Oran. Il ne se trouve pas parmi les martyrs quand l’épidémie s’achève et c’est sa compagne qui le rejoint.
Et le récit du docteur Rieux écrit par Camus trouve alors ces mots :
« Mais d’autres, comme Rambert, que le docteur avait quitté le matin même en lui disant : « Courage, c’est maintenant qu’il faut avoir raison » avaient retrouvés l’absent qu’ils avaient cru perdu. Pour quelque temps au moins, ils seraient heureux. Ils savaient maintenant que s’il est une chose qu’on puisse désirer toujours et obtenir quelquefois, c’est la tendresse humaine ».
C’est peut-être cette phrase qui est la plus utile, la plus consolatrice, la plus nécessaire de ce roman pour notre compréhension des temps présents du confinement.
<1492>
