Hier, je vous disais que Robert Badinter avait été l’invité du 7-9 de France Inter du vendredi 26 octobre 2018, mais je ne vous en n’ai pas donné la raison.
Il avait été invité parce qu’il vient de publier un livre sur sa grand-mère maternelle, « Idiss » (edition. Fayard).
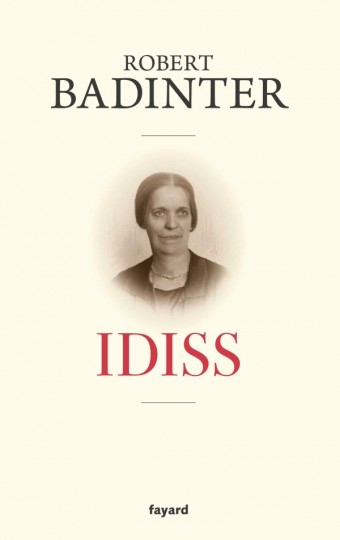 Il a dit lors de cette émission en parlant du destin de sa grand-mère :
Il a dit lors de cette émission en parlant du destin de sa grand-mère :
« C’est l’histoire d’une migration et de la fuite du régime tsariste. […] J’ai eu le sentiment qu’il fallait, avant qu’il ne soit trop tard, lui rendre témoignage. Les rapports entre les grands parents et les petits enfants ne sont pas de la même nature qu’avec les parents, c’est une source d’amour. […]
Fuyant le régime tsariste où les pogroms contre les juifs étaient fréquents, c’est en France que Idiss est arrivée : « On ne mesure pas ce qu’était cette très lointaine époque, dans l’empire allemand et celui du Tsar, le rayonnement de la République française. Celui qui a condamné de la façon la plus violente ces massacres, c’est Jaurès ». Il rappelle que « le Français était alors parlé dans toute l’Europe continentale. Et spécialement dans l’empire Russe. Le rayonnement de la langue, l’éclat des écrivains – Hugo était l’écrivain le plus vendu en Europe ».
La France et surtout la République, fille de la Révolution, avaient pour la première fois en Europe continentale donné aux juifs l’égalité des droits et la possibilité de devenir juge, officier, et la liberté complète comme les autres citoyens. D’où l’axiome de l’époque : « Heureux comme un juif en France ». C’est là où il fallait aller. »
Pour ce même livre, Robert Badinter a donné une interview à l’Express, publié le 23/10/2018 : « J’emporte avec moi un monde mort »
On apprend dans cet article que sa grand-mère maternelle, Idiss était originaire du Yiddishland, en Bessarabie, région située au sud de l’Empire tsariste, en lisière de la Roumanie. Elle était née en 1863, près de Kichinev qui est aujourd’hui la capitale de la Moldavie et qu’on appelle désormais Chisinau.
Kichinev est aussi entré dans l’Histoire en raison de deux pogroms qui ont eu lieu au tout début du XXème siècle. Ces deux émeutes antisémites appelés pogroms de Kichinev se sont déroulés en avril 1903 et en octobre 1905.
La Moldavie est un ancien Etat de l’Union soviétique coincée entre l’Ukraine et la Roumanie. C’est aujourd’hui le pays le plus pauvre d’Europe qui se vide de ses forces vives.
Le monde juif, le Yiddishland est évidemment un monde désormais perdu qui a été décimé par la Shoah.
Robert Badinter explique les raisons qui l’ont poussé à écrire ce livre :
« Il ne s’agit ni d’un projet de Mémoires, ni d’une biographie exhaustive sur la vie à la fois romanesque et tragique d’Idiss. C’est un geste. Un geste vers mon enfance d’abord, et un geste vers mes parents ensuite. J’ai compris à ce moment-là – ce qui n’est pas sans enseignement pour notre époque – que le fait de pouvoir se dire « j’ai eu des gens bien comme parents » est un grand réconfort dans la vie. »
C’est pour fuir la violence des pogroms de la Russie tsariste que beaucoup de juifs ont fui cette région.
Robert Badinter parle :
D’« un destin juif, européen et cruel. Son parcours relève des grandes migrations de cette période. [Ma grand-mère] fuit une Bessarabie russe dominée par le régime tsariste, avec tout ce que cela implique de violences antisémites, pour gagner Paris avant la Première Guerre mondiale. Après le dénuement des débuts, à force de travail et grâce à la prospérité des années 1920, Idiss et les siens connaîtront une aisance quasi bourgeoise, jusqu’à ce que survienne le désastre de la défaite de 1940 et de l’Occupation allemande. »
Et il raconte :
« Les fils d’Idiss, Avroum et Naftoul, partirent les premiers, vers 1907. Ils prirent la route après les pogroms meurtriers de Kichinev. Parmi les motivations de leur départ pour la France, il y a leur prise de conscience que l’antisémitisme rendait la poursuite de la vie en Bessarabie impossible. Le sionisme n’était encore qu’un rêve d’intellectuels. Pour eux, la seule solution était de s’en aller dans l’espoir de trouver les horizons de la liberté et de la dignité.
Partir, mais où ?
N’importe où vers les villes d’Europe centrale – Berlin, Vienne – et puis, au-delà, vers Paris, Londres et, bien-sûr, les Etats-Unis. Je me souviens d’une anecdote qui dit tout de l’esprit du temps. Un voisin juif vient faire ses adieux à un ami :
– « Je m’en vais.
– Mais où vas-tu ?
– Je vais à Chicago.
– C’est loin, ça…. »
Et l’autre répond : « Loin d’où ? »
Merveilleuse réplique… »
Et il parle d’une époque où la langue française et la France disposaient d’un prestige qu’elles n’ont plus aujourd’hui :
« Dans la Russie tsariste, la langue française tenait une place toute particulière. On la parlait, l’enseignait dans les lycées, les enfants grandissaient dans la culture française. On ne mesure pas l’amour et sa part de rêve qu’une grande partie de la population juive de Bessarabie portait à la France et surtout à la République. Chez les étudiants, en général les plus pauvres, la France de la Révolution française restait un exemple lumineux. Après tout, au XIXe siècle, elle était le seul pays d’Europe où un juif pouvait être titulaire de tous les droits civils et civiques. Il avait le choix de devenir, comme les autres, juge, officier ou professeur. C’était quelque chose d’inouï pour des sujets de l’empire tsariste. D’où l’expression : « Heureux comme un juif en France. » Ce propos fleurissait dans toute l’Europe. Son appel résonnait dans les profondeurs de la Russie tsariste. La réalité, hélas, n’était pas toujours aussi favorable. »
Et il évoque aussi l’école française de cette époque :
« L’école française, jusque dans les années 1930, était une prodigieuse machine assimilatrice. C’est pour cela que M. Martin – l’instituteur de ma mère, Charlotte – me paraît symbolique. Il prenait sur lui la charge des heures supplémentaires, car il y voyait le devoir d’intégrer les petits immigrés. Tous les enfants de « débarqués » allaient à l’école ; pas question de s’y soustraire. Tout cela eut un rôle majeur dans l’intégration de générations d’étrangers dans la République, et en particulier de juifs d’Europe centrale. »
En revanche, Lyon qu’on a appelé par la suite la capitale de la résistance ne lui a pas laissé un souvenir bienveillant :
« Oui, j’étais révolté par le spectacle de cette ville ruisselante de pétainisme. C’était bien pire qu’à Paris. Dans la capitale, la plupart des Parisiens attribuaient leurs souffrances aux Allemands. Les Lyonnais, eux, étaient plus enclins à incriminer les juifs, surtout étrangers. Il régnait une atmosphère avilissante, d’une médiocrité inouïe, marquée par l’adoration pour un vieillard comme le Maréchal qui incarnait un passé glorieux. J’étais consterné par les parades et le cérémonial ridicule qui entouraient le régime. Au lycée, les adolescents étaient rassemblés pour le salut aux couleurs et le chant en choeur de Maréchal, nous voilà ! C’était une époque d’une grande bassesse. Le cadet des fils d’Idiss, Naftoul, a été dénoncé par une voisine après la mort de ma grand-mère. A la Libération, la délatrice a été identifiée, et ma mère s’est rendue à une convocation pour la rencontrer. Elle lui demanda :
– « Mon frère était-il désagréable ?
– Non, il était très aimable.
– Alors pourquoi avoir dénoncé sa présence aux autorités ? »
Et la femme de faire cet aveu : « Mais pour les meubles ! » »
Et il conclut sur cette réflexion philosophique et historique :
« Ecrire sur Idiss, c’est exhumer un univers englouti. Une Atlantide culturelle. […]. Il m’arrive de réfléchir, au Mémorial, devant la liste interminable des victimes de la Shoah, et je suis pris de vertige devant les crimes commis, notamment à l’égard des enfants. Face à l’énigme de ce massacre des innocents, je songe que Dieu, ces jours-là, avait détourné son regard de la terre. J’ai l’impression d’emporter avec moi un monde mort, aux synagogues détruites et aux tombes éventrées. Et je me dois d’en témoigner, pour que l’oubli ne l’emporte pas tout à fait. Bien sûr, je reconstitue certains détails par l’imagination, mais j’espère avoir été fidèle à l’essentiel. A cette occasion, j’ai revécu par la pensée tout ce qu’a dû endurer Idiss, à la toute fin de sa vie, dans le Paris de 1942. Les dernières années de l’Occupation furent terribles. »
Un témoignage poignant et qui rappelle d’où nous venons et où surtout il ne faut pas retourner.
<1136>
