Cela a commencé dans les universités américaines des Etats-Unis et du Canada, le même phénomène s’instille aussi dans les universités françaises.
Je l’avais évoqué lors du mot du jour de la série Beethoven : « Beethoven victime de la « cancel culture aux Etats-Unis ».
Mais évoqué conceptuellement un sujet comme celui-ci ne peut pas remplacer la force d’un témoignage. C’est un article de la presse canadienne, publié le 29 janvier par la journaliste Isabelle Hachey : « Les mots tabous, encore » qui m’a interpellé.
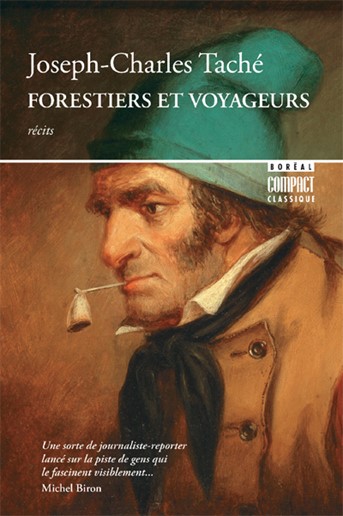 L’Université McGill est située à Montréal. elle a été fondée en 1821, c’est l’une des plus anciennes universités du Canada.
L’Université McGill est située à Montréal. elle a été fondée en 1821, c’est l’une des plus anciennes universités du Canada.
L’histoire que la journaliste va raconter se passe à l’automne dernier et concerne une jeune enseignante, chargée de cours :
« Le cours est une introduction à la littérature québécoise. L’enseignante a sélectionné huit romans, anciens et contemporains. Réjean Ducharme. Anne Hébert. De grands classiques. Des incontournables. Le premier texte est aussi le plus ancien : Forestiers et voyageurs, écrit en 1863 par Joseph-Charles Taché. Un roman folklorique qui parle de draveurs, de trappeurs et de bûcherons.
En classe virtuelle, la prof se fait interpeller.
« Madame ! Madaaame ! Le mot ! »
L’enseignante ne comprend pas tout de suite. À Ottawa, l’affaire Lieutenant-Duval n’a pas encore éclaté. « Page 99 », lui indique l’étudiante. La prof se rend à la page. La survole du regard. Cherche « le mot ». Lequel ? Elle ne sait pas trop. Mais elle sent une angoisse sourde monter en elle. »
Je suppose que comme moi, vous n’êtes pas au courant des péripéties universitaires canadiennes. L’affaire Lieutenant-Duval fait référence à une enseignante Verushka Lieutenant-Duval, qui enseigne l’histoire de l’art et les théories féministes à l’Université d’Ottawa. Lors d’un cours, elle a prononcé le mot : « nègre » et très rapidement un collectif d’étudiants a demandé sa démission parce qu’en utilisant ce mot, elle les aurait offensés. La direction de l’Université d’Ottawa a suspendu l’enseignante pendant quelques temps avant de lui permettre de reprendre le cours. Un article de Radio Canada raconte le malaise et la crainte de cette professeure devant les insultes et les mots violent qu’elle a dû subir depuis cette campagne contre elle : « J’ai peur depuis la première journée »
Mais reprenons le récit de la journaliste concernant la chargée de cours de l’Université Mac Gill :
« Soudain, ça lui saute aux yeux.
Il est là, écrit en toutes lettres.
Pendant leur séjour en forêt, les trappeurs canadiens-français ont « travaillé comme des nègres ».
La journaliste précise que l’enseignante a requis l’anonymat parce qu’elle craint les répercussions d’une sortie publique sur sa carrière.
Bien que l’enseignante présente immédiatement ses excuses, la tension monte :
« Des étudiants s’indignent de la présence du mot dans l’œuvre. Ils lui reprochent de ne pas les avoir prévenus ; ils n’étaient pas prêts à ce choc émotionnel. Ils remettent son jugement en cause.
La prof perd pied. « Le stress monte à un point où on n’est plus maître de soi-même, raconte-t-elle. C’est vraiment dans les pires minutes de ma vie. »
Elle tente d’expliquer. De justifier. C’est une expression qui reflète les mentalités de l’époque, bafouille-t-elle. Et en bafouillant… le mot tabou lui glisse des lèvres.
« Madaaame ! Vous venez de le dire ! C’est inexcusable, une Blanche ne doit jamais prononcer ce mot ! »
Les étudiants ferment leur micro et leur caméra les uns après les autres. À la fin, la prof se retrouve seule. Abasourdie.
Deux plaintes pour racisme sont déposées contre elle auprès de la faculté des arts de McGill. »
Les instances dirigeantes de l’Université ont eu pour stratégie de faire baisser la tension à coups d’accommodements accordés aux étudiants.
Le vice-doyen à l’enseignement qui l’a défendue lorsque l’enseignante avait été qualifiée de raciste par une poignée d’étudiants, lui a cependant conseillé de passer en revue les romans au programme et d’anticiper les mots qui risquaient d’offenser les étudiants..
Bref, il a baissé pavillon et battu en retraite, en plein combats des idées.
L’enseignante a suivi les conseils du vice doyen :
« Elle l’a fait. Des huit romans, sept contenaient des mots qui ont terriblement mal vieilli. Le « mot qui commence par N », bien sûr. Plus souvent, « le mot qui commence par S », pour sauvage. « Quand on parle des Autochtones dans les textes québécois, jusque dans les années 1960, c’est le mot qui est là. »
Elle aurait voulu leur expliquer. Mettre en contexte. Mais elle s’est tue pour s’éviter des problèmes.
Certains lui ont échappé. Un « mot qui commence par N » dans Les fous de 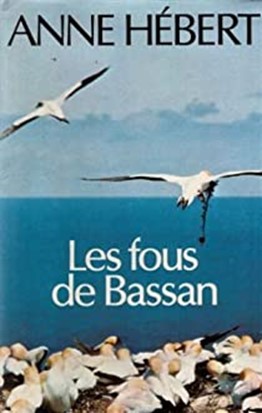 Bassan, d’Anne Hébert (1982). Un autre dans L’hiver de force, de Réjean Ducharme (1973). Tout l’automne, elle a vécu dans la crainte d’un autre dérapage.
Bassan, d’Anne Hébert (1982). Un autre dans L’hiver de force, de Réjean Ducharme (1973). Tout l’automne, elle a vécu dans la crainte d’un autre dérapage.
Le vice-doyen lui a conseillé non seulement de prévenir ses étudiants, mais de leur offrir de sauter des pages, voire de ne pas lire les œuvres entières.
Son cœur lui disait de résister. Mais il y avait l’affaire Lieutenant-Duval qui déchaînait les passions au Québec. Et puis, il y a eu l’affaire Joyce Echaquan à Joliette. « Le contexte était explosif. Évidemment, on a envie de se plier et d’être du côté de la vertu. »
Alors, elle l’a fait. Elle a plié. »
Toujours pour préciser le contexte canadien, Le 28 septembre 2020, Joyce Echaquan, une femme de 37 ans, Atikamekw, c’est-à-dire appartenant à un peuple autochtone est décédée à l’hôpital de Joliette, au Québec. Avant sa mort, elle a enregistré un Facebook Live qui montrait des agents de santé la maltraitant. Il s’agissait dans ce cas de comportements racistes avérés : « Mort de Joyce Echaquan : honte et indignation à l’hôpital de Joliette »
Rien de tel dans l’histoire qui se passe à l’Université Mac Gill.
La journaliste ne se place dans le camp des vaincus sans combattre et écrit : « Ça n’aurait pas dû se passer comme ça. »
Elle donne ainsi la parole à des professeurs de cette université qui s’inquiète de cette dérive. Notamment Arnaud Bernadet, professeur de littérature à l’Université McGill :
« Tout l’automne, elle a vu l’Université céder du terrain aux étudiants de sa collègue. « Ne pas prononcer le mot, d’abord. Ne pas le faire lire. Prévenir les étudiants. Caviarder les PowerPoint. Les censurer. Enfin, recommander une non-lecture de l’œuvre sur laquelle ils devaient être évalués ! C’est… »
Elle cherche le bon mot.
Je lui suggère celui-ci : aberrant. »
La jeune enseignante ne donne plus le cours d’introduction à la littérature québécoise. Elle ignore si elle le redonnera un jour – ou si elle a même envie de le faire.
« Je n’ai pas décidé d’abandonner l’enseignement de la littérature, mais l’automne dernier, dans les moments les plus creux, je me disais : « Si on est toujours là avec une brique et un fanal à attendre la prochaine gaffe du prof, je ne suis plus certaine que ça me tente. » »
Traité une personne de couleur noire de « Nègre » ou de « sale Nègre » constitue indiscutablement une injure raciste qui doit être condamnée.
Mais effacer toutes les utilisations du mot « nègre » dans les œuvres du passé, ce n’est pas lutter contre le racisme.
Les gens qui sont dans ce combat, prétendent être dans le camp du Bien, ils sont plutôt dans le camp de l’appauvrissement culturel et de la mésintelligence.
Parmi les électeurs de Trump il y a des racistes, des machistes, des suprémacistes blancs.
Mais probablement que si ces électeurs sont si nombreux, c’est aussi qu’il en est qui rejettent la dérive de ces intolérants qui se prétendent de gauche et n’acceptent plus l’altérité, la contradiction, la complexité.
<1522>

C’est très choquant en effet, non pas le débat sur les mots qui agressent mais l’esquive du monde universitaire face au diktat de certains
Tu as raison l’esquive universitaire que j’appellerais lâcheté est ce qui semble le plus choquant. Toutefois la rigidité, la violence et l’attitude binaire ou manichéenne de ces identitaires est insupportable. Ils rendent odieux le combat qu’ils prétendent mener.