<L’Obs> a republié le texte dans lequel Sartre essayait de rendre hommage à Camus le lendemain de sa mort. Cet hommage commence ainsi :
« Nous étions brouillés, lui et moi une brouille, ce n’est rien – dût-on ne jamais se revoir -, tout juste une autre manière de vivre ensemble et sans se perdre de vue dans le petit monde étroit qui nous est donné. »
Décrite ainsi, cette brouille pourrait paraître «gentille». Mais elle ne le fut pas du tout. Ce fut plutôt un lynchage, un ostracisme du monde intellectuel parisien.
Car à cet époque, Sartre dominait le monde intellectuel parisien et il est courant d’exprimer cette phrase qui serait de Jean Daniel : « J’aime mieux avoir tort avec Sartre que raison avec Raymond Aron ». Parce que Raymond Aron était classé à droite. Mais ce qui opposait Raymond Aron et Sartre était fondamentalement le même sujet que Camus et Sartre : Sartre défendait coûte que coûte les régimes communistes alors que Raymond Aron et Camus les vilipendaient en raison de leurs atteintes incommensurables à la liberté et aux droits humains. Raymond Aron leur reprochait aussi leur inefficacité économique.
Dans un < article de Libération publié en juillet 2017>, le journaliste Philippe Douroux, s’est rangé comme toute la gauche responsable derrière ce constat :
« Raymond Aron avait raison, hélas ! »
 Après avoir vécu quelques temps à Oran avec son épouse Francine Faure, Camus va rejoindre, en pleine guerre, Paris. Il rencontrera Sartre et Simone de Beauvoir et ils furent bons amis. Mais alors que Camus entre dans la résistance et dirige le journal « Combat », Sartre et Beauvoir ne s’engagent pas dans l’action contre les nazis. Selon <Michel Onfray> ils participeront même à des médias collaborationnistes :
Après avoir vécu quelques temps à Oran avec son épouse Francine Faure, Camus va rejoindre, en pleine guerre, Paris. Il rencontrera Sartre et Simone de Beauvoir et ils furent bons amis. Mais alors que Camus entre dans la résistance et dirige le journal « Combat », Sartre et Beauvoir ne s’engagent pas dans l’action contre les nazis. Selon <Michel Onfray> ils participeront même à des médias collaborationnistes :
«Camus fut un adversaire philosophique terrible et Sartre a lâché les chiens contre lui. Sartre n’a rien compris à la politique : il n’a rien vu de la montée du nazisme, bien que vivant en Allemagne ; en 1933, il profite d’une offre faite par les fascistes italiens pour partir en vacances en compagnie de Beauvoir avec des billets à prix réduits ; il passe à côté de la Résistance ; il publie dans Comoedia, un journal collaborationniste, en 1941 et en 1944 ; il pistonne Beauvoir à Radio Vichy, où elle travaille, etc.»
Un article de <TELERAMA> détaille la genèse et les méandres de la querelle qui va les séparer.
Je n’en tire qu’un court extrait :
« Ce qui va séparer Sartre et Camus est la question communiste, la grande question de l’après-guerre. Camus, à Alger, a été communiste ; il connaît le Parti, sa grandeur quand il s’agit des militants pris individuellement, son dogmatisme bureaucratique quand il s’agit de l’appareil ; il se méfie des dirigeants, de leur soumission à Staline. Sartre, lui, n’a aucune expérience de l’action, il se pose des questions de principes et de théorie, en intellectuel. »
Un article récent du philosophe Roger-Pol Droit publié dans le journal « Les Echos » en dissèque les contradictions et les points saillants : <Camus-Sartre, on refait toujours le match>
« Entre lui et Jean-Paul Sartre, l’amitié avait laissé place à un conflit aigu entre deux conceptions de la politique et du rôle des intellectuels. […] leur querelle a marqué en profondeur, et jusqu’à nos jours, l’histoire intellectuelle et politique. »
A l’origine une réelle admiration réciproque les rapprochait :
« Avant de se rencontrer, ils ont commencé par se lire et s’apprécier, et même s’admirer, par romans interposés. Le jeune Camus, encore en Algérie, s’enthousiasme, en 1938, pour le premier roman de Sartre, La Nausée. Il en rend compte avec ferveur dans l’Alger républicain, le journal progressiste dans lequel il écrit. De son côté, Sartre lit L’Etranger dès sa parution en 1942. Il ne cache pas son engouement pour le jeune écrivain, parle abondamment de son talent, contribue à le faire connaître dans les cercles influents. Sartre, de huit ans l’aîné de Camus, commence ainsi par faire de ce jeune homme ardent, un peu sauvage, artiste plus qu’intellectuel, son protégé dans le petit monde littéraire de Paris occupé. »
Catherine Camus la fille d’Albert nous apprend que Sartre traitait Camus de « petit voyou d’Alger », lui qui était issu de la bourgeoisie parisienne, né dans le XVIème arrondissement. C’était dans le temps de l’amitié, un sobriquet affectueux. Par la suite, dans le temps du conflit ce sera un motif de supériorité, Camus n’ayant pas les mêmes lettres de noblesse que Sartre qui l’accusera de ne rien comprendre à la philosophie.
La dispute viendra de la publication de « L’homme révolté » de Camus et de la position devant le stalinisme :
« Leur entente philosophique et politique va se déliter, peu à peu, sous l’effet de la guerre froide. Un clivage aigu va bientôt séparer les amis des communistes, enclins à tout pardonner des pires méthodes de Staline, et les défenseurs des droits de l’homme, pour qui la révolution et ses lendemains enchantés ne peuvent justifier ni le totalitarisme de la dictature du prolétariat ni les meurtres de masse qui en découlent. Cette fracture, de plus en plus profonde entre Sartre et Camus, n’est pas visible d’un seul coup. Le fossé va se creuser par étapes. »
 Le premier clivage vient de leur appréhension différente d’un livre que j’ai lu et qui dénonce avec force l’horreur et l’imposture du totalitarisme : « Le Zéro et l’infini » d’Arthur Koestler. Le zéro est l’individu, l’infini est le Parti :
Le premier clivage vient de leur appréhension différente d’un livre que j’ai lu et qui dénonce avec force l’horreur et l’imposture du totalitarisme : « Le Zéro et l’infini » d’Arthur Koestler. Le zéro est l’individu, l’infini est le Parti :
« Camus soutient [ce livre]. En Algérie, il a vu de près, comment fonctionne la discipline communiste. Il refuse de passer sous silence les crimes des staliniens – éliminations, lavages de cerveau, procès truqués, déportations… Sartre, au contraire, choisit bientôt de soutenir coûte que coûte l’Union soviétique et le parti communiste, fût-ce au détriment de la justice et de la morale. Un soir, chez Boris Vian, Camus excédé claque la porte. Ce n’est qu’un premier signe. »
Et en 1951, Camus publie « L’homme révolté » :
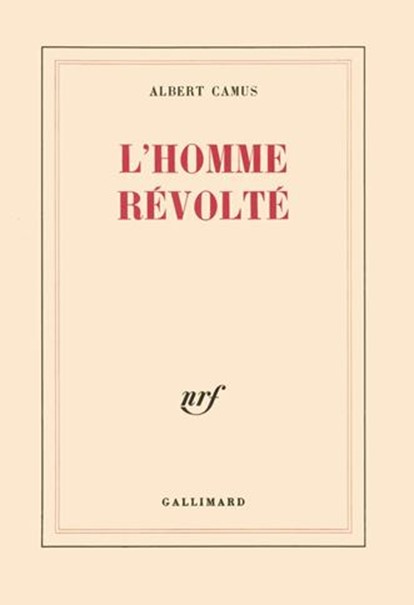 « Dans ce maître-livre, il explique de manière incomparablement simple et forte comment toute révolte renferme un désir de justice, incarne une manière de se dresser contre la soumission, l’humiliation, la domination. Mais les révolutions confisquent ce désir. Elles renforcent le pouvoir de l’État, qui tue la révolte.
« Dans ce maître-livre, il explique de manière incomparablement simple et forte comment toute révolte renferme un désir de justice, incarne une manière de se dresser contre la soumission, l’humiliation, la domination. Mais les révolutions confisquent ce désir. Elles renforcent le pouvoir de l’État, qui tue la révolte.
La Russie est ainsi devenue une « terre d’esclaves balisée de miradors ». La seule issue : se révolter contre la nouvelle oppression qui s’installe. « Tout révolutionnaire finit en oppresseur ou en hérétique », souligne Camus. La révolte, qui semble d’abord un mouvement individuel, devient à ses yeux le fondement du collectif : « Je me révolte, donc nous sommes », écrit le philosophe. »
Ceci va conduire non à une bataille d’arguments mais à une mise au ban, Camus n’est qu’un traître, un renégat, un transfuge parti rejoindre le camp de la bourgeoisie et des ennemis du prolétariat.
Et c’est un de ses aveugles qui adorait avoir tort avec Sartre qui va porter l’estocade :
« En mai 1952, Francis Jeanson se charge d’exécuter L’Homme révolté dans la revue de Sartre et de Simone de Beauvoir. Sa critique consiste à faire de Camus une « belle âme » sans ancrage dans l’histoire réelle : sa conception de la révolte ne tient aucun compte des « infrastructures », comme dit le jargon de l’époque, les bases économiques de la production, donc de la société et de la politique. »
Sartre finira par proclamer que
« Tout anticommuniste est un chien »
Vingt ans plus tard, un autre aveugle, Jean-Jacques Brochier donnera comme titre à un de ses ouvrages « Camus, philosophe pour classes terminales ! »
Pierre Bourdieu choisira le même camp :
« Que l’on pense simplement au Camus de L’homme révolté, ce bréviaire de philosophie édifiante sans autre unité que le vague à l’âme égotiste qui sied aux adolescences hypokhâgneuses et qui assure à tout coup une réputation de belle âme. »
(La distinction, p. 379.)
Aujourd’hui pour Michel Onfray, la victoire de Camus est totale.
Elle est aussi inscrite dans les chiffres :
- Exemplaires de livre de Camus vendus·: 26 millions, Sartre : 15 millions
- Livre le plus vendu de chacun : « L’Etranger » Camus : 9 millions « Huis Clos », Sartre : 3 millions
- Traductions·de Camus : 70 langues, tous titres confondus, Sartre : 47 langues, tous titres confondus.
(Données Gallimard)
Camus est dans l’éthique de la responsabilité : Même pour une cause juste il n’est pas possible de tout faire, de tout accepter. Il revient ainsi au message de son père, un des seuls qu’il a recueilli : « Non, un homme ça s’empêche. Voilà ce qu’est un homme, ou sinon… ».
Sinon ce n’est pas un homme.
Sartre fait partie de ces hommes qui considèrent que les institutions notamment du capitalisme sont violentes et que les combattre permet d’excuser quelques débordements.
C’est aussi une manière d’excuser la violence qui peut exister en nous.
C’est enfin croire que tous les problèmes qui se dressent devant nous sont de la responsabilité d’autres, d’un ou de plusieurs autres. C’est ainsi une fuite devant nos responsabilités propres.
Dans mon esprit, il y a peu de doute que le combat de Camus est le bon combat.
Certains considèrent que ce n’est pas aussi simple. Ainsi Ronald Aronson écrit : « Sartre contre Camus : le conflit jamais résolu ».
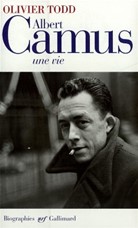 Et le biographe de Camus, Olivier Todd, est aussi plus indulgent pour Sartre :
Et le biographe de Camus, Olivier Todd, est aussi plus indulgent pour Sartre :
« Toute sa vie, Camus a été un homme du doute, incertain de son talent. Sartre, lui, croyait en son génie. Politiquement – aujourd’hui, c’est facile -, je suis plus proche de Camus. J’aimerais aussi qu’on se souvienne que Sartre, crypto-communiste, ne s’est pas toujours trompé. Par exemple, sur Israël et les Palestiniens, sur le Biafra. Il faut cesser de dire qu’il nous a trompés. On s’est trompé avec lui. J’ai de l’admiration pour Camus et je garde de l’affection pour Sartre. J’ai toujours aimé leurs livres. »
Même dans cette réaction mesurée d’Olivier Todd, je garde ma proximité avec Camus car je crois le doute très préférable aux certitudes qui sont l’essence même de l’intolérance et du totalitarisme.
<1493>



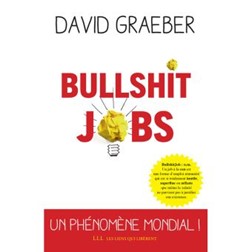

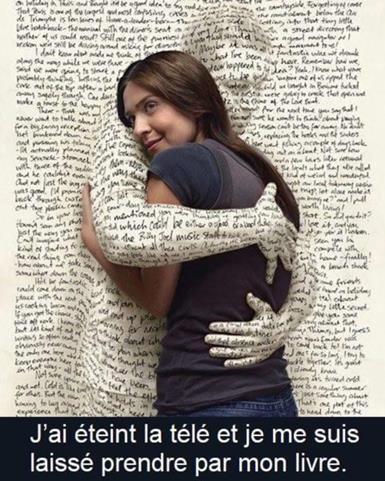


 <
<

