«Et je me suis lancée dans le combat contre le brevetage du vivant que je juge illégal, non scientifique, immoral et injuste.»
Vandana Shiva
Probablement ne le saviez-vous pas, mais il est possible désormais de breveter le vivant en Europe. C’est ce que nous apprend cette page de France 5, mise à jour le 11-02-2020. Je la cite :
« On croyait le brevetage des plantes non modifiées génétiquement impossible en Europe. Pourtant, l’Office européen des brevets (OEB) vient d’octroyer plusieurs brevets pour des légumes au profit de firmes internationales. Comment cette décision a-t-elle été possible et avec quelles conséquences ?
C’est une décision de la Grande Chambre de Recours de l’Office Européen des Brevets datée du 25 mars 2015 qui a permis de faire avancer “la cause” des multinationales sur le brevetage du vivant .
A la question “si l’on découvre un lien entre une séquence génétique existant naturellement dans une plante cultivée et un caractère particulier de cette plante, peut-on devenir propriétaire de toutes les plantes qui expriment ce caractère” , la Grande Chambre de Recours de l’Office Européen des Brevets a répondu …”oui”.
La décision de l’Office européen des brevets (OEB) d’accorder un brevet pour une tomate et un autre pour un brocoli, fait donc réagir de nombreux acteurs de l’écologie, comme du secteur semencier et agro-alimentaire.
Cette décision d’accorder des brevets pour des plantes non modifiées génétiquement était crainte et attendue : près de mille demandes de brevets de la part des industriels du secteur ont été effectuées en quelques années. Toutes ces demandes le sont pour des plantes dites “classiques”.
Christine Noiville, présidente du Haut Conseil des biotechnologies, docteur en droit et directrice de recherche au CNRS confirme la propriété temporaire qu’obtient l’entreprise sur la plante : ” Par cette décision, la Grande Chambre de Recours de l’Office Européen des Brevets confirme que l’entreprise peut bien obtenir un monopole temporaire sur le brocoli dit « anti cancer » et, au-delà, sur le caractère « anti cancer » lui-même, tel qu’il pourrait être intégré dans n’importe quel autre type de plante. Donc les sélectionneurs, voire les agriculteurs, qui produiraient des plantes possédant ce caractère breveté seraient astreints à payer une redevance à l’entreprise détentrice du brevet. ”
Jusqu’alors, en Europe, seul le Certificat d’obtention végétal (COV), lui-même déjà contesté par une partie des agriculteurs, pouvait être utilisé pour protéger la “propriété intellectuelle” de certaines semences issues des sélections naturelles.
L’inscription obligatoire au catalogue officiel [des semences] n’est pas toujours appréciée des agriculteurs, comme les redevances qu’ils doivent payer, mais dans l’absolu, l’échange de semences est toléré. Le COV semble un “moindre mal” comparé aux brevets, pour les agriculteurs. Pour la présidente du HCB, le basculement du COV vers les brevets est très important : “Le principe qui consiste à accepter que des plantes issues de procédés essentiellement biologiques, donc les produits de sélections essentiellement conventionnelles, soient protégées par des brevets, est une étape supplémentaire très importante dans l’évolution qu’ont connue les droits de propriété intellectuelle dans la sélection végétale ces 20 dernières années.”
Ce principe de brevetage du vivant — importé des Etats-Unis où il est actif depuis des décennies — est un cran au-dessus du COV, et amène un changement majeur pour le monde agricole, et par ricochet, pour la souveraineté alimentaire et l’autonomie semencière du continent européen. Par le biais de ce système, les plantes qui nourrissent la population peuvent devenir la propriété d’entreprises — le plus souvent spécialisées dans la génétique. Ces entreprises peuvent attaquer en justice — pour contrefaçon — les agriculteurs qui cultivent des plantes sous brevets sans autorisation et paiement d’une redevance. Comme dans le cas des plants d’OGM brevetés, majoritairement  interdits à la culture en Europe. »
interdits à la culture en Europe. »
C’est dire combien est important le combat de cette formidable femme indienne Vandana Shiva qui se bat depuis de longues années contre le brevetage du vivant. Il me semble que je ne l’ai jamais cité dans les mots du jour. Ceci constitue un grave oubli que je répare aujourd’hui, parce qu’elle fait partie de ces personnes que la Revue XXI a interviewé et dont l’entretien a été inséré dans le livre « Comprendre le Monde » dans lequel je suis en train de butiner pour partager certains de ces entretiens.
L’article que je partage aujourd’hui a pour titre « L’illégal brevetage du vivant » et a été publié à l’automne 2015 dans la revue N° 32. La journaliste qui a réalisé l’entretien est Coralie Schaub.
<Wikipedia> la présente ainsi : Vandana Shiva est née le 5 novembre 1952 à Dehradun en Inde. Après avoir obtenu une licence de physique en 1972, puis un master en 1974, à l’université du Panjab, à Chandigarh en Inde, Vandana Shiva poursuit ses études au Canada. Elle y obtient un master de philosophie des sciences à l’université de Guelph en 1977, puis un doctorat dans la même discipline obtenu en 1978 à l’université de Western Ontario. Elle réoriente ensuite ses recherches dans le domaine des politiques environnementales à l’Indian Institute of Science.
Elle est l’une des chefs de file des écologistes de terrain et des altermondialistes au niveau mondial, notamment pour la promotion de l’agriculture paysanne traditionnelle et biologique, en opposition à la politique d’expansion des multinationales agro-alimentaires et au génie génétique. Elle lutte contre le brevetage du vivant et la bio-piraterie.
Tout en poursuivant sa lutte contre l’introduction des OGM dans son pays, Vandana Shiva s’engage dans une forme d’activisme mondial en faveur de la paix, la biodiversité et du droit des peuples de disposer d’eux-mêmes.
Dans l’entretien, elle parle d’abord de son enfance :
 « Je suis née après la colonisation britannique dans les premières années de l’indépendance de l’Inde. Mes parents s’étaient engagés dans ce mouvement. Ma mère a persuadé mon père, major dans l’armée britannique, de quitter l’armée pour rejoindre le service indien des forêts. C’était un acte fort. Mes parents m’ont donné une éducation gandhienne, empreinte de spiritualité. Ils m’ont enseigné la non-violence, la simplicité et la compassion. […] J’ai eu la chance de grandir autour de gens exceptionnels. J’ai été marquée par les longues discussions qu’avait mon père avec deux disciples de Gandhi. Ces deux femmes, d’origine britannique, avaient été baptisées Mirabehn et Sarla Behn par le Mahlatma. Elles étaient très engagées dans la défense des forêts. Lakshmi Pandit, la sœur de Nehru alors Premier ministre, venait aussi à la maison. »
« Je suis née après la colonisation britannique dans les premières années de l’indépendance de l’Inde. Mes parents s’étaient engagés dans ce mouvement. Ma mère a persuadé mon père, major dans l’armée britannique, de quitter l’armée pour rejoindre le service indien des forêts. C’était un acte fort. Mes parents m’ont donné une éducation gandhienne, empreinte de spiritualité. Ils m’ont enseigné la non-violence, la simplicité et la compassion. […] J’ai eu la chance de grandir autour de gens exceptionnels. J’ai été marquée par les longues discussions qu’avait mon père avec deux disciples de Gandhi. Ces deux femmes, d’origine britannique, avaient été baptisées Mirabehn et Sarla Behn par le Mahlatma. Elles étaient très engagées dans la défense des forêts. Lakshmi Pandit, la sœur de Nehru alors Premier ministre, venait aussi à la maison. »
Elle précise que ses parents étaient rebelles au pouvoir, mais elle garde aussi le souvenir de sa vie dans la forêt et de ce que disait sa mère :
« Nous aimions jouer dans les ruisseaux, cueillir des fougères et des fleurs que nous faisions sécher pour décorer nos cartes de vœux. Grandir dans la forêt, c’était faire l’expérience de la beauté.
Ma mère, elle, plantait de nombreux arbres autour de la maison. Les gens ne comprenaient pas et s’étonnaient : « Mais ces arbres donneront des fruits dans vingt ans ! et vous ne serez plus là pour les manger ; » Elle leur expliquait : « on ne plante pas un arbre pour soi-même, mais pour l’avenir. D’autres mangeront les fruits »
C’est évidemment une philosophie de vie difficilement accessible aux possesseurs des grandes entreprises qui déposent des brevets sur le vivant : « D’autres mangeront les fruits ! ».
Ses parents étaient des esprits de progrès qui souhaitaient l’abolition des castes et l’égalité entre femmes et hommes. Un de ses grands-pères a donné sa vie pour que les filles puissent aller à l’école :
« En 1956, le père de ma mère est mort d’une grève de la faim pour défendre la création d’une école de filles, qui existe toujours. Il était persuadé que l’Inde ne pourrait se reconstruire sans l’éducation des filles. J’avais 4 ans, il a forgé la personnalité de ma mère et la mienne. »
La chaîne <Brut> présente la vie de Vandana Shiva en moins de quatre minutes
Elle commence des études de science dans la physique nucléaire. Mais elle va s’en détourner quand elle comprend que ce savoir est partiel et ne s’intéresse pas à l’humain :
« En physique nucléaire, on apprenait à calculer la libération d’énergie d’une réaction en chaîne, mais les effets des radiations n’étaient pas enseignés. J’ai compris que mon savoir était parcellaire et je me suis demandé pourquoi on ne nous apprenait pas tout. Pourquoi la science ne cherchait-elle pas à connaître ses impacts ? […] Alors, j’ai voulu me tourner vers l’essentiel, le plus fondamental. J’ai lu tous les journaux à la recherche des personnes qui posaient les questions et tentaient d’y répondre. Ils étaient tous au Canada. C’est là que j’ai poursuivi mes études, en physique quantique et en philosophie des sciences ».
Après ses études au Canada elle est retournée dans son pays natal. Elle fait des recherches et mène une étude sur l’exploitation minière de la vallée où elle a grandi pour le Ministère de l’Environnement :
« Nous avons démontré qu’il était plus rentable de ne pas extraire le calcaire qui stocke l’eau naturellement, car le détruire obligeait à construire tout un système de stockage. LE ministère a fermé les mines et notre travail a servi de base à la première jurisprudence de la Cour suprême indienne en faveur de l’environnement : « Quand le commerce détruit la vie, il doit cesser. »
Elle date son engagement militant dans l’écologie lorsqu’elle fait le constat des ravages de la déforestation :
« Avant de partir au Canada, j’ai voulu emporter avec moi un peu de la joie ressentie enfant dans la forêt et j’ai refait le chemin de mes anciennes randonnées, pas loin de Dehradun. C’était un choc : ma forêt de chênes avait disparu, les ruisseaux aussi. C’était comme si une partie de moi-même était morte. J’avais grandi en imaginant que les forêts étaient éternelles. Pour la première fois, je prenais conscience de la puissance des forces de destructions commerciales. [un vendeur de thé] lui dit : « Il y a de l’espoir, grâce aux activistes de Chipko ». C’est alors que je me suis promis de me consacrer à cette cause. […]
La forêt himalayenne a été ma seconde université, et les femmes de Chipko mes professeurs. Avant de les rencontrer, la forêt était jusque-là, pour moi, la beauté. Pour elles, c’était la survie : la source de leur approvisionnement en eau, en énergie… Je me suis mise à lire des livres de sylviculture. Tous ces ouvrages considéraient la diversité comme gênante : une plantation forestière uniforme était commercialement bien plus utile ! J’ai alors décidé de mêler le savoir pratique des femmes à mon savoir universitaire pour obtenir un tableau complet. Les villageoises avaient compris que la déforestation tarissait les sources et cela n’était pas abordé dans les livres !»
Du combat pour la sauvegarde de la forêt elle va aller vers l’engagement qui l’a mondialement fait connaître dans l’agriculture :
« En 1984, deux évènements terribles sont arrivés qui m’ont donné envie de comprendre pourquoi l’agriculture devenait un monde si violent.
Le premier était l’explosion de l’usine de pesticides de l’American Union Carbide, à Bhopal. Après l’explosion, les substances chimiques répandues ont causé la mort de milliers de personnes. Je me suis interrogée sur la raison de l’utilisation de produits aussi dangereux.
 Le second évènement était la vague de violence dans l’Etat du Pendjab […] Pourquoi les fermiers de cette région, réputée la plus fertile d’Inde prenaient-ils les armes alors que la révolution verte était censée nous apporter prospérité et paix ? Quelque chose clochait. Quelque chose lié à la terre et aux ressources. […] Je me suis plongée dans l’histoire des engrais et des pesticides chimiques. Et je me suis rendu compte que ces produits, utilisés pour nous nourrir, avaient été conçus pour tuer par la machine de guerre nazie et l’industrie allemande, à l’époque IG Farben. »
Le second évènement était la vague de violence dans l’Etat du Pendjab […] Pourquoi les fermiers de cette région, réputée la plus fertile d’Inde prenaient-ils les armes alors que la révolution verte était censée nous apporter prospérité et paix ? Quelque chose clochait. Quelque chose lié à la terre et aux ressources. […] Je me suis plongée dans l’histoire des engrais et des pesticides chimiques. Et je me suis rendu compte que ces produits, utilisés pour nous nourrir, avaient été conçus pour tuer par la machine de guerre nazie et l’industrie allemande, à l’époque IG Farben. »
Et c’est en 1987 qu’elle découvre les noirs desseins de certains industriels. :
« Cette année-là, je suis invitée à un séminaire sur les biotechnologies organisé par une fondation suédoise à Genève. […] A un moment, les industriels évoquent leurs plans pour développer les OGM et prendre le contrôle des semences. Ils disent vouloir modifier génétiquement les plantes pour les breveter et accroitre leurs profits. Ils en parlent ouvertement et expliquent qu’ils comptent se regroupe pour mieux conquérir les marchés. Je suis secouée et j’entrevois ce qui risque de passer dans les fermes. Les paysans qui s’endettent pour acheter des engrais et des pesticides allaient aussi devoir s’endetter pour se procurer les semences.
Et c’est ce qui se passe ! Regardez : Ciba-Geugy, Sandoz et AstraZeneca ont fusionné pour devenir Syngenta ! Et Monsanto a racheté presque tous les semenciers de la planète. Ce que je n’imaginais pas à l’époque, c’est à quel point ces entreprises musèleraient les scientifiques s’intéressant à l’impact des OGM. A mes yeux, il n’y avait pas de temps à perdre et je me suis lancée dans le combat contre le brevetage du vivant que je juge illégal, non scientifique, immoral et injuste. Le plan exposé par les industriels me paraissait si totalitaire que seule une réponse gandhienne pouvait convenir pour lutter contre les multinationales et leur emprise sur la vie, les paysans, les citoyens »

Et c’est ainsi contre le brevetage du vivant et pour la conservation des semences anciennes et leur gratuité que Vandana Shiva va engager le combat.
L’entretien de la revue XXI et sa transcription dans le livre « Comprendre le Monde » ne se trouve pas sur Internet. Mais elle explique, de la même manière, sa stratégie et les outils de sa lutte dans <cet article d’Agora Vox> :
« Gandhi a été un modèle pour moi dès mon enfance, au travers de mes parents, qui m’habillaient avec le Khadi, un textile tissé à la main, mais surtout un symbole fort de son apport idéologique à l’Inde, son arme de lutte contre l’impérialisme britannique à une époque où tous les textiles provenaient d’Angleterre. Il clamait que nous ne serions jamais libres tant que nous ne produirions pas nos propres textiles. C’est la raison pour laquelle le tissage des vêtements a été une part importante de notre indépendance. […]
En 1987 à la Conférence de Genève, […] J’avais encore à l’esprit la façon dont Gandhi a symboliquement ressorti le rouet pour tisser et fabriquer des vêtements et je me suis demandé ce qui pourrait être le rouet de notre époque. J’ai pensé à la graine et j’ai commencé à en conserver depuis ce jour de 1987 en fondant Navdanya, mouvement de sauvegarde de la graine. La seconde facette de cette inspiration est le puissant concept de Satyagraha, que nous avons continuellement mis en pratique pour défendre notre droit aux semences libres..
Satyagraha signifie littéralement le « combat pour la vérité ». Et Bija Satyagraha signifierait le « combat pour la vérité de la graine ». Concrètement, la graine se reproduit, elle se multiplie, elle est partagée. Les paysans doivent avoir accès à ces semences. Nous avons commencé à pratiquer la « Bija Satyagraha » lorsque les grandes multinationales se sont mises à établir des monopoles sur les semences et ont utilisé notre gouvernement pour créer et mettre en place des lois qui existaient déjà en Europe et aux Etats-Unis, interdisant aux paysans d’utiliser leurs propres graines, rendant illégales des semences indigènes. »
Vous pouvez lire la suite dans l’article précité et dont je redonne le lien : < Vandana Shiva : graines de résistance>.
Je crois profondément que le combat de Vandana Shiva est juste.
Quand on réfléchit au monde d’après le COVID-19, cette question du brevetage du vivant et plutôt du non brevetage devrait se trouver parmi les tous premiers sujets à traiter.
Ce combat sera très âpre, tant les intérêts de puissantes forces financières sont à l’œuvre pour empêcher toute remise en cause de ces procédés qui leur assurent fortune et pouvoir.
<1426>

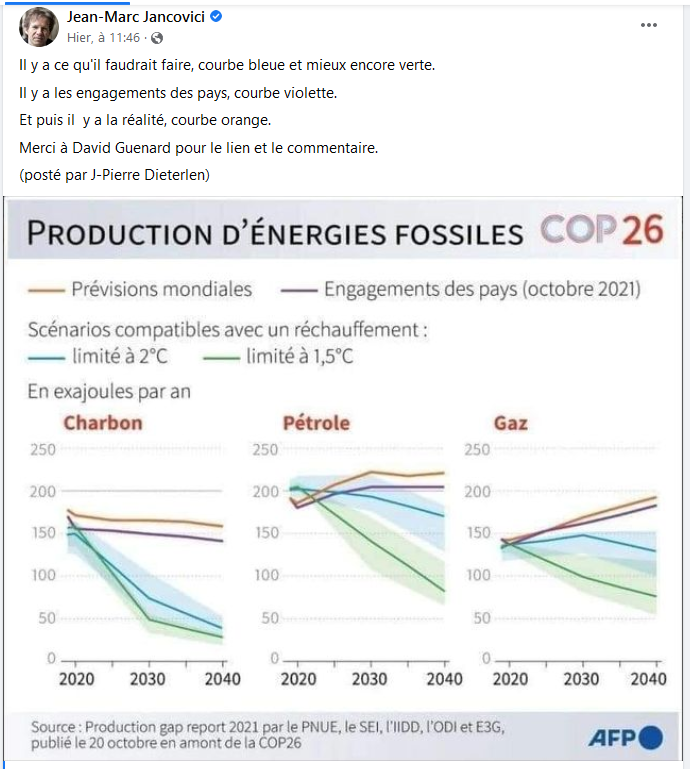




 interdits à la culture en Europe. »
interdits à la culture en Europe. »












